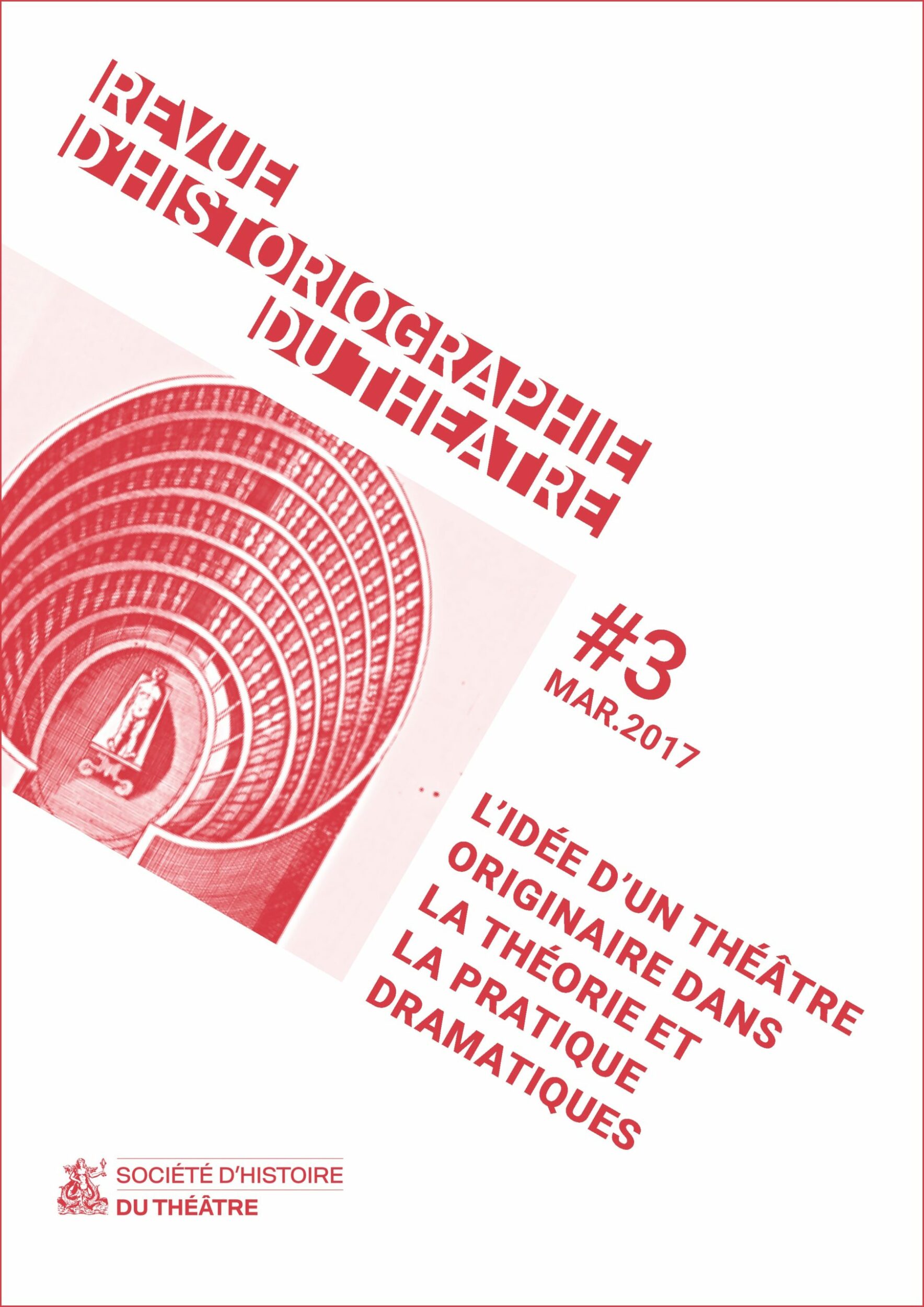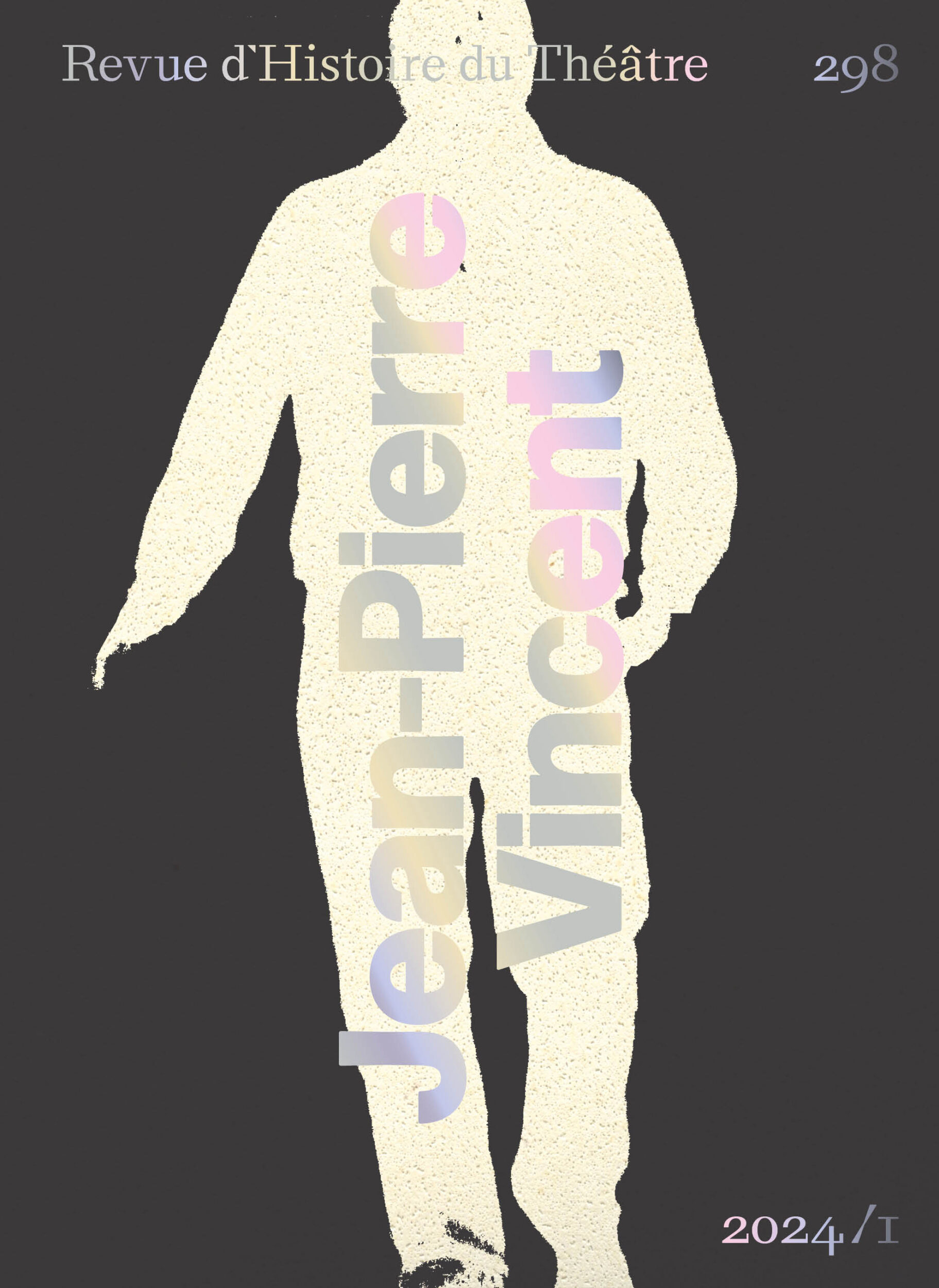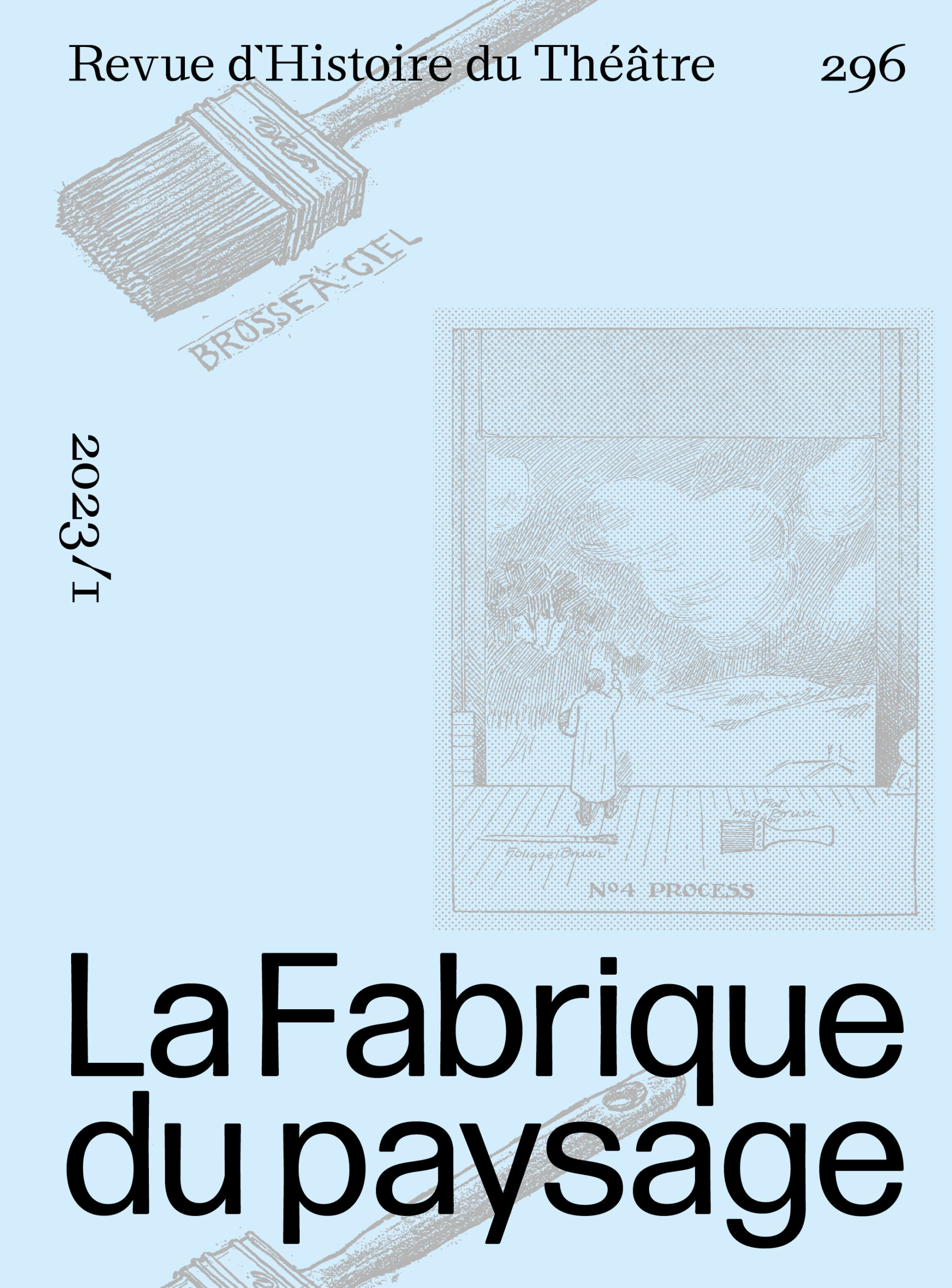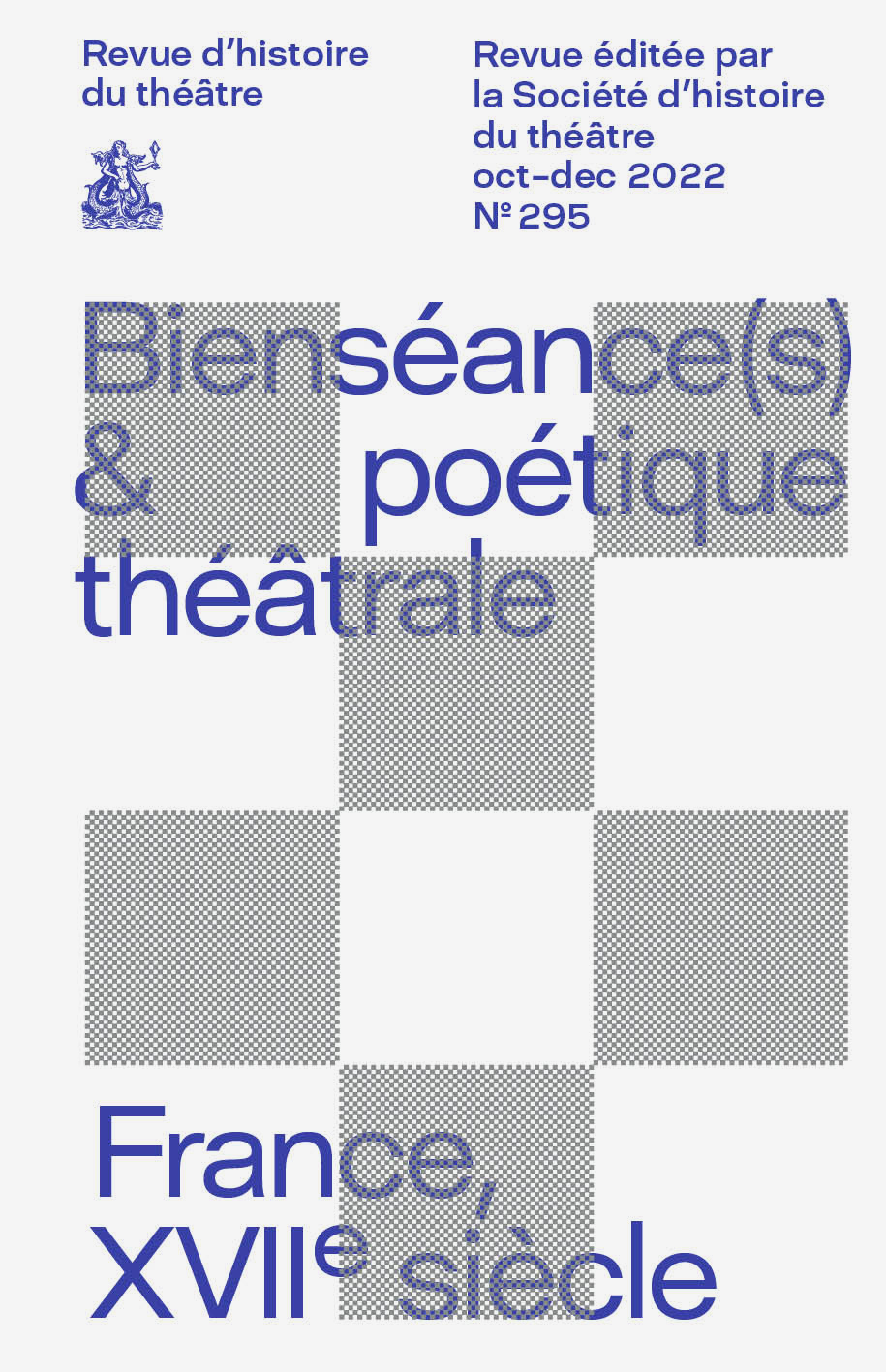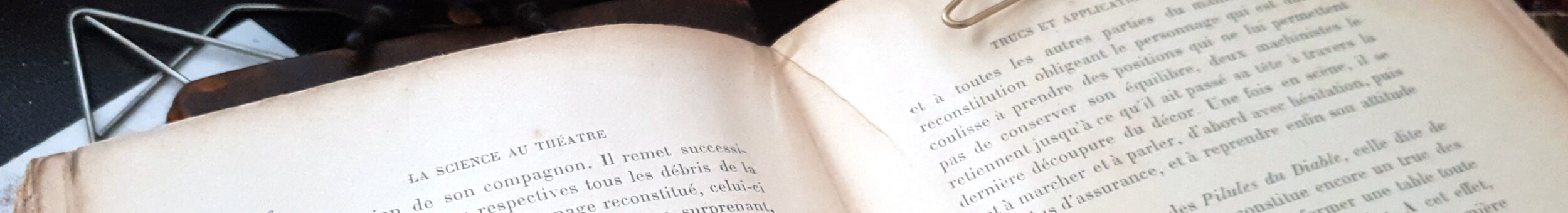Revue d’Historiographie du Théâtre • N°3 T1 2017
Fernand Chavannes ou l’invention d’un théâtre vaudois
Par Daniel Maggetti
Résumé
Le théâtre et les écrits personnels de Fernand Chavannes, dramaturge vaudois actif après la Première Guerre Mondiale, sont symptomatiques de la quête d’une littérature originale, et originelle, qui touche en Suisse romande toute une génération. Le Journal de Chavannes et sa tragédie Le Mystère d’Abraham, rédigés en parallèle, relaient cette quête collective d’une forme théâtrale qui saurait exprimer les spécificités de la culture romande, que l’écrivain perçoit en décalage avec la culture française. Doter la Suisse romande d’une forme dramatique et d’une expression scénique bien à elle, c’est inventer un théâtre originaire qui pourrait la rassembler, à l’instar d’une fête partagée.
Abstract :
Fernand Chavannes (1868-1936) was active as a playwright after the First World War in Switzerland’s French-speaking Vaud canton, a central part of Swiss “Romandy.” His theatre and personal writings are symptomatic of a literature that, for an entire generation of French-speaking Swiss Romands, is original—original both in being unique and in dealing with origins.Chavannes’ Journal, and his tragedy The Mystery of Abraham, written at the same time, reveal a collective quest for a theatrical form capable of expressing the specificities of a francophone culture different from French culture, and distinctly Swiss. Endowing Swiss Romandy with a dramatic form and scenic expression particular to itself allows him to invent an originary theatre that purports to bring all of the French-speaking Swiss together, on the model of a shared communal holiday.
Texte
Fernand Chavannes
| ou l’invention d’un théâtre vaudois
Au début de mars 1916, l’église de Pully, alors encore un village vigneron à proximité de Lausanne, accueille une représentation qui, sur le moment, est attendue avec un mélange de curiosité et de scepticisme, et qui apparaît, a posteriori, comme un événement fondateur dans l’histoire du théâtre de Suisse romande. Il s’agit du Mystère d’Abraham, première réalisation scénique d’un auteur âgé de près de cinquante ans, Fernand Chavannes. Membre d’une famille de la bonne bourgeoisie vaudoise, né en 1868, Chavannes a fait des études de lettres, achevées en Allemagne par un doctorat. Il a enseigné quelques années au Gymnase classique de Lausanne, où il a eu comme élève C. F. Ramuz, puis a choisi, dès 1898, de laisser mûrir ses aspirations littéraires, tout en apprenant le métier d’arboriculteur, qu’il exerce activement à partir de 1905, lorsqu’il revient s’établir à Pully. Auparavant, pendant dix ans, il séjourne souvent à Paris, où il effectue ce qu’on pourrait appeler son éducation théâtrale, en fréquentant assidûment le théâtre d’Antoine et celui de l’Œuvre.
L’histoire littéraire a volontiers traité Chavannes en le plaçant dans le sillage et comme sous l’éclairage de Ramuz, dont il a été un ami proche ; d’où des commentaires très orientés, axés sur la mise en parallèle du disciple jouant les tâcherons hésitants, et du maître trouvant du premier coup les bonnes formules, y compris au théâtre (pensons à l’Histoire du soldat). Plutôt que de reconduire une comparaison peu probante, j’aimerais, en examinant le chemin que Chavannes a suivi pour parvenir à la réalisation du Mystère d’Abraham, montrer en quoi il est symptomatique de la quête d’une littérature originale et originelle, qui touche en Suisse romande toute une génération désireuse non seulement de s’exprimer, mais de le faire en adéquation avec un contexte culturel et identitaire particulier.
La principale source qui permet de suivre le mûrissement de l’esthétique de Chavannes, ce sont les quelques cahiers du Journal qu’il a tenu entre 1903 et 1909, publiés en 1970 par Doris Jakubec dans un numéro de la revue Études de lettres. Témoignant de ses questionnements, de ses lectures, de ses convictions, les notes de Chavannes balisent la mise en place des principes qui seront à la base du Mystère d’Abraham.
Si le but de Chavannes est de parvenir à écrire des pièces répondant à ses goûts personnels, le Journal relaie aussi la quête collective d’une forme théâtrale qui saurait exprimer les spécificités de la culture romande, dont le décalage avec la culture française est rituellement souligné. Le constat de départ de Chavannes est le même que celui de plusieurs de ses compatriotes : pour de multiples raisons, la Suisse romande n’a pas encore vu naître son théâtre ; il s’agit donc de doter son peuple d’une forme dramatique et d’une expression scénique bien à lui, qui le rassembleraient à l’instar d’une fête partagée (on devine le poids de la référence rousseauiste)… Derrière les considérations de Chavannes, c’est donc bien le fantasme de l’expression originelle qui se profile, mais d’une expression originelle encore à venir et à inventer.
Le Journal conjugue les remarques historiques, par les avis que le diariste donne sur les spectacles dont il est le spectateur, les réflexions plus théoriques, par la tentative de définir l’essence même du théâtre, enfin les prises de position d’un dramaturge en plein processus de création.
Les lacunes que Chavannes déplore dans le domaine théâtral ne sont qu’une facette du manque général qui affecte la Suisse romande, celle-ci n’ayant jusque-là pas encore inspiré, selon lui, d’œuvres artistiques de qualité :
[…] la poésie et la peinture que tu as inspirées, ont été timides et incolores et comme figées loin de la vie – Ta pâleur et ta mollesse se reflètent dans les œuvres de tes enfants, qui ne sont que d’éternelles berceuses – (1904,
p. 214)[1]
D’où la nécessité, urgente, d’une réaction : il faut devenir des bâtisseurs. Mais qu’est-ce que la littérature de qualité ? Chavannes arpente le terrain de son art de prédilection en dessinant les contours du « bon » théâtre par la négative : le Journal additionne les critiques et les rejets, manifestant une claire volonté de rompre avec les références et les règles du théâtre contemporain[2]. Ce dernier est essoufflé. À l’échelle romande, Chavannes dénonce l’inadéquation des réalisations auxquelles il assiste, qu’il s’agisse des pièces importées appartenant au registre classique ou naturaliste, ou des créations régionalistes de ses compatriotes. Parmi celles-ci se trouvent celles de René Morax, que Chavannes fréquente ; elles se jouent au Théâtre du Jorat à Mézières, ouvert en 1908, et relèvent de l’adaptation du théâtre naturaliste à la situation d’une région périphérique. Mais c’est surtout contre les scènes lausannoises que le diariste fulmine. Le 7 avril 1908, il sort « furieux et dégoûté » d’une représentation d’Andromaque qu’il commente ainsi : « La barbarie des cabotins n’a pas de bornes – Ce réalisme ampoulé était ignoble ! Dans quelle époque nous vivons ! » (p. 265). Un mois plus tard, le 7 mai, c’est cependant la première création de Morax, la pièce d’inauguration de la « grange sublime », qui le laisse perplexe :
Répétition générale d’Henriette à Mézières – Le ton du dialogue m’a déplu – Et en tout un réalisme, je ne dirai pas trop brutal (ça m’est égal) mais trop brute, pas assez élaboré – Une sève qui peut donner des bourgeons et des feuilles, mais pas la saveur du fruit […].
Le réalisme du style m’a produit le même agacement […]
(p. 276-277).
Un même sentiment d’insatisfaction l’habite une quinzaine de jours plus tard, à l’issue de la représentation d’une autre célèbre production de Morax :
Je suis allé à Mézières […] entendre La Dîme – Frappé de l’hésitation qui se trahit dans plusieurs parties de la pièce – Il ne savait pas très bien ce qu’il voulait dire […]. Il faudrait [pour ce public populaire] un art en dehors, à gestes violents, à action vive, à voix haute, en plein soleil
(24 mai 1908, p. 281).
Ni le théâtre urbain et bourgeois, ni les tentatives « campagnardes » n’emportent l’adhésion de Chavannes. Le futur écrivain est ennemi des emprunts inadaptés et des formes mal greffées, dont il perçoit les retombées néfastes jusque dans les pièces rurales, qui pèchent dès lors par manque de naturel. C’est pourquoi il essaie de dépasser la convention et remonte le temps pour revenir aux sources de la culture française, qui à ses yeux coïncident avec le Moyen Âge. Chavannes perçoit la Renaissance comme une coupure suite à laquelle, par l’imposition de règles normatives, la veine populaire a commencé à se tarir dans le domaine artistique, amorçant un mouvement que le Grand Siècle a achevé :
Art pur [celui du Moyen Âge], avant l’éloquence, avant la raison, avant les règles !… Art qui pousse, verdoie et fleurit c. la plante… piétiné par la Renaissance brutale… La Renaissance perpétuée par les professeurs, pédants, cuistres de toutes guises. […] Et qu’avons-nous à faire avec Racine ? La beauté, ils définissent la beauté ! … On sait Boileau, honte d’une littérature, et on ne sait pas Rutebœf ! […] La Renaissance a apporté : la rhétorique / dialectique /, la logique, l’idée de droit ;
là où il y avait auparavant : la musique, (le sentiment), l’inspiration, la force balancée par la charité – (début 1904, p. 222-223).
Aux yeux de Chavannes, le Moyen Âge – « Non pas l’horrible moyen-âge romantique, oripeaux et pittoresque ; mais le vrai, le naturaliste / réaliste/, souple et ardent » – serait même « l’époque la plus artiste après le siècle de Périclès !… où tout était art » (début 1905, p. 221). Cette vision, guettée par le schématisme et non dénuée d’une tendance à l’idéalisation, le pousse à chercher des modèles dans la littérature médiévale. Le Jeu d’Adam retient son attention à la fois par sa tonalité – « que ces scènes sont belles, pleines de vérité, de simplicité, – de vérité surtout » (21 mars 1908, p. 252) – et par sa structure, en particulier par l’alternance entre des scènes et le chœur :
Ce soir repris le Jeu d’Adam – Un des avantages des chœurs est de permettre aux protagonistes une mimique qui peut être superbe et de belles scènes muettes […].
Il y a de la rhétorique dans cette chose, une belle rhétorique, mais il y en a – De la déclamation, non ! (30 mars 1908,
p. 259)
D’autres textes du même genre enthousiasment Chavannes : avant tout Le Jeu de Robin et Marion, « excellent par le détail, la justesse et le naturel » (26 avril 1908,
p. 273), puis « Le Jeu de la Feuillée – Comme Robin et Marion, à la fois naturel et inattendu » (dimanche 3 mai 1908, p. 275). En comparaison, les auteurs du répertoire canonique révèlent plus clairement encore leur insuffisance :
Racine est décidément pauvre de don – Toute sa raison et sa science de composition ne parvient pas à dissimuler cette pauvreté – Ennuyeux (26 avril 1908, p. 273).
L’admiration de Chavannes va aussi à « la farce de Maître Pierre Pathelin – Un vrai chef-d’œuvre », dont le contenu et le style sont également actuels, juge-t-il : « Très proche de nous par le réalisme, et aussi par la forme, ce petit vers à enjambements aussi libres que dans Mallarmé » (7 avril 1908, p. 265).
Pour refonder le théâtre et redécouvrir son essence, sa pulsation primitive, sa vérité, il faut donc se détourner des modèles légitimés par la tradition et se débarrasser de leur charge de scories. En faisant table rase, en s’approchant de l’essentiel par la voie du dépouillement, et en remontant à la simplicité médiévale, on retrouverait, intacte, la force première de l’expression scénique. D’après Chavannes, le Moyen Âge est le garant d’une authenticité originelle issue, comme naturellement, du peuple : sa vision reconduit celle d’une large part de l’école romantique, mais y intègre cependant de la méfiance vis-à-vis de ce qui, proclamé « populaire », émane en réalité des élites cultivées, et renforce la hiérarchie des valeurs bourgeoise. De telles mises en garde sont fréquentes au sein des Cahiers vaudois, autour desquels Chavannes gravite. Ainsi, dans un article paru dans la revue en juillet 1914, Edmond Gilliard tient des propos particulièrement explicites :
Il ne faut pas confondre ce qui est du peuple avec ce qu’on juge utile pour le peuple ; ce que le peuple produit avec ce qu’on juge profitable qu’il absorbe. On appelle littérature populaire, chez nous, le plus souvent la littérature même qui est la plus hostile au libre instinct populaire, la littérature d’éducation et d’édification populaire. […] On déclare populaire ce qui est propre à entretenir dans le peuple le respect des idées bourgeoises[3].
Est-ce à des productions semblablement édulcorées, ou mal orientées, que Chavannes assimile les pièces de Morax qu’il va voir à Mézières ? Il stigmatise en tout cas le courant comique de la « vaudoiserie », dont les pièces sont autant de mauvaises caricatures ne rendant pas justice au peuple du canton :
Tristesse ! Tu oublies, ou plutôt tu ne connais pas la verve ironique de mes paysans, qui ne les quitte pas même dans les moments les plus solennels, et qui a un tour si original ! Mais tout ce qui existe de littérature populaire dans ce pays, a cet accent sérieusement comique, je veux bien, comique tout de même. Il n’y en a pas de plus foncièrement propre à mon peuple. Ah ! il n’est pas facile à saisir, comme tout ce qui est vraiment original ! (« Mon Pays me parle », début 1904, p. 215)
En lieu et place de ce populaire qui tombe dans le folklorique et la facilité, Chavannes recherche la concision, voire la stylisation : « Retrancher, retrancher sans faiblesse tout ce qui est de curiosité » (mars 1904, p. 230), se donne-t-il pour règle.
Capital pour la culture française, bien qu’elle l’ait oublié, le Moyen Âge l’est davantage encore, selon l’écrivain, à l’échelle de la Suisse romande : le pays y plonge ses racines. Cette lecture se fonde sur des arguments historiques. N’ayant jamais appartenu au royaume de France, la Suisse romande aurait échappé aux modèles de la civilisation de cour, sur laquelle prend appui le classicisme du Grand Siècle ; ce décalage aurait encore été accentué par l’influence du protestantisme et par l’intégration d’éléments culturels helvétiques. D’où la revendication d’une filiation à soi : la généalogie artistique et littéraire des Romands diverge de celle de leurs voisins d’outre-Jura – du moins ceux de l’époque contemporaine –, qui a commencé à la Renaissance :
Ma tradition, je la touche, je la suis des doigts, je sais ce qui l’a interrompue et où ses fils se renouent dans l’ombre ; je sais où se trouve mon idéal de beauté et où gît la forme de mon esprit – […]
Je savais que c’était en France seulement qu’il pouvait se trouver, et j’étais rebuté par son XVIe s. romanisant, par son XVIIe classique, par son XVIIIe aristocratique et faussement antique ( !?), par son XIXe révolutionnaire… Shakespeare, Calderón, m’apparaissent plus proches […] et je ne comprenais pas d’où ils venaient, où ils me guidaient… au grand Moyen Âge, au XIIIe, au XIVe, au XVe s. français ! (1904, p. 221)
S’il a pour ainsi dire disparu du canon littéraire français, ce fonds archaïque est réactivé dans toutes les productions romandes de qualité :
Nous y [au peuple et au Moyen Âge] revenons, instinctivement, inconsciemment, chaque fois que nous sommes originaux : Juste Olivier – Notre tradition populaire […], nos conteurs populaires en découlent directement – C’est le fil qu’il faut garder dans la main – (début 1904, p. 222)
Nos contes populaires, osés et crus, sont des fabliaux ; nos représentations dramatiques, nos légendes… (mars 1904,
p. 225)
C’est donc définitivement « l’art rustre des fabliaux » que Chavannes se propose comme modèle : « tout ce qui est antérieur, et supérieur, à la logique, à l’analyse, à la rhétorique, au ratiocinement des mots » (mars 1904, p. 228). Cette aspiration à rejoindre des auteurs d’un passé antérieur à la tradition classique se combine chez lui avec une autre découverte, plus surprenante, qui jouera un rôle certain dans sa conception scénique : celle du théâtre japonais. La révélation a lieu à Lausanne en octobre 1908 :
Autre impression : J’ai vu Hanoko, une actrice japonaise – Un art aussi minutieux et aussi senti – Quelle vérité ! On croirait voir une chambre ouverte et la vie vraie, et cependant c’est de l’art, un art qui fait se succéder la grâce (la danse), le doux, le terrible, avec une simplicité incomparable de moyens – (1er octobre 1908, p. 285).
De son vrai nom Hisa Ōta, l’actrice japonaise Hanako (1868–1945) est connue notamment par la série de masques et par des bustes qu’Auguste Rodin a faits d’elle après l’avoir rencontrée à Marseille lors de l’Exposition coloniale de 1906. La fascination dont témoigne le travail du célèbre sculpteur est partagée par le public de l’Europe entière. En tournée au Kursaal de Lausanne au début d’octobre 1908, Hanako y est accueillie triomphalement, d’après les comptes rendus. Ébloui, Chavannes retourne applaudir l’actrice le 9 octobre ; la soirée attire plus de spectateurs encore, du fait qu’une autre artiste vedette, la Loïe Fuller, s’y produit également. Le diariste commente longuement le spectacle, dont il goûte la puissance d’aimantation dégagée par le jeu des corps et par la mimique, non par le langage ; la succession des scènes lui paraît aussi du meilleur effet :
Goûté surtout Otaké que je voyais pour la 2de fois – Charmante alternance de scènes gaies et graves, de babils et de silences […].
Joué avec un sens parfait de ces contrastes, se donnant de l’aise dans les scènes longues, ne craignant pas d’y mettre mille petits traits, et admirablement sobre dans les scènes brèves et fortes –
[…] Déjà dans la pièce qui avait précédé, et qui était beaucoup moins bien faite, la même opposition entre les scènes de préparation, de conversations naturelles et sans gestes, et le drame proprement dit, rapide, presque sans paroles, tout en geste, en pantomime. (9 octobre 1908, p. 292)
Tout comme Le Jeu d’Adam, le théâtre japonais met au premier plan la plasticité, et ne se soucie guère de l’intrigue, ou du moins de sa vraisemblance : il corrobore la définition que Chavannes a consignée dans son journal en janvier 1906, et qui dessine l’horizon de sa recherche scénique :
Le sujet est indifférent ; les idées, les sentiments, les sensations sont indifférents…
– Quelle est la matière du théâtre ?
– Ce sont les corps humains qu’il fait agir, gesticuler, danser, chanter, parler – Ce qui importe donc, c’est la vision des corps – (2 janvier 1906, p. 244-245)
Les souhaits de Chavannes font écho aux tentatives de Dullin, de Copeau, de Pitoëff, qui comme lui refusent le théâtre bourgeois. Copeau en particulier invoque les mêmes références que le Vaudois, idéalisant comme lui le Moyen Âge et son tréteau de farce, puis le Siècle d’Or espagnol et ses origines avec Lope de Rueda. On retrouve également chez lui le discours sur le retour à une pureté originelle du théâtre perdue, dont le rêve est porté, tout comme chez Dullin, par la recherche d’un espace nu, résistant au décorativisme. Il faudra plusieurs années à Chavannes pour réussir à achever et à montrer une pièce répondant à ses vœux. Ce sera donc, en 1916, Le Mystère d’Abraham, monté par lui-même, des membres de sa famille et des amis appartenant à la société de Belles-Lettres ; le texte sera publié la même année dans les Cahiers vaudois, auxquels Chavannes avait donné, en 1915, des nouvelles, sous le titre Bonheur de mourir, bonheur de vivre. La représentation se déroule entièrement dans le chœur blanchi à la chaux de l’église de Pully, sans décors et sans artifice. La mise en scène se résume à la composition des tableaux et à la manière de regrouper les personnages en jouant tantôt sur des correspondances, tantôt sur des antinomies : Chavannes mise sur des effets plastiques et sur une dimension statique qu’amplifient les costumes créés pour l’occasion par le peintre Jean-Louis Gampert.
À l’arrière-plan du Mystère, une note du journal datée du vendredi saint de 1908 :
Idée d’un drame, en quelques scènes simples précédées d’une lecture, coupées de chants de psaumes et cantiques, avec orgue – En somme le drame religieux protestant – Pourquoi pas ? Il faudrait qu’il y ait le caractère moral du protestantisme – Cela encore pourquoi pas ?
Pas très loin du Jeu d’Adam (p. 270).
Outre le fait qu’elle se rattache au canon médiéval, dès le titre qui reprend le terme connoté de « mystère », la pièce possède donc un autre aspect « originel », à cause de son inscription dans la mouvance protestante. L’adhésion d’une partie importante du pays romand à la confession réformée est désignée, surtout depuis le début du XIXe siècle, comme l’acte de naissance d’une communauté culturelle spécifique. Qui plus est, le premier grand drame protestant n’est autre que l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, joué à Lausanne en 1550 : en en reprenant la matière, Chavannes ne fait pas seulement un clin d’œil intertextuel, mais avoue son intention de mettre ses pas dans ceux du Réformateur pour « repartir à neuf ».
Le Mystère d’Abraham comporte cinq parties ; chacune d’entre elles est précédée de la lecture du texte biblique de la Genèse correspondant aux tableaux qui vont suivre, et qui retracent l’itinéraire accidenté d’Abraham, de la promesse de Dieu à sa réalisation incarnée par une postérité « comme la poussière de la terre », en passant par l’épisode d’Agar, par la naissance tardive d’Isaac, par la scène du sacrifice. L’introduction du personnage du Lecteur (assumé lors des premières représentations par le pasteur de Pully) est une nouveauté au théâtre. Les didascalies indiquent de manière précise les mouvements et les gestes des personnages ; ceux-ci, figurants compris, entrent en cortège dans l’église au son de l’orgue, au début de la pièce, et s’asseyent dans le chœur où ils restent visibles pendant toute la représentation, ne se levant que lorsqu’ils sont impliqués dans ce qui est montré : « Alors qu’ils n’interviendront qu’à la fin de la pièce, les descendants d’Abraham […] suivent l’action et réagissent visiblement aux errements de leur ancêtre[4]. »
Chavannes ne prend pas de libertés avec le texte biblique : il le suit à la lettre, et le personnage d’Abraham, aux prises avec la foi et en proie au doute, reste nimbé d’irrationnalité. La dimension religieuse et l’élan métaphysique sont rendus perceptibles par la figure de l’Ange, messager qui relie le monde visible et les sphères invisibles, l’ici-bas et l’au-delà, le temps humain et l’éternité. Sans être située géographiquement, la réalité dans laquelle les personnages sont enracinés est agricole et vaudoise : d’où un rapprochement, voire une interpénétration, de l’univers biblique des patriarches et de la sagesse paysanne locale, dans les séquences comiques comme dans celles « d’un étonnant lyrisme ludique[5] ». À travers ce double retour aux sources – populaires et culturelles – Chavannes montre, par l’exemple, qu’il partage un point de vue que Ramuz exposera plus tard, à savoir la primauté du « fonds biblique » dans la construction identitaire romande, et le constat d’une parenté axée sur la permanence de la « civilisation pastorale » :
[…] « nos » Antiquités à nous sont la gréco-romaine aussi, bien entendu, mais à laquelle l’Antiquité biblique est venue se surajouter.
[…] Quoique plus éloignés encore de nous dans le temps, ils se sont trouvés singulièrement rapprochés de nous par leur vie, Abraham, Noé, Jacob et Joseph, à cause de leurs troupeaux et parce qu’il y avait déjà des glaneurs dans les champs […][6].
Comme pour Ramuz, pour Chavannes aussi ces personnages, « Abram qui est devenu Abraham, Saraï qui est devenue Sarah, Noë, et puis son fils qui marche à reculons pour ne pas voir sa nudité », « sort[ent] du fond des âges et en même temps [sont] dans le [s]ien, tout pareils aux paysans qui [viennent] au marché, étant cultivateurs comme eux et vignerons comme eux, ayant comme eux des bœufs et des moutons[7] ». Dans Le Mystère d’Abraham, cette proximité est rendue sensible grâce au langage que Chavannes prête à ses personnages, mais aussi grâce aux costumes, comme le souligne un compte rendu de Benjamin Grivel :
D’une part, un langage d’une simplicité biblique, sobrement lyrique aux moments d’épanouissement du sentiment ; d’autre part, un langage d’un ton en deçà, ramené vers la vie quotidienne, adouci de familiarité, volontiers sentencieux, narquois même, et bien de chez nous […]. Ainsi le ton biblique, oriental, de l’histoire d’Abraham, se trouve raccordé au ton de la vie quotidienne et rustique.
[…] Cette adaptation du sujet au pays, cet art du dégradé et du rompu dans le ton, […] nous les retrouvons dans la figuration et les costumes. […] Et ici encore, on retrouve cette note de transition, cet accent familier et local qui raccordent le tableau à son cadre. Ainsi la robe à rayures de Sarah, qui rappelle certaine forme ancienne et traditionnelle de robe paysanne, ainsi et surtout le costume des serviteurs […] – la blouse de nos paysans et de nos vignerons[8].
Pour Doris Jakubec[9], à ce jour la critique la plus autorisée de Chavannes, l’unité du Mystère d’Abraham repose surtout sur une poétique influencée par la Bible, qui aboutit à une prose rythmée prenant la forme de versets fortement resserrés. Le dramaturge joue des symétries, des parallélismes et des antithèses[10], en s’appuyant sur de fréquentes reprises de termes pour prolonger la phrase et lui conférer un effet incantatoire. Il réalise par là son aspiration à cette écriture musicale dont il admire les réussites au Moyen Âge :
Cependant les motets, rondels – C’est là, à l’origine, que se trouve le principe commun de la musique et de la poésie – C’est ce caractère musical […] que j’admire dans la poésie du Moyen Âge et voudrais renouveler… (29 mars 1908,
p. 258)
Intermédiaire entre la poésie et la prose, le verset peut épouser des tons divers, et Chavannes puise dans ses ressources : tantôt fleuri et tendre, tantôt ironique, il convient aussi bien aux serviteurs qu’à l’Ange ou à Agar. Un tel emploi de cette forme admirablement souple se rapproche de celui que l’on observe chez Ramuz dans les « morceaux » de la période de la Grande Guerre ; en creusant l’analogie, on peut se demander si l’exploitation de la langue paysanne, dans Le Mystère d’Abraham, ne découle pas du même souci d’authenticité et de refus des normes dictées par l’Académie française que Ramuz dénoncera à la fin des années 1920 dans sa « Lettre à Bernard Grasset ». La pratique de Chavannes préfigure ainsi, au théâtre, la conception ramuzienne d’une « langue-geste » vivante, en adéquation avec le substrat d’où elle est issue, donc avec l’usage parlé, et opposée à la « langue-signe » de l’institution scolaire. Les deux écrivains communient ainsi dans la vision d’une littérature vaudoise foncièrement étrangère à la littérature de cour, émanation de la réalité sociale, historique et culturelle d’une région paysanne marquée par le protestantisme.
Le Mystère d’Abraham a connu une bonne réception, si l’on tient compte des circonstances de la guerre et des conditions particulières de sa réalisation. Par la suite, Chavannes va poursuivre une carrière théâtrale en dents de scie, jalonnée par quelques réussites – grâce notamment à sa collaboration avec Copeau et avec les Pitoëff –, mais comportant aussi de nombreux projets avortés. Sa pièce de 1916 restera néanmoins comme un moment charnière dans l’histoire littéraire romande. En manifestant le désir de pureté de Chavannes et sa relecture fantasmée des origines médiévales, elle met en évidence les défis, les points forts et les limites propres au théâtre, à son histoire et à sa pratique, dans un contexte traversé d’aspirations, à la fois personnelles et collectives, dont la puissance influence en profondeur les créations individuelles. En 1936, peu après le décès de Chavannes, Ramuz lui rendra un hommage ému, mettant en évidence à la fois l’audace du Mystère, sa réussite, liée à sa puissance d’actualisation, et l’isolement de son auteur, qui en est en quelque sorte le corollaire :
Chavannes avait réussi à établir une complète harmonie entre le sujet de sa pièce, le ton de sa pièce, l’ordonnance de sa pièce, et les vieilles traditions protestantes qui étaient encore vivantes […]. Il avait trouvé un accord entre les gens du pays, leurs gestes, leur accent, leur allure et les histoires du Vieux Testament dont ils avaient été nourris et à quoi ils devaient leur noblesse. […] on était à Pully de nos jours tout ensemble et au fond des siècles ; on assistait à une espèce de réconciliation des temps.
Et le public l’avait senti […] ; mais nous sommes un pays où tout retombe, et, une fois le geste fait, il n’y a plus personne pour le reprendre […].
C’est ainsi que Chavannes est resté solitaire toute sa vie et par là désarmé[11].
Constatant que les « décisions irrévocables des circonstances et du milieu » ont été « extrêmement contraires à Chavannes[12]», Ramuz termine son évocation en espérant que la postérité lui rendra justice. Hélas, la « modification de l’esprit public » que l’écrivain appelle de ses vœux pour que l’originalité de son ami soit reconnue semble encore à venir, même si sa contribution scelle la place de Chavannes parmi les figures fondatrices du théâtre romand.
| Daniel Maggetti
Notes
[1] Les références entre parenthèses renvoient au Journal de Chavannes publié dans Études de lettres, 3-4, 1970. Nous les faisons précéder de la date de la note citée.
[2] Signalons, sur ce plan déjà, une claire convergence avec le discours de Ramuz sur le roman, qui s’exprime selon des lignes de refus similaires, notamment dans sa « Réponse » à l’enquête sur « l’évolution actuelle du roman » lancée en 1910 par André Billy, réponse parue, avant d’être insérée en 1911 dans la plaquette éditée par le critique, dans L’Écho bibliographique du boulevard, le 15 juin 1910 (voir
C. F. Ramuz, Articles et chroniques, t. 1, Œuvres complètes, t. XI, Genève, Slatkine, 2008, p. 405-406).
[3] Edmond Gilliard, « Le Pays de Juste Olivier » [1914], repris dans Œuvres complètes, Genève, Trois Collines, 1965, p. 49.
[4] Joël Aguet, « Le théâtre et ses auteurs de 1900 à 1939 », dans Roger Francillon (dir.), Histoire de la littérature en Suisse romande, t. II, Lausanne, Payot, 1997, p. 328.
[5]Ibid., p. 327.
[6] C. F. Ramuz, Questions, repris dans Essais, t. 2, Œuvres complètes, t. XVI, Genève, Slatkine, 2009, pp. 354-355.
[7] C. F. Ramuz, Découverte du monde, repris dans Ecrits autobiographiques, Œuvres complètes, t. XVIII, Genève, Slatkine, 2011, p. 517.
[8] Benjamin Grivel, « Autour du Mystère d’Abraham », La Semaine littéraire,
18 mars 1916, p. 140.
[9] Voir Doris Jakubec, « Postface », dans Fernand Chavannes, Théâtre, Lausanne, La Bibliothèque romande, 1973, p. 233-243.
[10] La conscience de la nécessité de jouer sur les contrastes est présente à plusieurs reprises dans le Journal déjà : « Songer davantage aux oppositions de lumière et d’ombre, et aux contrastes de couleur – Watteau – Ce serait le principe de composition du drame avec cantiques – » (samedi saint 1908, p. 270).
[11] C. F. Ramuz, « Fernand Chavannes » [1936], repris dans Articles et chroniques,
t. 4, Œuvres complètes, t. XIV, Genève, Slatkine, 2009, pp. 55-56.
[12] Ibid., p. 57.
Pour citer cet article
Daniel Maggetti, « Fernand Chavannes ou l’invention d’un théâtre vaudois », Revue d’Historiographie du Théâtre numéro 3 [en ligne], mis à jour le 01/01/2017, URL : https://sht.asso.fr/fernand-chavannes-ou-linvention-dun-theatre-vaudois/