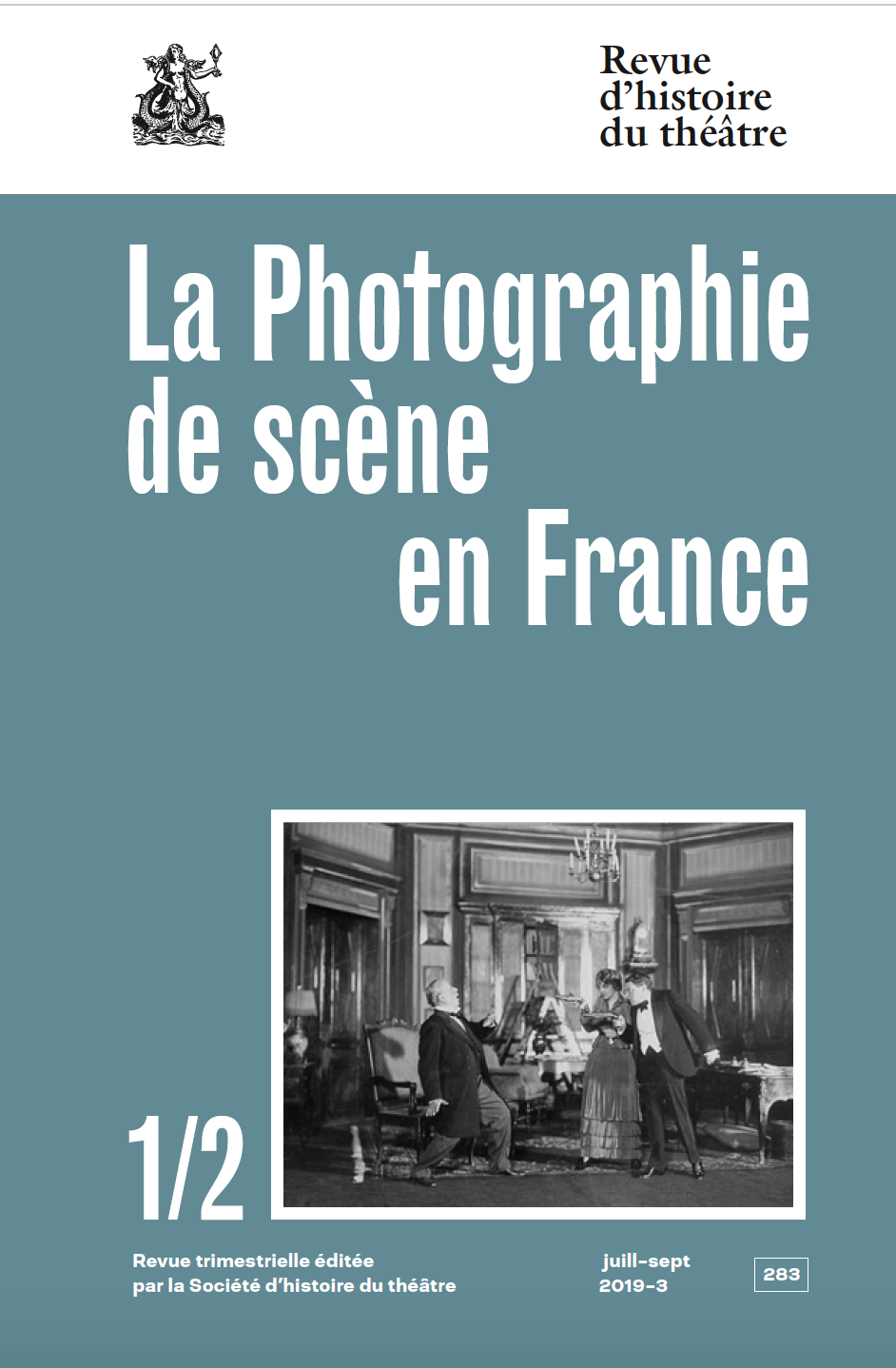Revue d’Histoire du Théâtre • N°283 T3 2019
Introduction : Photographier la scène. Le pari de l’impossible
Par Arnaud Rykner
Résumé
Saisir l’humain, dans la lumière, mais comme au seuil du réel, l’extraire de l’image, et faire apparaître ce qui sans le médium resterait invisible, sans doute est-ce le geste même qui unit théâtre et photographie, le continuum qui prolonge l’un dans l’autre, et rend possible l’improbable épiphanie. Certes, le miracle se produit rarement, sur scène comme sur le papier photographique. Mais un même effort rapproche les deux arts qu’on pourrait croire a priori antinomiques. Quelque chose apparaît dans la représentation théâtrale que l’acte photographique tente également de faire advenir ; quelque chose d’essentiel se joue, à l’articulation des deux pratiques, qui nous permet de mieux comprendre les enjeux et de l’une et de l’autre. C’est cette tension commune qu’il s’agit d’interroger ici, à la croisée de l’histoire du théâtre et de l’histoire de la photographie, de l’esthétique et des théories intermédiales, de la poétique et de l’archivistique, pour tenter de combler partiellement le manque actuel d’études documentées et illustrées consacrées à la photographie de scène en France.
Texte
La photographie de scène a souvent mauvaise presse dans les études théâtrales : au mieux, elle sert à illustrer des textes (c’est-à-dire à leur conférer un peu du prestige que l’image en général a tendance à leur voler depuis presque deux siècles) ; au pire, elle est regardée comme un document mensonger, incapable de rendre compte de la richesse et de la complexité d’une représentation. Le plus souvent pourtant, elle est accueillie avec indifférence, voire ostensiblement ignorée, comme elle peut l’être par les études photographiques qui ne lui ont pas accordé, jusqu’ici, plus d’intérêt. Objet impur, trace muette, immobile et plate, d’un art qui se déploie dans toutes les dimensions, parle, bouge, occupe tout l’espace du plateau voire de la salle, elle n’apparaît pas comme l’auxiliaire d’une véritable mémoire du théâtre, et encore moins comme un possible ferment créatif, qui nourrirait les imaginaires tout en rendant compte des processus du passé. Les reproches ainsi formulés à son égard sont encore plus vifs quand il s’agit de la photographie de scène des premiers temps, considérée – il faut le dire : parfois avec raison – comme peu inventive, stéréotypée, sinon mortifère. La photographie de scène n’aurait-elle rien à nous apprendre sur le théâtre, ni rien à lui apporter ? De manière symptomatique, c’est pourtant sur l’évocation d’une telle image que s’ouvre le premier des sept volumes d’écrits que Claude Régy a consacrés au théâtre et à ses propres mises en scène :
Je suis à la campagne. Avant de partir j’ai revu une photo. Depuis je la vois sans cesse. Une personne dans une lumière, Madeleine Renaud se tient là, sur un seuil, elle sort de scène, mais pas comme d’habitude on sort de scène, elle entre dans la salle, c’est son apparition au début de la deuxième partie de L’ Amante anglaise, en 1968, à la salle Gémier.[1]
Pourquoi Régy, l’un des plus radicaux metteurs en scène de la seconde moitié du XXe et du début du XXIe siècles, et l’un des artistes contemporains les plus attachés à la matière invisible du théâtre, choisit-il de commencer ainsi ses réflexions sur son art ? Lui qui laissa toujours entendre[2] que toute « captation » était littéralement insensée, comment put-il délibérément choisir une image, qui plus est figée comme la photographie, pour inaugurer le cycle qui pendant presque trente ans allait lui permettre de laisser une autre mémoire de son travail ? Faut-il s’étonner que l’image en question soit elle-même, pour ainsi dire, insaisissable, au point qu’il soit aujourd’hui sans doute impossible de la retrouver et de l’identifier avec précision[3]? S’agit-il d’une « photographie absolue », comme celle que Marguerite Duras évoque au début de L’Amant et qui, du fait même qu’elle n’a jamais été prise, est devenue le ferment de l’œuvre écrite.
À y regarder de plus près, tout est dit, en réalité, dans le petit paragraphe cité précédemment : « une personne dans une lumière […] sur un seuil […] sort de scène », « c’est une apparition ». Saisir l’humain, dans la lumière, mais comme au seuil du réel, l’extraire de l’image, et faire apparaître ce qui sans le médium resterait invisible, sans doute est-ce le geste même qui unit théâtre et photographie, le continuum qui prolonge l’un dans l’autre, et rend possible l’improbable épiphanie. Certes, le miracle se produit rarement, sur scène comme sur le papier photographique. Mais un même effort rapproche les deux arts qu’on pourrait croire a priori antinomiques. Quelque chose apparaît dans la représentation théâtrale que l’acte photographique tente également de faire advenir ; quelque chose d’essentiel se joue, à l’articulation des deux pratiques, qui nous permet de mieux comprendre les enjeux et de l’une et de l’autre.
C’est cette tension commune qu’il s’agit d’interroger ici, à la croisée de l’histoire du théâtre et de l’histoire de la photographie, de l’esthétique et des théories intermédiales, de la poétique et de l’archivistique, pour tenter de combler partiellement le manque actuel d’études documentées et illustrées consacrées à la photographie de scène en France. Un tel manque est d’autant plus étonnant que les fonds comprenant de tels clichés, eux, ne manquent pas. Qu’il s’agisse en effet des collections du département des Arts du spectacle de la BnF – le plus souvent utilisées comme réserve d’illustrations –, de celles du département des Estampes et de la Photographie de la même institution – quasiment jamais exploitées pour leurs photographies de scène pourtant nombreuses, notamment dans le fonds ancien –, de celles de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, dont le fonds de l’Association de la Régie Théâtrale permet de mieux comprendre certains usages pratiques de ces clichés, de celles de la Société française de photographie, de celles de la Théâtrothèque Gaston Baty, de celles du Musée d’Orsay ou de grands musées régionaux, voire de grands musées étrangers, innombrables sont les œuvres et documents qui restent à découvrir et commenter, en prenant en compte leur spécificité de photographies de scène.
Il est vrai qu’aborder un tel corpus et tenter de rendre compte de ses principaux enjeux, c’est s’aventurer d’abord sur un terrain instable, pour la traversée duquel il manque des pistes assurées, des chemins sinon battus du moins suffisamment fermes pour qu’on ne risque pas de s’y enliser. Qu’est-ce même qu’une «photographie de scène» ? Sur un plan purement pragmatique, il n’est pas toujours facile de déterminer si telle photographie représente des amateurs aimablement déguisés pour l’objectif ou des acteurs dont elle prétend fixer un moment du jeu dans une pièce donnée ; et, à supposer que ce dernier cas soit avéré (par une légende explicite ou par des informations extérieures, recueillies ou reconstituées), peut-on être sûr que le cadre dans lequel les sujets sont saisis est bien celui d’un plateau de théâtre et non celui d’un studio de photographe ? La frontière est parfois si ténue qu’on peut d’ailleurs se demander si la différenciation s’impose et change fondamentalement l’interprétation de l’image obtenue. Ce sont toutefois bien les clichés d’acteurs ou de groupes d’acteurs photographiés dans le cadre même d’une représentation théâtrale, même si ce cadre devra être plus précisément défini[4], que l’on s’attachera ici à étudier.
S’il faudra, pour commencer, faire une véritable généalogie (sinon une archéologie) de la photographie de scène (ce que tente un peu longuement notre propre article consacré aux débuts du genre), on peut toutefois remarquer dès à présent que cette dernière s’inscrit presque dès l’origine dans la continuité de la pratique du «tableau vivant», qu’il soit proprement scénique ou déjà photographique[5]. De fait, le tableau théâtral rêvé par Diderot avait eu pour conséquence de restructurer les compositions dramatiques à partir de l’organisation visuelle de la scène (chaque spectacle devant être conçu comme une succession de « tableaux » possibles, ceux-ci s’ajoutant aux « actes » dans les découpages de l’action, voire les remplaçant) ; le tableau vivant lui-même (qui fit florès sur les scènes européennes notamment à partir de la fin des années 1840, puis surtout autour des années 1890, c’est-à-dire au moment même où la photographie de scène commence à se systématiser) fit porter l’accent exclusivement sur la pulsion scopique ; enfin la photographie, de son côté, permit de fixer les compositions obtenues, dont elle se nourrit à ses débuts[6] et qui firent du théâtre un véritable paradigme de la photographie, bien avant que la photographie vraiment « instantanée » (prise sur le vif) ne favorisât « l’instant décisif » (Cartier-Bresson) aux dépens de « l’instant prégnant » (Diderot et Lessing, interprétés par Barthes). Mais, en même temps, la photographie de scène invite à surajouter une nouvelle découpe de l’action, non plus seulement en « tableaux » mais en courts moments à l’intérieur de chaque tableau, de chaque scène, voire de chaque séquence gestuelle, jusqu’à produire parfois une véritable décomposition graphique de l’action, qui semble appeler l’avènement du cinéma.
Dès lors, la photographie de scène s’inscrit à la fois dans une histoire de la photographie (à laquelle on verra qu’elle a largement contribué, y compris sur le plan technique) et dans une histoire du regard. C’est pourquoi elle participe de la «poussée du regard» dont parle Philippe Hamon[7], et répond à l’appétit visuel que décuplent les nouvelles images et les nouvelles modalités du voir. Aussi insiste-t-elle souvent sur les excès même de ce dernier, organisant le réel dans l’espoir de produire un maximum de visibilité, et faisant spectacle de tout. Renzo Guardenti montre, dans les pages qui suivent, comment elle bouscule l’idée de théâtralité, tout en remettant en question la fiabilité des « documents » qu’elle est supposée produire. Pour les mêmes raisons, mais à partir d’un corpus très précis et supposé bien connu, Mireille Losco-Lena prouve que le travail d’Antoine ne peut être apprécié sans une véritable critique des photographies produites à partir de ses spectacles. Elizabeth Emery, quant à elle, rend justice à la production d’Henri Mairet qui, comme Paul Boyer et au même moment que lui, contribue à faire de la photographie de scène une véritable discipline, à même d’innerver en profondeur et les publications sur le théâtre, et le théâtre lui-même. Elle nous rend par là-même conscients du rôle et de la place de l’« opérateur » (terme originellement utilisé pour désigner le photographe), dont le nom est trop souvent sacrifié aux dépens du seul titre du spectacle ou du nom des comédiens photographiés, comme si sa tâche ne consistait qu’à enregistrer le réel. De son côté, Romain Piana propose une analyse des photographies de la création d’Occupe-toi d’Amélie !, en 1908 aux Nouveautés, reproduites dans la revue Le Théâtre ; il montre d’une part comment y alternent scènes et tableaux, d’autre part comment ces clichés répondent largement à l’objectif de la revue, qui vise à documenter et même à « fixer la tradition » de chaque spectacle grâce à la photographie. L’existence d’une dernière photographie, qui ne répond en revanche pas à ce qu’on connaît de cette création permet de montrer à la fois les limites de l’exercice, et la marge d’imaginaire que cette pratique laisse ouverte. De même, Sophie Lucet, s’appuyant sur plusieurs clichés de Jean Larcher, à l’occasion de la création par Firmin Gémier du 14 juillet de Romain Rolland, en 1902, insiste sur la complexité du rapport existant entre l’artefact photographique et l’original théâtral. Le paradoxe est, notamment, que c’est peut-être la photographie la plus soigneusement posée, la plus synthétique et la moins « fidèle » en un sens, qui rend le mieux compte de l’art du metteur en scène et de la portée du spectacle.
À la fin de la période envisagée dans ce premier volume, il apparaît évident que, moins la technique est un problème, plus elle devient une alliée pour les photographes comme pour les metteurs en scène qui, directement ou non, tirent profit de la photographie. On verra dans un second volume que, d’une certaine manière, le visible lui-même tendra à perdre, au fil des ans, un peu de sa vigueur. La photographie de scène pourra se faire chaque fois plus attentive à des images moins spectaculaires mais souvent plus suggestives, à des «atmosphères», et plus généralement aux prolongements poétiques et imaginaires de la photographie.
Ce qui est sûr, c’est que par sa nature même autant que par son sujet, la photographie de scène se situe aux carrefours de pratiques parfois contradictoires, parfois complémentaires : regardant autant du côté de l’art que du côté du document ou de celui des médias, elle apporte au théâtre ses ressources et ses qualités propres, ne serait-ce que son silence qui nous incite à être attentifs à d’autres dimensions de la représentation scénique. Paradoxale, impure, parfois incompréhensible (que voit-on lorsqu’on regarde une telle photo ?), elle n’a de cesse de fasciner et de nous retenir au moment même où nous serions prêts à la rejeter en bloc pour revenir aux mouvements, aux bruits, et à l’odeur des planches, dont elle conserve et active, en dépit de tout, le souvenir.
| Arnaud Rykner
Notes
[1] Claude Régy, Espaces perdus, Paris, Plon, collection « Carnets », 1991, p. 13 (rééd. Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 1998, p. 15).
[2] Du moins avant qu’Alexandre Barry tente l’impossible en filmant quelques-uns de ses spectacles. On notera malgré tout une exception notable : le film que Didier Goldschmidt tira du Criminel, dans la mise en scène de Claude Régy, en 1988. Mais de manière significative, sans doute, ce film est en réalité une forme de recréation, sous le regard de Régy même, et dans un autre espace que celui où le spectacle se joua.
[3] Voulant en effet reproduire le cliché en question, nous nous sommes trouvé confronté à une forme de vrai mystère. Si Claude Régy lui-même n’a pu nous aider à retrouver cette photographie, Marie-Madeleine Mervant-Roux nous a très gentiment communiqué un document trouvé dans les archives des Ateliers Contemporains, à l’époque de la rédaction du volume des Voies de la création théâtrale sur le metteur en scène. Après quelques recherches, nous avons pu identifier ce document comme la page 191 du livre de Joël Le Bon (dir.), Barrault Renaud. Paris, notre siècle, Paris Éditions de Messine, [1982]. D’une part, la table des crédits photographiques dudit livre ne mentionne pas de p. 191 (ce qui n’est manifestement, en soi, qu’une coquille, puisque p. 192, en revanche, est indiquée une photographie de Roger Pic qui devrait être celle reproduite), d’autre part et surtout, le cliché ainsi crédité n’est manifestement pas de Pic, ni même de Cande, bien que chacun d’eux ait fait un reportage bien documenté sur le spectacle (ce qui a conduit M.-M. Mervant-Roux à en reproduire de son côté un autre, approchant, mais pas identique) : en réalité, aucun cliché de ces séries (ni de la reprise de 1982 pour Pic) ne correspond à celui possiblement utilisé par Claude Régy pour amorcer sa réflexion : soit M. Renaud est trop loin, soit ses pieds n’ont pas la même position, soit la chaise n’est pas exactement à la même place dans le plan, et, surtout, a aucun moment le visage de l’actrice n’est éclairé comme il l’est sur la photographie du livre de 1982, au moment où elle franchit le seuil de la scène (ses traits ne sont en pleine lumière qu’une fois qu’elle est arrivée à la chaise). Tout ceci ne serait qu’anecdotique s’il ne s’agissait à la fois d’une photographie séminale et d’une actrice qui, comme le dit Claude Régy, apparaît (la planche contact de Roger Pic, même s’il ne s’agit pas des « bons » clichés, a l’immense intérêt de décomposer son franchissement du seuil et sa manière de s’arracher lentement à l’obscurité, tout en restant pour ainsi dire entre deux mondes) : elle n’est ni tout à fait là, ni tout à fait absente, véritable figure (silhouette, fantôme) à la Henry James (The Figure in the carpet), comme la photographie d’Espace perdus elle-même, et peut-être comme toute photographie de théâtre…
[4] Dans le catalogue de nombreux fonds, ou dans les légendes manuscrites portées au dos de certains clichés, y compris à la Bibliothèque nationale de France, on trouve ainsi souvent des mentions suggérant que telle ou telle photographie a été prise pendant une représentation de tel spectacle. On verra qu’au moins avant les années 1950 ce n’est en réalité jamais le cas. Si de nombreux clichés sont bien pris sur scène (d’où l’appellation que nous adoptons par commodité), ils le sont généralement dans le cadre d’une séance photographique ou d’une répétition supposant, du moins dans les soixante premières années, des moments de suspens plus ou moins longs, voire des poses spécifiques.
[5] Voir Bernard Vouilloux, Le Tableau vivant. Phryné, l’orateur et le peintre, Paris, Flammarion, coll. « Idées et recherches », 1982 ; Arnaud Rykner, Pantomime, tableau vivant et autres images pas sages suivi de Note sur le dispositif, Paris, Orizons, 2014 ; Julie Ramos (dir.), Le Tableau vivant ou l’image performée, Paris, INHA/Mare & Martin, 2014.
[6] Voir Quentin Bajac, Tableaux vivants. Fantaisies photographiques victoriennes (1840-1880), Paris, RMN, 1999 ; Lori Pauli (dir.), La Photographie mise en scène – Créer l’illusion du réel, Londres/New York, Merrell/Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa, 2006 ; Christine Buignet et Arnaud Rykner (dir.), Entre code et corps. Tableau vivant et photographie mise en scène, revue Figures de l’art, № 22, 2010.
[7] Philippe Hamon, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris, José Corti, 2001, p. 7.
Pour citer cet article
Arnaud Rykner, « Introduction : Photographier la scène. Le pari de l’impossible », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 283 [en ligne], mis à jour le 01/03/2019, URL : https://sht.asso.fr/introduction-photographier-la-scene-le-pari-de-limpossible/