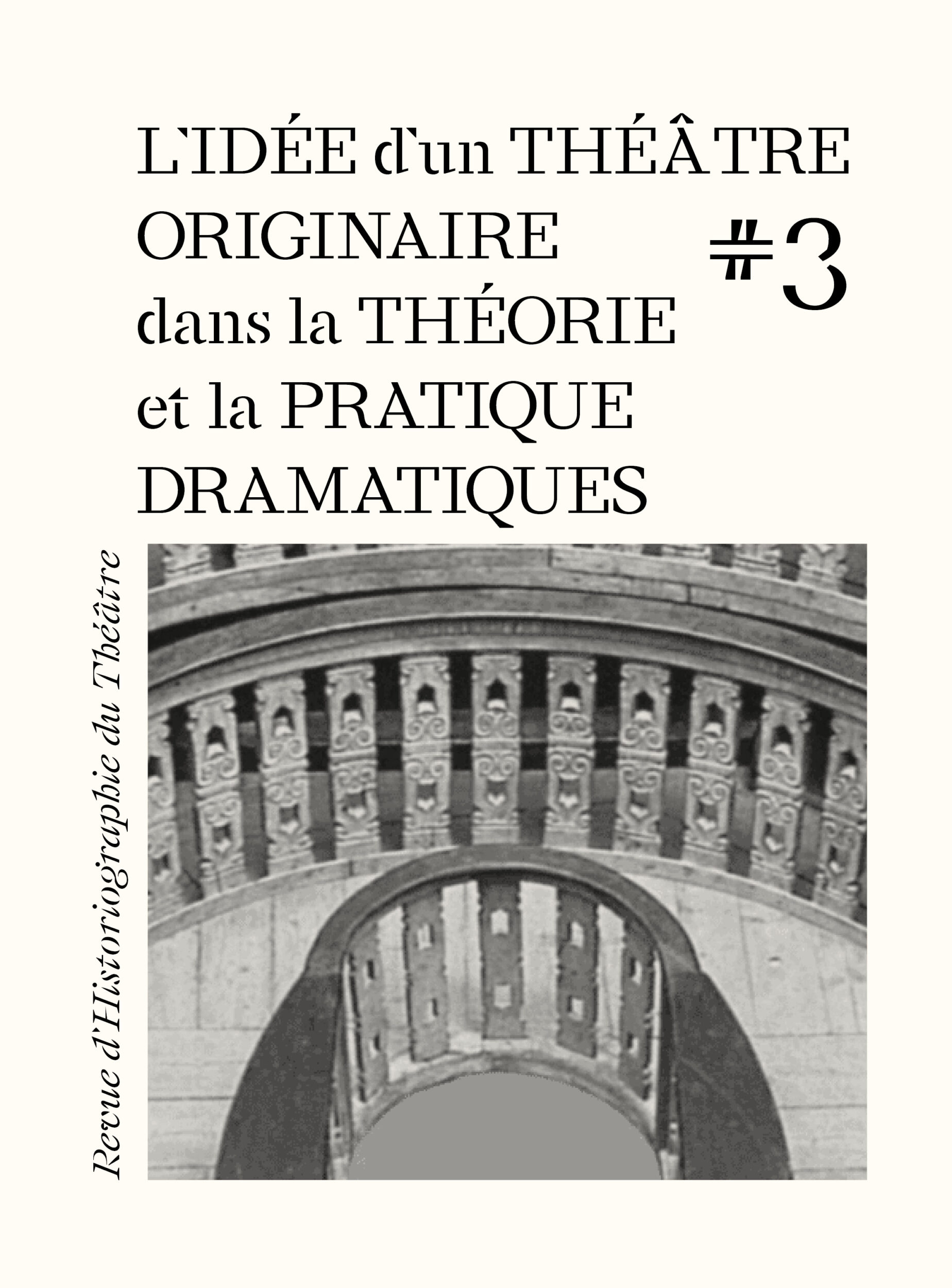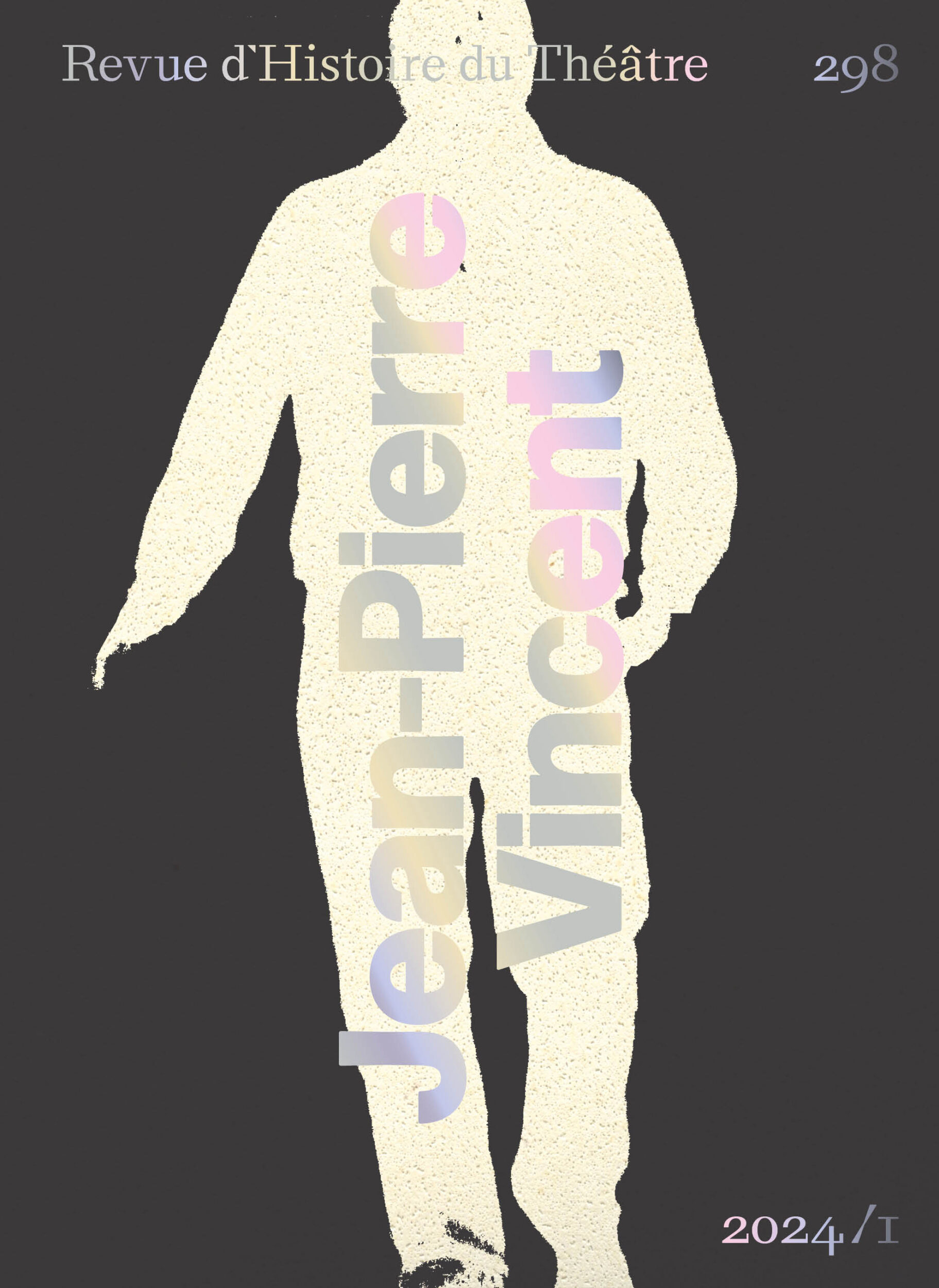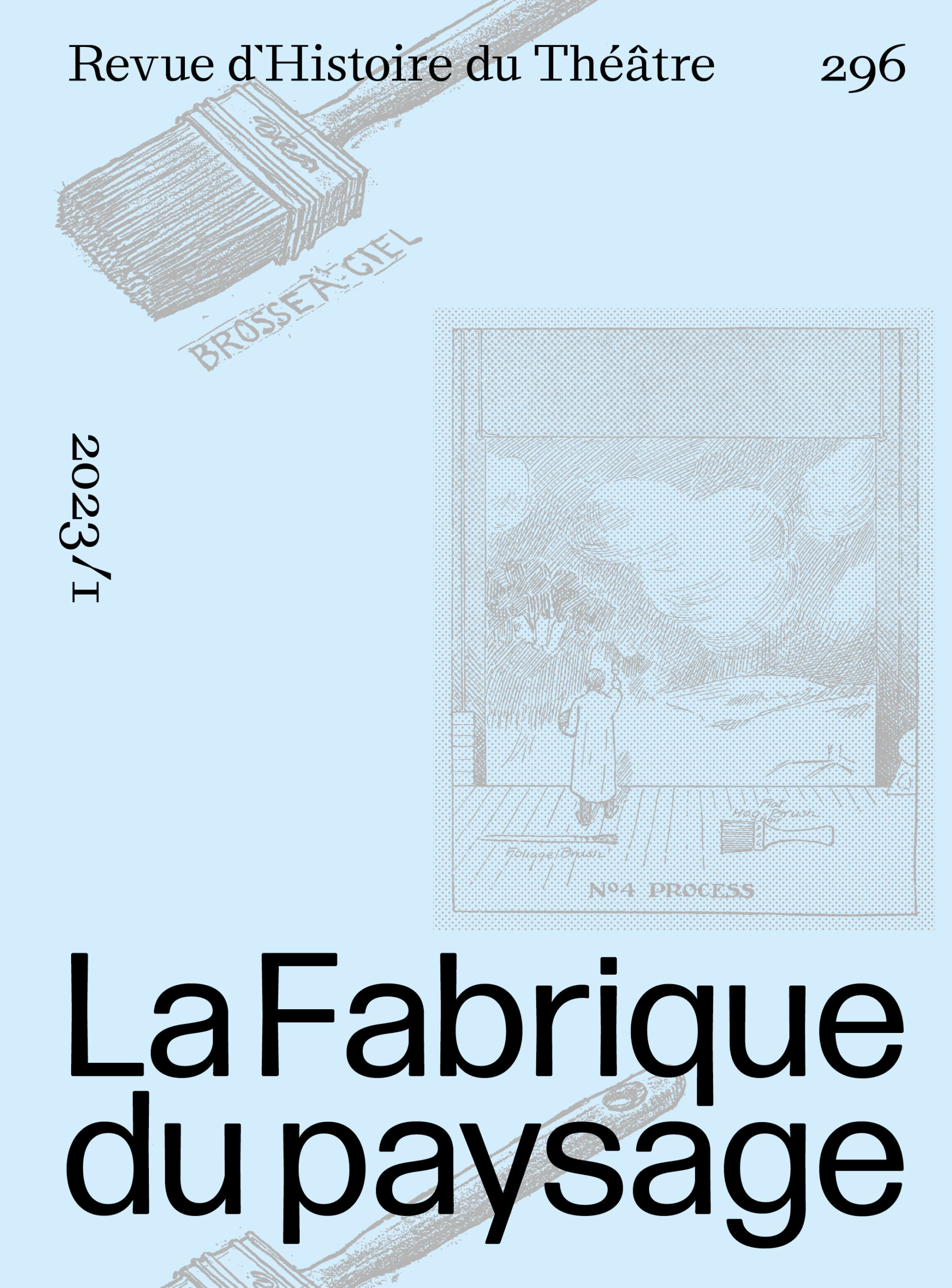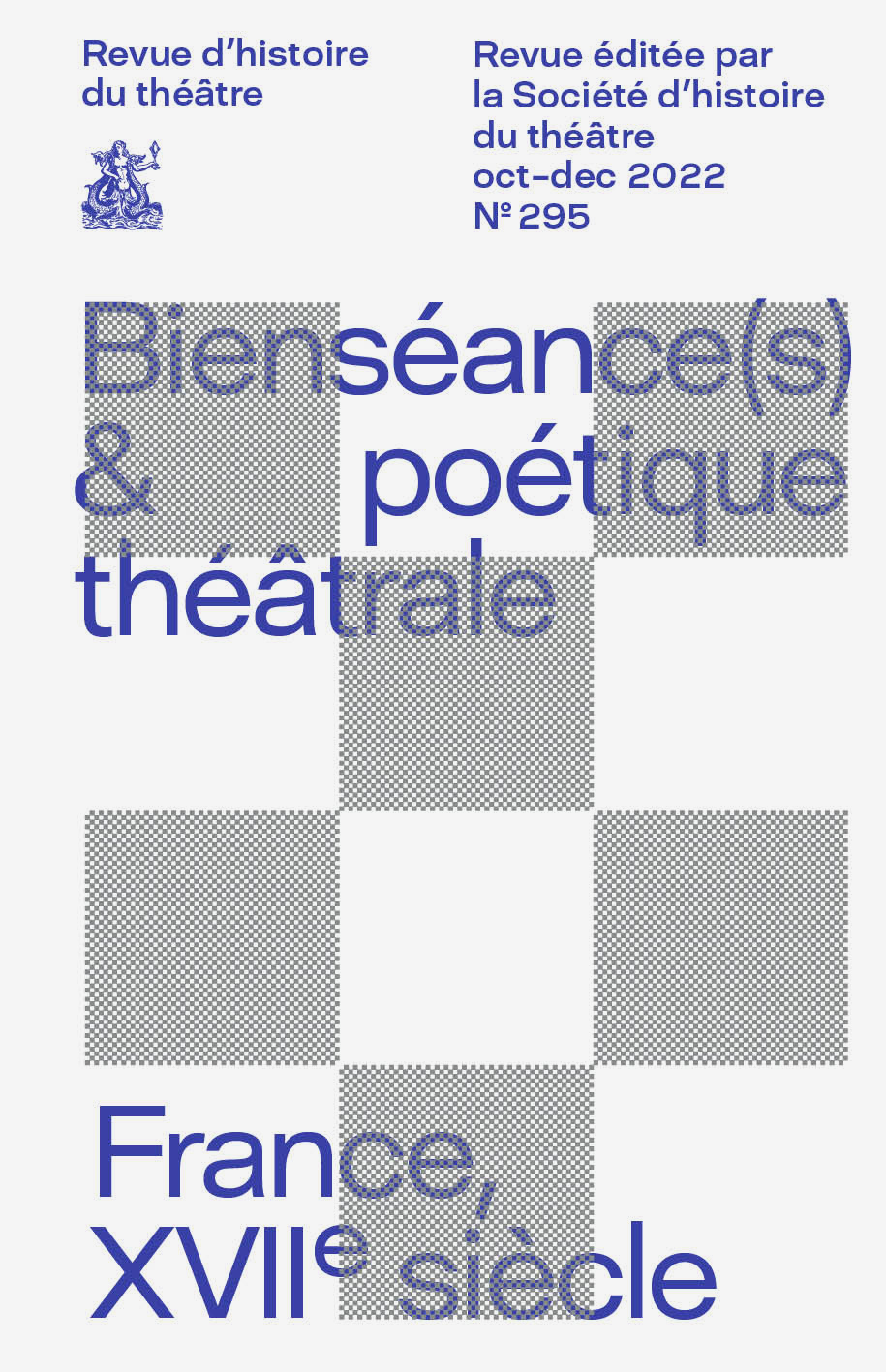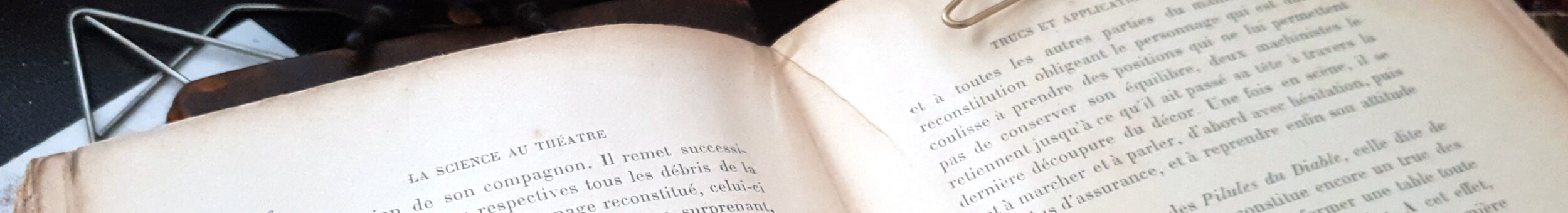Revue d’Historiographie du Théâtre • N°3 T1 2017
La « couronne du roi posée de travers » – sur la notion d’origine dans la pensée théâtrale de Walter Benjamin
Par Romain Jobez
Résumé
Dans l’Origine du drame baroque allemand, Walter Benjamin introduit le concept d’histoire-nature (Naturgeschichte), qui apparaît également au sein du projet des Passages parisiens, où Benjamin caractérise notamment l’expérience fondamentale de la modernité. L’article montrera comment la notion d’origine, « catégorie tout à fait historique, [qui] n’a pourtant rien à voir avec la genèse des choses », permet à Benjamin de penser l’idée d’un genre dramatique (le Trauerspiel) inscrit dans la temporalité tout en en étant détaché.
Abstract :
In the Origin of German Tragic Drama, Walter Benjamin introduces the concept of the natural history of history (Naturgeschichte), which is also central to his Arcades Project, in which he characterizes, notably, the fundamental experience of modernity. This study examines how the notion of origin —“an entirely historical category, [having], nevertheless, nothing to do with genesis”— allows Benjamin to conceive of a dramatic genre (the Trauerspiel) that is embedded within time even while being disconnected from it.
Texte
La « couronne du roi posée de travers »
| sur la notion d’origine dans la pensée théâtrale de Walter Benjamin
Réfléchir sur la notion d’origine du théâtre à partir de la pensée de Walter Benjamin est tâche ardue, surtout si l’on considère que l’œuvre de ce dernier est demeurée inachevée et fragmentaire. Généralement, ses exégètes cherchent à en dégager la cohérence théorique sans nécessairement faire le lien avec les objets d’étude nombreux et variés auxquels Benjamin a pu consacrer sa réflexion (Baudelaire, Proust, les passages parisiens, l’histoire de la photographie, etc.). Ainsi, dans le cas précis de l’Origine du drame baroque allemand (Ursprung des deutschen Trauerspiels), c’est la « Préface épistémo-critique », d’une redoutable abstraction, qui retient avant tout l’attention des commentateurs de l’ouvrage. Bien que Benjamin y donne une définition du concept d’origine, lui-même conseillait de l’étudier après avoir lu le reste de son livre[1]. Or ce n’est pas le parcours qu’en firent ses premiers lecteurs qui se recrutèrent dans le milieu universitaire. En effet, l’Origine du drame baroque allemand, avant sa parution en 1928, avait été soumis comme thèse d’habilitation à l’université de Francfort. L’un de ses rapporteurs s’exprima d’ailleurs de façon très critique sur ce travail académique, déplorant notamment le niveau d’abstraction de sa méthode et l’obscurité de ses concepts, ce qui contraignit Benjamin dès la fin de l’été 1925 à renoncer définitivement à toute carrière universitaire, avec les conséquences que l’on connaît pour la suite de son existence[2]. Pourtant, l’un des mérites éclatants quoique souvent ignoré de l’Origine du drame baroque allemand consiste dans la réhabilitation d’un genre théâtral alors tombé dans l’oubli et constitué par un corpus d’une quinzaine de pièces à peine, écrites par des auteurs de langue allemande vivant au XVIIe siècle en Silésie. Au reste, la traduction française du vocable original Trauerspiel par le « drame baroque allemand » rend insuffisamment justice à sa spécificité.
Or, dès la préface de son livre, Benjamin s’inscrit en faux contre « le caractère prétendument non-scénique de ce théâtre[3] » injustement considéré selon lui comme « une caricature de la tragédie antique[4]. » Il met ainsi en avant « le théâtral qui s’exprime […] avec une force particulière » dans des pièces centrées sur des « actions violentes[5] » qu’« un goût éclairé » ne pouvait que rejeter en raison de leur caractère de prime abord « déconcertant », voire « barbare[6] ».
La critique littéraire positiviste du XIXe siècle avait en effet condamné le Trauerspiel pour son irrégularité en lui opposant le modèle originel de la tragédie grecque dont elle voyait le prolongement dans le classicisme allemand et, plus généralement, le théâtre des Lumières. Chacun s’accordera aujourd’hui à considérer cette conception de l’historiographie théâtrale comme dépassée ; elle explique cependant que la lecture de l’ouvrage de Benjamin se soit arrêtée uniquement sur la partie théorique, alors que c’est au cœur de l’objet concret de son étude que se lit véritablement l’intérêt qu’il portait à la notion d’origine. Car la compréhension de ce concept et de ses implications philosophiques, y compris dans le champ théâtral, passe nécessairement par une relecture de l’Origine du drame baroque allemand à partir de son objet premier, d’autant plus que celui-ci, dans sa singularité, entretient un rapport privilégié à la temporalité historique. En retour, la réflexion de Benjamin sur le théâtre permet d’éclairer la portée théorique de sa philosophie de l’histoire. Enfin, plus directement, c’est l’origine même de l’Origine du drame baroque allemand qui ouvre un chemin d’accès privilégié à la pensée théâtrale de son auteur.
Dans les premiers mois de l’année 1915, Benjamin se rend à Genève en compagnie de sa future femme Dora Pollack pour rendre visite à son ami d’enfance Herbert Blumenthal qui s’était exilé en Suisse au début de la Première Guerre Mondiale[7]. Il assiste alors très probablement à une représentation du Cid donnée à la Comédie de Genève, installée depuis janvier 1913 dans le théâtre construit à l’initiative de son directeur et fondateur Ernest Fournier et qu’elle occupe encore aujourd’hui. Benjamin revient en 1938 sur cette représentation dans le contexte de ses « Conversations avec Brecht » alors que le metteur en scène a fui au Danemark le régime nazi :
Brecht parle du théâtre épique ; il mentionne le théâtre d’enfants, où les fautes de jeu, fonctionnant tels des effets de distanciation, donnent des traits épiques à la représentation. Avec le cabotinage, selon lui, peuvent se produire des choses semblables. Il me vient à l’esprit la mise en scène genevoise du Cid où, voyant la couronne du roi posée de travers, j’eus la première inspiration de ce que, neuf ans plus tard, j’ai couché sur le papier dans le livre sur le Trauerspiel[8].
Le critique du Journal de Genève confirme l’impression apparemment médiocre laissée par la mise en scène du Cid dans le souvenir de Benjamin. S’il salue les « heureuses innovations […] apportées à la simplification du décor » dans le style du Vieux-Colombier (et Jacques Copeau viendra d’ailleurs travailler au printemps 1916 à la Comédie de Genève), il est plus réservé quant aux acteurs, regrettant un « certain petit bonnet […] presque ridicule » porté par l’interprète du rôle-titre à qui il souhaiterait « des jambes plus musclées[9]. » Par ailleurs, il estime que le comédien jouant le roi de Castille « n’a pas paru très à son aise : le répertoire tragique n’est point son fait[10]. » Malgré tout, ces maladresses prennent un sens a posteriori dans la pensée théâtrale de Benjamin puisqu’il les rapproche du gestus brechtien : la couronne maladroitement posée de travers sur la tête de l’acteur Desormes procède d’une mise à distance involontaire du personnage dans la façon de le jouer, ce qui remet ainsi en cause sa royale dignité. Or le questionnement de la souveraineté par l’intermédiaire de la représentation théâtrale est précisément l’objet des pièces étudiées dans l’Origine du drame baroque allemand[11]. Dans ces dernières, les personnages principaux apparaissent en effet soit sous les traits de martyrs dépouillés des attributs de leur pouvoir monarchique, soit sous ceux de tyrans en proie aux plus violents affects. Ainsi, dans les deux cas, l’apparition en scène du souverain témoigne de sa « régression vers l’état de simple créature[12]. » Le roi baroque est donc « seigneur des créatures, mais il reste créature[13]. » Au contraire du héros de la tragédie grecque qui parvient à s’élever en lui-même en affrontant les dieux, le protagoniste du Trauerspiel s’avère être un « héros non tragique ». Benjamin emploie ce terme dans le contexte de sa réflexion sur la dramaturgie brechtienne en laquelle il voit l’illustration la plus récente de la « recherche d’un héros non tragique[14] ». À partir de cette dramaturgie, il reconsidère l’histoire du théâtre comme « un discret sentier de contrebande par lequel vint jusqu’à nous, en coupant à travers le massif sublime mais infécond du classicisme, l’héritage du drame médiéval et baroque[15]. » Benjamin voit dans le théâtre brechtien la résurgence d’une forme originaire fondée sur la distance au personnage qui formait l’essence du Trauerspiel. Il propose donc une histoire alternative du théâtre allemand qui ne commencerait pas avec les Lumières, auxquelles il reproche notamment d’idéaliser le personnage à travers la figure du héros tragique.
En considérant que le théâtre allemand du XVIIIe siècle est une exception historique, Benjamin rejette le modèle dramaturgique que Peter Szondi définira plus tard par le terme de « drame absolu » et qui consiste en la résolution d’un conflit interpersonnel à travers le dialogue dans un système de représentation clos sur lui-même[16]. Ce rejet l’amène en retour à mettre en avant dans sa pensée théâtrale le modèle épique de Brecht. Il en trouve d’ailleurs paradoxalement les prémices dans le théâtre français du XVIIe siècle :
La scène classique des Français ménageait parmi les acteurs une place aux personnes de condition, qui avaient leur fauteuil sur cette scène ouverte. Ce dispositif nous semble, à nous, déplacé. Conformément au concept de drame auquel le théâtre nous a habitués, il nous semblerait pareillement déplacé de voir un tiers assister aux événements scéniques sans participer, comme un observateur lucide, « pensant »[17].
Au moment de la rédaction de l’Origine du drame baroque allemand, Benjamin s’intéresse particulièrement aux contemporains français des dramaturges silésiens qu’il étudie, comme en témoigne une lettre adressée à Hugo von Hofmannsthal : « Je songe parfois à un travail sur la tragédie française qui serait l’homologue de mon livre sur le Trauerspiel. À l’origine j’avais eu l’idée de développer dans cet ouvrage le contraste que font l’un avec l’autre le Trauerspiel allemand et français[18]. » Dans cette perspective, on peut légitimement parler d’une origine française de son ouvrage, laquelle s’explique en réaction à l’historiographie théâtrale dominante à son époque qui ignore largement l’existence du Trauerspiel[19]. Les universitaires qui se sont opposés à la pensée de Benjamin considèrent en effet que l’histoire du théâtre allemand commence avec la constitution à l’époque des Lumières d’une littérature nationale qui s’attaque au modèle encore largement répandu dans l’Europe du début du XVIIIe siècle de la dramaturgie classique représenté par des auteurs comme Corneille et Racine. Ainsi, Benjamin établit un parallèle implicite entre l’oubli par l’histoire du théâtre du Trauerspiel et le rejet de la tragédie du Grand Siècle par les dramaturges allemands des Lumières. Tandis que Corneille est la cible des critiques de Lessing dans sa Dramaturgie de Hambourg, Racine est l’objet d’une réception complexe et contradictoire chez Schiller. En effet, les considérations de Schiller sur l’esthétique de la tragédie contrastent avec sa traduction de Phèdre en vers blancs. À travers elle, il cherche à atténuer l’effet produit par le théâtre français tel qu’il l’analyse dans l’essai Sur le pathétique :
Le ton glacial de la déclamation étouffe toute vraie nature, et la décence adulée par les tragédiens français leur rend totalement impossible le dessin de l’humanité dans sa vérité. […] Il nous est difficile de croire du héros d’une tragédie française qu’il souffre car il s’épanche comme le plus calme des hommes et l’incessante prise en compte de l’impression qu’il fait sur les autres ne lui permet jamais de laisser libre la nature en lui[20].
Dans ses travaux sur les versions allemandes des pièces de Racine, Alexander Nebrig a montré les difficultés rencontrées par les traducteurs pour rendre le ton propre à la haute tragédie et qui relève de la « tristesse majestueuse » dont parle le dramaturge dans la préface de sa Bérénice[21]. Sur le plan pratique, Schiller ne saisit pas que l’expression de cette tristesse passe justement par la déclamation propre à l’alexandrin. Cependant, il exclut à son tour ce « ton glacial de la déclamation » de son esthétique de la tragédie parce qu’il relève selon lui d’un pathétique auquel il manque le sublime en raison de la passivité du héros racinien. L’incompréhension dont fait preuve Schiller à l’égard de Racine débouche selon Nebrig sur la réécriture de Phèdre en drame plus destiné à la lecture (Lesedrama) qu’à la performance théâtrale. Mais cette incompréhension est également symptomatique d’un double glissement théorique : d’une part, elle procède de la dissociation, à partir du XVIIIe siècle, de la poétique de la tragédie et de la philosophie du tragique, telle que l’a observée Peter Szondi[22] ; de l’autre, elle témoigne d’un rejet en dehors de l’esthétique du théâtre de la notion de tristesse – qu’il convient par ailleurs de distinguer de celle de tragique. Le maintien de cette distinction s’avère en effet fondamental pour nous, car elle permet de comprendre la conception de la pensée théâtrale benjaminienne qui considère que Racine partage avec les dramaturges silésiens la même vision du monde empreinte de tristesse et étrangère à la temporalité tragique telle que la définit l’idéalisme allemand.
À Marc Sagnol revient le mérite d’avoir montré avec son ouvrage portant justement le titre de Tragique et tristesse l’importance de ces deux notions concurrentes en fournissant avec elles une clé herméneutique essentielle de l’Origine du drame baroque allemand[23]. Pour Benjamin, un théâtre véritablement originaire entretient un rapport à la temporalité différent de celui de la progression historique dans laquelle s’inscrit habituellement la conception de l’historiographie théâtrale apparentée à une philosophie du tragique idéaliste. Afin de comprendre l’idée d’origine dans sa pensée théâtrale, il est donc nécessaire de s’intéresser à la signification des deux notions de tragique et de tristesse, telle que l’expose un paratexte du livre de Benjamin resté inédit de son vivant : l’essai intitulé « Trauerspiel et tragédie[24] ». L’auteur y mène une réflexion philosophique sur le temps et son rapport à l’histoire, laquelle relève dans sa perception empirique d’une temporalité « non remplie ». Benjamin oppose en effet à cette dernière le caractère de finitude du temps mécanique tel qu’il peut être mesuré par une horloge et qu’il définit comme « forme relativement vide dont il n’y a aucun sens à penser le remplissement[25]. » Seule une expérience métaphysique permet de saisir pleinement la temporalité historique, laquelle ne saurait être « rassemblée par aucun événement empirique[26]. » Afin d’expliquer cette gradation philosophique dans l’échelle de la temporalité, Benjamin a recours au théâtre : « Trauerspiel et tragédie se distinguent par la différence de leur position vis-à-vis du temps historique. Dans la tragédie le héros meurt parce que nul n’est capable de vivre dans le temps rempli[27]. » En revanche, tout autre est la qualité du Trauerspiel puisque son temps « n’est pas rempli, et pourtant il est fini. Il est non-individuel sans être d’une universalité historique. […] L’universalité de son temps est spectrale, non mythique[28]. » Sagnol précise cette différence temporelle en expliquant que « le Trauerspiel décrit le mouvement inverse de la tragédie[29]. » En effet, selon son analyse de la pensée benjaminienne, « la tragédie signifie l’émergence de l’histoire à partir du mythe » alors que « l’histoire succombe et devient nature » dans le Trauerspiel[30]. Par ailleurs, l’Origine du drame baroque allemand précise à son tour le caractère de finitude du temps propre à cette dernière forme théâtrale, laquelle repose sur « le spectacle sans cesse renouvelé de l’ascension et de la chute des princes » représentant « l’aspect naturel, essentiellement constant, du cours de l’histoire[31]. » Dès lors, sans possibilité de rédemption, hanté par les spectres des martyrs assassinés par les tyrans qui leur succèdent, le monde du Trauerspiel est celui de la tristesse (Trauer) où l’on ne peut avoir prise sur les événements historiques. Ce sentiment est consubstantiel à ce genre de théâtre : « Le nom de ce dernier signale déjà que son contenu éveille la tristesse chez le spectateur[32]. » Il s’agit donc d’un jeu (Spiel) « où la tristesse trouve son compte[33] ». Le Trauerspiel est donc plus proche du cours naturel de l’histoire, plus originaire que la tragédie dans son rapport déceptif à la temporalité, puisqu’il n’offre pas de possibilité de rédemption métaphysique à l’exemple de l’accomplissement du destin du héros, tel que l’analyse la philosophie du tragique développée par l’idéalisme allemand.
Par rapport à son essai sur « Trauerspiel et tragédie », Benjamin introduit dans l’Origine du drame baroque allemand le concept d’histoire-nature (Naturgeschichte), lequel marque une évolution de la définition du temps historique non rempli[34]. Il représente en effet une matérialisation de l’histoire suivant un cours naturel dont la maîtrise échappe aux hommes et qui nourrit la thématique du Trauerspiel, lequel est caractérisé par la « destruction de l’éthos historique »[35], soit la capacité à donner un sens aux actions du héros de la tragédie. Le Trauerspiel a donc recours à « une métaphorique qui assimile les faits historiques à des événements naturels[36]. » En outre, on retrouve le concept d’histoire-nature ailleurs dans la pensée de Benjamin, et notamment au sein du projet des Passages parisiens, où il caractérise l’expérience fondamentale de la Modernité[37].
C’est donc au sein de ces multiples ramifications philosophiques que prend place la notion d’origine telle que l’expose Benjamin dans la « Préface épistémo-critique » de son l’Origine du drame baroque allemand. Cette dernière relève d’une vaste réflexion sur la connaissance restée à l’état fragmentaire, aux implications dépassant largement le cadre de leur objet d’étude initial. En effet, contre l’idéalisme allemand représenté par le kantisme, Benjamin défend une théorie des idées inspirée de Platon et de la monadologie leibnizienne[38]. Dans le contexte plus restreint des études littéraires, l’auteur développe également une théorie des genres lui permettant de définir de manière dialectique leur caractère historique[39]. À travers son origine, « catégorie tout à fait historique, [qui] n’a pourtant rien à voir avec la genèse des choses »[40], le genre d’une œuvre s’inscrit dans la temporalité tout en se détachant de celle-ci :
Ce sont précisément les œuvres significatives qui se situent en dehors des limites du genre, pour autant qu’elles ne l’inaugurent pas ou bien qu’elles le représentent quasi idéalement. Une œuvre significative : ou bien elle est le fondement du genre, ou bien elle en est la négation, et quand elle est parfaite, elle est les deux à la fois[41].
Un genre particulier comme le Trauerspiel, défini comme « œuvre significative », entretient donc un rapport étroit à la temporalité, notamment à travers l’histoire-nature dont il est issu et sur laquelle il offre un point de vue privilégié. Ainsi, à partir de ce dernier concept, le Trauerspiel devient une idée originelle du théâtre dans la théorie de la connaissance benjaminienne. Elle s’organise de manière dialectique en permettant de penser à son tour l’idée même d’origine du théâtre comme à la fois ancrée dans la temporalité historique et porteuse d’une réflexion sur cette dernière.
Si l’on veut bien suivre Benjamin dans sa démarche philosophique en prenant pour point de départ son travail sur le Trauerspiel, on voit que sa pensée permet de libérer le genre théâtral du déterminisme historique. En effet, l’origine en elle-même « n’émerge pas des faits constatés, mais […] touche à leur pré- et post-histoire[42]. » Or ce positionnement temporel du concept d’origine renvoie de nouveau à l’histoire-nature : « La pré- et post-histoire […] n’est pas une histoire pure, mais une histoire naturelle[43]. » Dès lors, dans la relation à la temporalité historique, la tragédie est seconde par rapport à l’histoire-nature du Trauerspiel. Jean-Michel Palmier explique de la façon suivante leur articulation : « Le Trauerspiel est un concept historique (ou philosophico-historique) avant d’être un concept dramatique ; le Trauerspiel présente le cas normal, la règle dont la tragédie constitue l’exception[44]. » Ce qui se conçoit ici d’un point de vue philosophique trouve une application concrète dans le domaine de la poétique théâtrale et nous invite à reconsidérer l’histoire de la tragédie, ce qui du reste est le cas dans de nombreuses études parues ces dernières années sur le sujet[45]. Comme on l’a dit, et comme l’a montré Marc Sagnol, Benjamin procède à une distinction fondamentale entre la tristesse (Trauer) et le tragique. En passant par la philosophie de l’histoire benjaminienne, nous avons vu que cette première catégorie esthétique était prédominante et qu’elle déterminait l’origine même de l’idée de théâtre qui se caractérise par le rapport naturel qu’il entretient avec la temporalité historique. On trouve une illustration convaincante de la théorie de Benjamin dans la tragédie classique du XVIIe siècle et, plus précisément, dans les pièces de Racine, si nous appliquons ces idées à ce corpus.
Parmi les œuvres raciniennes, Bérénice doit retenir particulièrement notre attention. Roland Barthes considère la pièce comme « un éloignement de la tragédie » car dominent en elle « le silence et la durée[46]. » Il défend donc une vision apparemment paradoxale de cette tragédie classique où « se rassemblent toutes les images d’une vie soumise à la puissance la plus anti-tragique qu’il soit : la permanence (solitude, ennui, soupir, errance, exil, éternité, servitude ou domination sans joie)[47]. » Cette appréciation par Barthes de Bérénice trouve une justification génétique exposée dans les travaux de Bénédicte Louvat et Georges Forestier : la tragédie régulière est fille de la pastorale[48]. Elle en adopte le ton élégiaque ainsi que l’a précisément démontré Marie-Claude Châtelain dans le cas de Bérénice où Racine, en reprenant des passages entiers des Héroïdes d’Ovide, fait de l’héroïne une nouvelle Didon qui s’adresse à Titus en successeur d’Énée[49]. Par rapport à la pastorale, dont le nœud de l’intrigue repose sur « un oxymore, celui des amants séparés quelques heures après s’être unis[50] », selon l’expression de Bénédicte Louvat au sujet de La Sophonisbe de Mairet et de sa relation à Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau, la pièce de Racine se fige sur le moment de la séparation. Or il s’agit, dans cette « tragédie de l’aphasie[51] », telle que Barthes qualifie Bérénice, d’en arriver à la rupture définitive en prononçant les mots qui concluent la séparation. Cependant, la déploration élégiaque de l’amour impossible et déjà perdu recule d’autant plus cet instant fatidique dans lequel Lucien Goldmann voit un trait fondamental de pièces de Racine : « les tragédies raciniennes d’Andromaque à Phèdre se jouent en un seul instant : celui où l’homme devient réellement tragique par le refus du monde et de la vie[52]. »
Goldmann formule son analyse dans le cadre de l’étude de la « vision tragique » de Pascal qu’il trouve illustrée dans la tragédie racinienne. Pour Marc Sagnol, cette notion est apparentée à celle de la Trauer dans la pensée théâtrale de Benjamin car elle relève de « la conscience de la tristesse de la vie réelle[53]. » Par ailleurs, Marc Sagnol met en évidence un autre rapprochement possible entre l’Origine du drame baroque et l’ouvrage de Goldmann, Le Dieu caché, qui se trouve dans la référence commune aux Pensées pascaliennes. Elle amène, toujours d’après Sagnol, à la « prise de conscience que le monde est un Trauerspiel [qui] conduit à un refus tragique du monde et au refuge dans le monologue[54]. » Si la déploration trouvant son expression dans la « tristesse majestueuse » est de l’ordre de la Trauer, le mutisme et les aposiopèses de Titus relèvent du tragique car ce personnage est pour Goldmann « pleinement conscient de la réalité, de ses problèmes, de ses exigences, et de l’impossibilité des les concilier[55]. » Ainsi, le « caractère anti-tragique[56] » de Bérénice observé par Barthes rapproche la tragédie classique du Trauerspiel dans une vision du monde partagée. En revanche, tous deux se séparent en parcourant un chemin opposé sur le « sentier de contrebande[57] » de l’historiographie théâtrale renouvelée. Alors que la tragédie classique est issue de la pastorale, le Trauerspiel y retourne. En effet, pour Benjamin, « ce n’est pas l’antithèse de la nature et de l’histoire, mais la sécularisation radicale des faits historiques qui a le dernier mot dans cette fuite hors du monde de l’époque baroque » représentée par la pastorale[58]. Cette dernière développe l’idéal d’un « paradis intemporel[59] » en réponse à la prise de conscience de la finitude de l’histoire-nature dans le Trauerspiel qui s’apparente, selon l’expression de Barthes, à la « permanence[60] » de Bérénice.
Dans l’ordre théâtral originaire, la tragédie commence là où le Trauerspiel s’achève. Mais ce commencement est paradoxal puisqu’il aboutit au silence du héros tragique. Ce dernier prend en effet conscience de la tristesse du monde, puis médite silencieusement sur la solitude de la condition humaine. Dans l’Origine du drame baroque allemand, Benjamin reprend cette dernière idée de L’Étoile de la rédemption (1921) de Franz Rosenzweig[61]. Par la suite, en rapprochant ces deux penseurs juifs dans son ouvrage Le langage et la mort, Giorgio Agamben reviendra sur les enjeux éthico-philosophiques de la parole et de son défaut dans la tragédie grecque[62]. Ces considérations renvoient à la posture critique fondamentale du théâtre originaire que, selon nous, Schiller n’a pas comprise dans son appréciation esthétique de la tragédie classique. Il témoigne une nouvelle fois de son incompréhension à l’égard de celle-ci dans son essai « Sur l’art tragique » :
Toutes les fois que le narrateur met en avant sa propre personne, il en résulte un arrêt dans l’action et donc inévitablement aussi dans notre affect participant ; ceci a même lieu lorsque le poète dramatique s’oublie dans le dialogue et met dans la bouche des personnages parlants des considérations que seul un froid spectateur aurait pu livrer. Pas une, sans doute, de nos plus récentes tragédies ne devrait échapper à ce défaut, mais seules les tragédies françaises en ont fait une règle[63].
Il est intéressant de constater que Schiller formule ses objections à l’encontre de la dramaturgie classique à partir de termes préfigurant le théâtre épique (l’attitude d’un « narrateur [qui] met en avant sa propre personne » est adoptée par « le poète dramatique [qui] s’oublie dans le dialogue » et s’adresse ainsi à « un froid spectateur »). Ce faisant, il condamne l’idée d’un « héros non tragique » sur laquelle Benjamin voulait construire son histoire alternative du théâtre qui lie donc Trauerspiel et tragédie classique à l’œuvre de Brecht. Or ces différents genres théâtraux entretiennent une même relation originelle, sans possibilité de rédemption métaphysique inhérente à l’intrigue, à la temporalité historique qui est justement le propre de la conception d’un théâtre originaire dans la pensée benjaminienne.
La posture critique adoptée par une forme théâtrale originaire face à l’histoire ne saurait bien sûr être dissociée de la question de la représentation, laquelle nourrit une grande part de la réflexion menée par Benjamin dans l’ensemble de son œuvre. Dans le cas précis de l’Origine du drame baroque allemand, le fonctionnement allégorique du Trauerspiel permet de saisir la qualité particulière de sa temporalité empreinte de tristesse (Trauer) : « L’histoire, dans sa moralité exemplaire et ses catastrophes, n’était considérée que comme un moment matériel de l’emblématique[64]. » Aux proliférantes métaphores qui signifient à l’infini l’ascension et la chute des monarques s’ajoutent les figures allégoriques des intermèdes choraux qui dépeignent l’incessant combat des vices et des vertus, matérialisant en fin de compte le cours de l’histoire-nature tel qu’il est représenté dans les pièces des auteurs silésiens étudiées par Benjamin[65]. La métaphorique du Trauerspiel permet donc de saisir la temporalité historique à partir de son origine, laquelle « ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin[66]. » Une telle forme de représentation de l’histoire trouve d’autres concrétisations dans les multiples ramifications de la pensée benjaminienne, notamment sous les traits de l’« image dialectique » telle qu’elle est définie dans son ouvrage inachevé sur les Passages parisiens[67]. Cette dernière, en sa qualité de « relation de l’Autrefois avec le Maintenant », fonctionne comme une « image » illustrant « la dialectique à l’arrêt[68] » de la temporalité historique dont on trouve par ailleurs un autre exemple dans l’analyse de la dramaturgie brechtienne par Benjamin : « L’état des choses que décèle le théâtre épique n’est autre que la dialectique en arrêt[69]. » Aussi la distanciation permet-elle au spectateur de faire la relation entre le présent d’où il regarde la représentation théâtrale et l’époque que celle-ci lui montre alors représentée. Nombreux sont donc les éléments permettant de saisir au sein même de plusieurs types de représentation fonctionnant de manière allégorique la posture critique face à l’histoire telle que Benjamin se plaît à la concevoir. Mais tenter d’en rassembler les multiples fragments épars dans son œuvre reviendrait à effectuer un travail d’allégoricien allant bien au-delà des simples modalités théâtrales de la notion même d’origine.
En revanche, si l’on reste dans le domaine de la représentation théâtrale, on peut constater que la pensée allégorique de Benjamin trouve une illustration concrète dans l’Origine du drame baroque allemand. Il y rattache en effet précisément le déchiffrement de l’allégorie au divertissement pascalien, au sens où il offre une échappatoire à la mélancolie ressentie par le prince dans la contemplation d’un monde empreint de tristesse : « L’allégorie est […] l’unique et grandiose divertissement qui s’offre au mélancolique[70]. » Cette formulation fait du reste écho à ses analyses ultérieures de la poésie baudelairienne : « Le génie de Baudelaire, qui trouve sa nourriture dans la mélancolie, est un génie allégorique[71]. » Au-delà des différences de contexte historique, il existe donc une attitude particulière face à la représentation allégorique faite à la fois de distance critique et d’adhésion empathique. Dans son Petit organon pour le théâtre, Brecht développe une idée similaire. Revenant sur l’histoire du théâtre, il affirme que celui-ci « n’a pas besoin d’autre passeport que le divertissement[72] ». Seul ce dernier détermine en effet la qualité d’un théâtre constitué de « représentations fort diverses d’événements humains significatifs[73] » dont la thématique varie en fonction de leur contexte de création. Pour autant, la cohérence de la fable prime sur les inévitables distorsions entre la réalité sociale de ce contexte et l’époque représentée : « Il suffisait qu’on eût l’illusion – créée par toutes sortes de moyens poétiques et dramatiques – que chaque histoire suivait un cours inéluctable[74]. » Brecht reconnaît donc au spectateur la capacité toujours actuelle de pouvoir volontairement renoncer à l’exercice de son sens critique, en demeurant cependant conscient de la distance existante entre lui et la représentation : « Nous aussi fermons les yeux sur de telles discordances, lorsque nous avons l’occasion de profiter en parasites soit des lavages d’âme de Sophocle, soit des sacrifices de Racine, soit des frénésies shakespeariennes[75] ». Une telle formulation rappelle en fin de compte que la relation entre théâtre et histoire ne saurait être autrement pensée que dans un double mouvement de distanciation et d’empathie, qui, à défaut d’en percer les secrets d’origine, permet de saisir à travers la représentation la constante réactualisation de la question originaire, dont Benjamin a fait l’une de ses préoccupations intellectuelles majeures.
| Romain Jobez
Notes
[1] Voir Gérard Raulet, Walter Benjamin, Paris, Ellipses, 2000, p. 23.
[2] Voir Burkhardt Lindner, « Habilitationsakte Benjamin », Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 53/54, 1984, p. 147-165.
[3] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand [1928], (trad. Sybille Muller), Paris, Flammarion, 2000, p. 49.
[4] Ibid., p. 48.
[5] Ibid., p. 50.
[6] Idem.
[7] Voir Momme Brodersen, Spinne im eigenen Netz : Walter Benjamin, Bühl-Moos, Elster-Verlag, 1990, p. 108.
[8] Walter Benjamin, « Conversations avec Brecht », Essais sur Brecht (trad. Philippe Ivernel), Paris, La Fabrique, 2003, p. 197.
[9] « Spectacles et concerts », Le Journal de Genève, 6 février 1915, p. 3.
[10] Idem.
[11] Voir Romain Jobez, Le Théâtre baroque allemand et français. Le droit dans la littérature, Paris, Garnier, 2010.
[12] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 81.
[13] Ibid., p. 86.
[14] Walter Benjamin, « Qu’est-ce que le théâtre épique ? [1] », Essais sur Brecht, op. cit., p. 23 sq.
[15] Ibid, p. 23.
[16] Voir Peter Szondi, Théorie du drame moderne [1956], trad. Sybille Muller, Belval, Circé, 2006.
[17] Walter Benjamin, « Qu’est-ce que le théâtre épique ? [2] », Essais sur Brecht, op. cit., p. 40.
[18] Walter Benjamin, Lettre à Hugo von Hofmannsthal du 5 juin 1927, Correspondance (trad. Guy Petitdemange), tome 1, Paris, Aubier, 1978, p. 406.
[19] Romain Jobez : « Ursprung des französichen Trauerspiels – Französischer Ursprung des Trauerspielbuchs? », dans Claude Haas, Daniel Weidner [dir.], Benjamins Trauerspiel : Theorie – Lektüren – Nachleben, Berlin, Kadmos, 2014,
p. 158-171.
[20] Friedrich Schiller, « Sur le pathétique » [1793], Textes esthétiques (trad. Nicolas Briand), Paris, Vrin, 1998, p. 152.
[21] Voir Alexander Nebrig, Rhetorizität des hohen Stils. Der deutsche Racine in französischer Tradition und romantischer Modernisierung, Göttingen, Wallstein, 2007
[22] Voir Peter Szondi, Essai sur le tragique [1961], (trad. Jean-Louis Besson et alii), Belval, Circé, 2003.
[23] Voir Marc Sagnol, Tragique et tristesse. Walter Benjamin, archéologue de la modernité, Paris, Cerf, 2003.
[24] Walter Benjamin, « Trauerspiel et tragédie » (trad. Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy) Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 255-259.
[25] Ibid., p. 256.
[26] Idem.
[27] Idem.
[28] Ibid., p. 258.
[29] Marc Sagnol, Tragique et tristesse, op. cit., p. 181.
[30] Ibid., p. 181 sq.
[31] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 89.
[32] Ibid., p. 126.
[33] Idem.
[34] Voir Marc Sagnol, Tragique et tristesse, op. cit., p. 180 sqq.
[35] Voir Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 89 sqq.
[36] Ibid., p. 91.
[37] Voir Marc Sagnol, Tragique et tristesse, op. cit., p. 223 sqq.
[38] Voir Jean-Michel Palmier, Le chiffonnier, l’ange et le petit bossu. Esthétique et politique chez Walter Benjamin, Paris, Klincksieck, 2006, p. 439 sqq.
[39] Voir John Pizer, « History, Genre and ‘Ursprung’ in Benjamin’s Early Aesthetics », The German Quarterly, 60, 1987, p. 68-87.
[40] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 43.
[41] Ibid., p. 42.
[42] Ibid., p. 44.
[43] Ibid., p. 45.
[44] Jean-Michel Palmier, Le chiffonnier, l’ange et le petit bossu, op. cit., p. 168.
[45] Voir notamment Florence Dupont, Aristote, ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007.
[46] Roland Barthes, Sur Racine [1963], dans Œuvres complètes, tome II, Paris, Seuil, 2002, p. 133.
[47] Idem.
[48] Voir Bénédicte Louvat, « Au carrefour des genres : l’élaboration du modèle tragique français dans les années 1630-1640 », La Licorne, 82, 2008, p. 63-74. Voir également Georges Forestier, Passions classiques et règles tragiques : essai sur la tragédie française, Paris, PUF, 2003.
[49] Voir Marie-Claire Châtelain, « Bérénice : Élégie ovidienne et tragédie racinienne », dans Jean-Pierre Landry, Olivier Leplâtre [dir.], Présence de Racine, Lyon, Jacques André, 2000, p. 95-107.
[50] Bénédicte Louvat, « Introduction », dans Jean Mairet, Théâtre complet, tome I, Paris, Champion, 2004, p. 59.
[51] Roland Barthes, Sur Racine, op. cit., p. 131.
[52] Lucien Goldmann, Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et le théâtre de Racine [1955], Paris, Gallimard, 1975, p. 351.
[53] Marc Sagnol, Tragique et tristesse, op. cit., p. 114.
[54] Ibid., p. 212.
[55] Lucien Goldmann, Le Dieu caché, op. cit., p. 377.
[56] Roland Barthes, Sur Racine, op. cit., p. 133.
[57] Walter Benjamin, « Qu’est-ce que le théâtre épique ? [1] », op. cit., p. 23 sq.
[58] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 94.
[59] Idem.
[60] Roland Barthes, Sur Racine, op. cit., p. 133.
[61] Voir Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 113 sqq. Comp. avec Marc Sagnol, Tragique et tristesse, op. cit., p. 114 sqq.
[62] Voir Giorgio Agamben, Le langage et la mort, (trad.Marilène Raiola), Paris, Bourgois, 1997, p. 157.
[63] Friedrich Schiller, « Sur l’art tragique » [1792], Textes esthétiques, op. cit., p. 120.
[64] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 183.
[65] Voir Romain Jobez, « Le Trauerspiel contre la tragédie religieuse : Andreas Gryphius, lecteur critique de Corneille », dans Myriam Dufour-Maître [dir..], Pratiques de Corneille, Rouen, PUHR, 2012, p. 293-304.
[66] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 43.
[67] Voir Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle : Le livre des passages [posthume, fragments rédigés entre 1927 et 1940 ; première parution 1982], trad. Jean Lacoste, Paris, Cerf, 1989, p. 479.
[68] Idem.
[69] Walter Benjamin : « Qu’est-ce que le théâtre épique ? [1] », art. cit., p. 32.
[70] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, op. cit., p. 199.
[71] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle : Le livre des passages, op. cit.,
p. 42.
[72] Bertolt Brecht, Petit organon pour le théâtre [1948], trad. Bernard Lortholary, dans Écrits sur le théâtre, Paris, Gallimard, 2000, p. 355.
[73] Ibid., p. 357.
[74] Idem.
[75] Id.
Pour citer cet article
Romain Jobez, « La « couronne du roi posée de travers » – sur la notion d’origine dans la pensée théâtrale de Walter Benjamin », Revue d’Historiographie du Théâtre numéro 3 [en ligne], mis à jour le 01/01/2017, URL : https://sht.asso.fr/la-couronne-du-roi-posee-de-travers-sur-la-notion-dorigine-dans-la-pensee-theatrale-de-walter-benjamin/