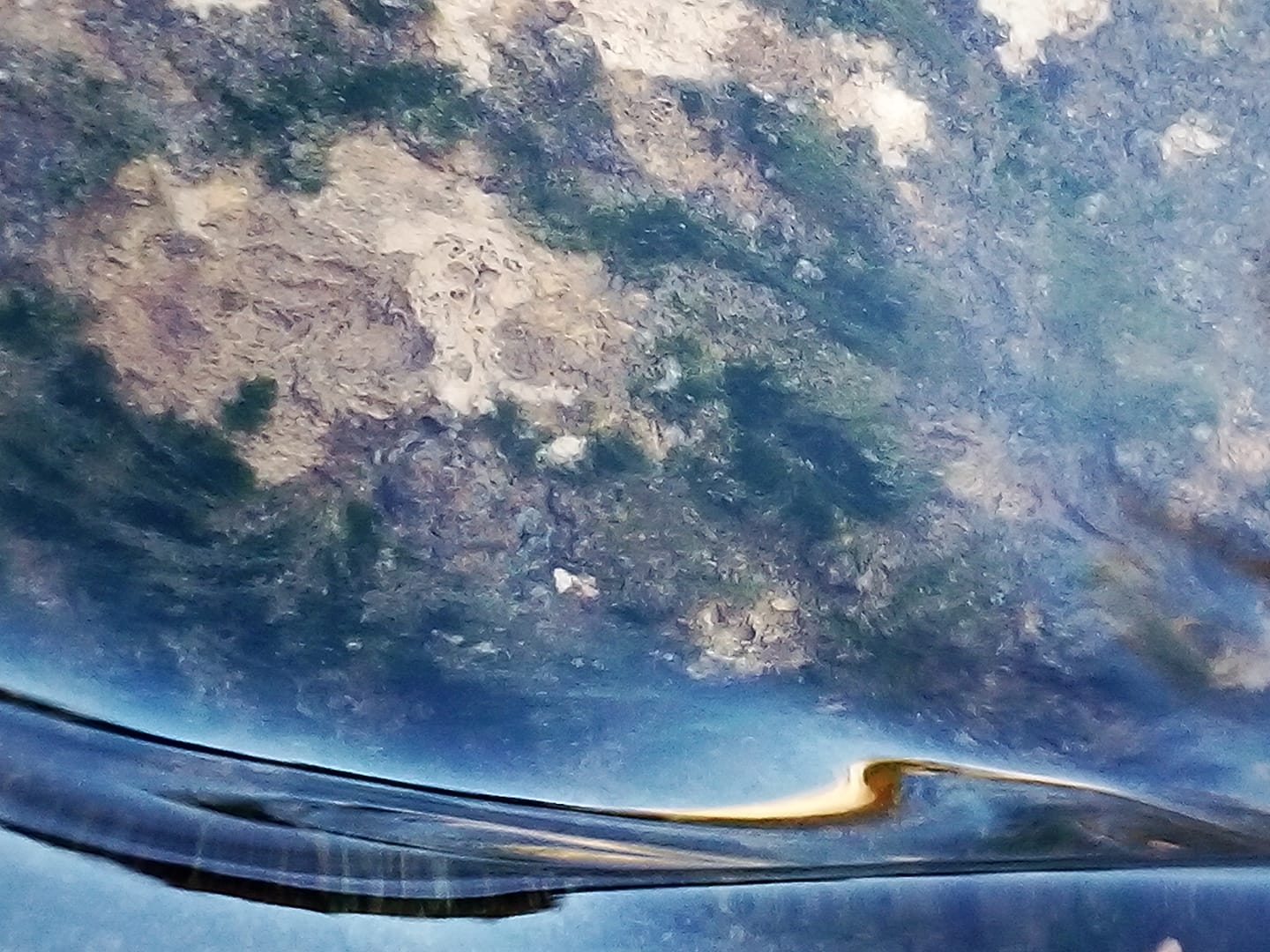Revue d’Histoire du Théâtre • N°291 T3 2021
Entretien avec Christian Benedetti
Résumé
Entretien réalisé par Elisabeth Angel-Perez
Texte
Acteur et metteur en scène, fondateur et directeur du Théâtre-Studio d’Alfortville depuis 1997, Christian Benedetti chemine aux côtés d’auteurs devenus des amis qui ne le quittent pas : Edward Bond, dont il monte de nombreuses pièces et en particulier Mardi, Sauvés, 11 débardeurs, Existence (1ère mondiale), Tchekhov et Sarah Kane. De Kane, il met en scène Blasted (Anéantis) à Nanterre-Amandiers (1999-2000) et crée 4.48 Psychose en France (2001) au Théâtre-Studio. Il remontera ces deux textes à plusieurs reprises et souvent conjointement, en 2000, 2001, 2002, 2017, 2018.
Chaque année, dans ce lieu magnifique du Théâtre-Studio, Christian Benedetti crée des spectacles politiquement stimulants, esthétiquement dérangeants. On voit, au fil de ses créations, s’affirmer un tropisme pour les auteurs anglais contemporains : Bond, artiste associé au Studio-Théâtre ; Mark Ravenhill (l’auteur de Shopping and Fucking), dont il joue Product et dont il monte notamment Piscine pas d’eau ; et bien sûr Sarah Kane vers qui il ne cesse de revenir. Christian Benedetti chemine aussi en compagnie de la Serbe Biljana Srbljanović et de la Roumaine Gianina Cărbunariu qui devient, comme Edward Bond, artiste associée au Théâtre-Studio.
Tu crées 4.48 Psychose, le dernier texte de Kane, au Studio-Théâtre d’Alfortville en 2001, ouvrant ainsi la voie à la longue carrière en France de cette pièce qui est de loin la plus jouée des pièces de Kane. Deux ans auparavant, en 1999, tu avais monté Blasted, son premier texte. Tu vas ensuite reprendre ces deux pièces en 2002, 2017 et 2018. Pourquoi ces deux textes ? Et pourquoi ces deux textes ensemble ? Encore et encore, presque compulsivement, passionnément en tout cas ?
La meilleure façon de connaître un auteur, c’est de partir de ses premiers mots et d’aller jusqu’à ses derniers. Entre Blasted et 4.48 Psychose, il y a pour moi comme une ligne droite. Avec Blasted, Kane commence par une forme assez traditionnelle, mais elle fait éclater la structure au milieu de la pièce, et à la fin, sur le plateau, on se retrouve avec Ian les yeux crevés, le cadavre du soldat, une croix, un bébé mort à moitié mangé, des armes, Cate qui a été violée et qui mange de la viande, du sang et de la poussière partout. Beaucoup de poussière, les traces – comme des fantômes – des personnages. Toute l’histoire du théâtre est là sur le plateau. Puis avec 4.48 Psychose on a les derniers mots de Sarah mais c’est aussi comme si elle revenait à l’origine, à l’arkhè du théâtre : une femme qui parle seule devant un mur. Sarah Kane revient là à un théâtre primordial, primitif, essentiel comme un principe chimique, sans didascalie. Elle va vers une tentative d’objectivité qui commence avec Crave (Manque) – à la fin les quatre voix n’en font plus qu’une – et s’achève avec 4.48 Psychose où cette unique voix revient pour raconter notre nécrologie.
Avec Blasted, les questions essentielles se posent dès le départ : comment représenter ? Faut-il trouver un réalisme poétique ? Faut-il trouver une poétique de ce réalisme ? Des questions pour lesquelles je ne suis pas sûr d’avoir une réponse. Quand on arrive à 4.48 Psychose, c’est le spectateur qui fait le travail parce qu’il n’y a rien à représenter. Tout est autour des mots, de la phrase et de l’évocation. L’écho que ces mots ont sur celui qui écoute. Ce dont elle parle, ça a déjà eu lieu. La douleur est différée. Donc le personnage peut en parler avec une capacité d’analyse et une acuité, avec une mise en perspective qui s’adressent à la raison. Comme le dit Edward Bond, on ne peut toucher le spectateur qu’à travers le sens et ça, Sarah l’a compris. Dans Blasted, la relation entre Ian et Cate appartient au passé – lui voudrait recommencer l’histoire mais elle lui dit que c’est fini – et le présent fait éclater la structure. Quand le soldat arrive, arrache les yeux de Ian, le sodomise, c’est le présent qui fait irruption. Je n’ai rien lu de plus fort, de plus extraordinaire comme texte de théâtre contemporain que Blasted et 4.48 Psychose. Pour moi, il y a Blasted, 4.48 Psychose et Existence. En tant que metteur en scène, je suis très attaché à ces trois spectacles de manière à la fois émotionnelle et intellectuelle. Edward [Bond] disait qu’il était jaloux de Sarah parce qu’il aurait voulu écrire Blasted. « C’est la plus grande pièce du XXe siècle », disait-il, et je crois qu’il a raison. Elle a tout compris. En plus (et là Edward n’y peut rien), elle a pour elle – j’en ai parlé à la fois avec elle, avec Gianina [Cărbunariu] et avec Biljana [Srbljanović] – qu’elle est une femme et qu’elle a par conséquent une radicalité pour cartographier le monde beaucoup plus grande que les hommes. Les hommes sont souvent dans la complainte, il y a un côté un peu douillet chez eux, ou bien, quand ils ne sont pas douillets, ils deviennent didactiques. La parole de la femme a toujours été confisquée, a fortiori au théâtre où les femmes n’avaient même pas le droit de monter sur un plateau. La parole de la femme n’était pas créditée de la même valeur, de la même portée. Clytemnestre, dans Électre (L’Orestie), pour pouvoir parler au peuple, utilise un discours d’homme, pas un discours de femme. Cette parole confisquée a rendu beaucoup plus forts le regard et la pensée des femmes. Sarah disait cela. Elle était très timide, avec une voix très douce, mais de temps en temps elle tapait sur la table : pour arrêter les guerres, l’intuition première c’est qu’il faut tuer les hommes, mais elle, elle disait non, il faut tuer les femmes, ce sont les femmes qui mettent au monde des mecs qui vont faire la guerre.
Quand tu remontes ces textes, tu affines ta perception et tu y entres de plus en plus en profondeur, mais est-ce que, vingt ans après, ces deux textes racontent la même chose ou quelque chose de différent ?
Je n’aurais pas remonté 4.48 Psychose si je n’avais pas rencontré Hélène Viviès. Il faut une actrice capable d’arrêter le temps ou de changer l’espace avec un regard. Quand j’ai voulu mettre en scène Blasted, personne ne voulait le jouer, on me disait : « Mais tu n’as qu’à le jouer, toi », mais je me sentais trop jeune pour le faire. J’avais peur non pas de le jouer, mais de mal faire par rapport aux conversations qu’on avait avec Sarah. Finalement ce sont des élèves du Conservatoire de Marseille qui m’ont fait cette surprise. un jour j’arrive à Marseille et ils me disent : « On veut te montrer quelque chose », et ils me présentent toute la première scène de Blasted. J’ai été stupéfait de cette évidence qu’ils avaient trouvée à jouer ce texte et de l’amour qu’ils y mettaient. « On va faire la suite », je leur dis, « merci, tirez les fils que vous avez trouvés, on fait un festival au Théâtre- Studio à la fin de l’année, je vous invite à venir jouer trois fois et entre temps on arrange un peu des choses. Vous n’avez pas l’âge des rôles, ce n’est pas grave nous ferons avec. » Nous l’avons représenté. Ensuite nous sommes allés le jouer au Planetarium à Nanterre-Amandiers, alors dirigé par Jean-Pierre Vincent. Les gens avaient du mal à accepter ces images. une femme est sortie lorsque Ian mange le bébé, puis elle est revenue parce qu’elle voulait quand même voir la fin et elle m’a dit : « c’est pas possible, vous ne pouvez pas montrer ça ». J’ai répondu : « Vous avez bien vu que c’est un faux bébé… À la télé vous pouvez voir des enfants se faire tuer ou se faire lapider, ils ne se relèvent pas pour saluer, eux. Vous voyez bien que c’est un bébé en celluloïd et que l’idée est de montrer la mécanique, de montrer le pourquoi. » Alors oui, effectivement, ça heurte les gens. C’est une effraction.
Crois-tu qu’après tout ce qu’on a pu voir sur scène en matière de violence depuis les années 1990 et jusqu’à la fin des années 2010, cela heurte toujours autant ?
Ça n’a pas changé. Mais seize ans après, j’ai mieux compris la pièce. Sarah était fascinée par le poème de T. S. Eliot The Waste Land, où l’on trouve cette phrase formidable : « Je te montrerai ta peur dans une poignée de poussière ». Pas ton ombre, « ta peur ». La force des images, l’inacceptabilité des images étaient les mêmes que seize ans auparavant. Pourquoi ? Parce que les spectateurs ne pouvaient pas admettre, et ne peuvent toujours pas comprendre que tout ce qui est fait sur le plateau, est une accumulation de gestes d’amour. Pour les gens il est inacceptable que le soldat qui gobe les yeux de Ian, ce soit un acte d’amour ; que le soldat qui sodomise Ian, ce soit un acte d’amour. C’est un véritable « collapse » intellectuel. Par amour on peut être amené à faire des choses extrêmement violentes, et le théâtre est la cartographie du sens. La force de la pièce est qu’elle n’atténue rien. Même lorsque je n’avais pas pris un bébé en celluloïd, mais un bébé sans visage, une représentation grossière, pas crédible, c’était inacceptable. De la même manière, les choses sexuelles restent inacceptables alors même que les gens vont sur Youporn…




Cela reste-t-il inacceptable parce que ce texte, vingt ans après, est toujours en prise sur la violence du monde, raconte toujours autant l’horreur du monde ?
Le fait qu’il dise toujours l’horreur du monde est, comme disait Vitez, le propre même de la tragédie. La tragédie, c’est notre obligation de toujours redire les mêmes mots, refaire les mêmes gestes, et de parler de ce qui s’est passé hier comme si cela s’était passé il y a mille ans.
Est-ce qu’on monte Kane par défi, comme Katie Mitchell dit l’avoir fait, ou bien par urgence ?
On monte Sarah Kane par nécessité, presque par devoir.
Peux-tu revenir sur le jeu ? Tu joues Ian. Tu diriges des acteurs et des actrices – au moins trois – qui sont toutes magnifiques dans 4.48 Psychose : Ingrid Jaulin, Anamaria Marinca, Hélène Viviès, actrices phénoménales. J’ai senti qu’il y avait une évolution dans la manière dont tu les dirigeais. Au début tu travaillais beaucoup la transparence. Ingrid Jaulin était coiffée comme Sarah Kane, Anamaria Marinca était troublante tant elle lui ressemblait aussi. Tandis qu’avec Hélène Viviès, non, c’est quelqu’un d’autre.
Au fur et à mesure du temps ma compréhension du texte est devenue plus fine, plus intime, plus aiguë. Oui, Ingrid était coiffée comme Sarah quand je l’ai connue. Quant à Anamaria, sa ressemblance avec Sarah est devenue terrible ! Au Young Vic, à Londres, le soir de la première, Mark Ravenhill m’a pris par le bras à la fin et m’a dit : « Tu sais, j’ai failli partir, j’avais l’impression qu’il y avait Sarah sur le plateau. » D’ailleurs Simon [le frère de Sarah] était là et il est parti en pleurant. Et je ne l’ai jamais revu.

C’était très troublant en effet. As-tu encouragé ces actrices dans ce sens ?
Nous n’avons jamais travaillé la ressemblance avec Sarah, cela aurait été d’une faute impardonnable en réduisant sa parole. Mais Anamaria est devenue Sarah. Et plus elle devenait Sarah, plus l’affect prenait le dessus, moins elle avait de recul. À l’inverse, ce qui était remarquable avec Hélène Viviès, c’est qu’elle a tout de suite eu ce recul. Hélène, c’était l’alliance de l’émotion et de l’intelligence ; là on était exactement au bon endroit. Au début elle ne voulait pas jouer cette pièce et ne comprenait pas pourquoi j’avais ce projet avec elle. Je lui ai dit : Je voudrais t’emmener à un endroit de toi que tu ne connais pas. Dis-toi que je t’emmène en vacances dans un endroit, c’est une surprise, mais c’est un lieu dont tu ne pourras plus jamais te passer. Et elle s’est laissée emmener – nous avions une relation d’une confiance absolue – pendant les répétitions. D’ailleurs, ce n’étaient pas des répétitions, c’étaient des rendez-vous. Avec ce texte-là ce sont toujours des rendez-vous, pas des répétitions. On ne peut pas dire : « On va répéter de telle heure à telle heure ». Quand l’actrice dit « stop », il faut écouter ; on ne peut pas lui dire « encore une fois ». Et puis cette pièce a ses mystères : le premier filage, avec Ingrid Jaulin, a duré 1h12, le deuxième 1h12, et le texte dit « à 4h48, pendant 1h et 12 minutes j’ai toute ma tête ». C’est troublant. Quand j’ai monté la pièce en roumain avec Anamaria, quand je l’ai montée en Italie, en Allemagne, à chaque fois, c’était 1h12. C’est un mystère total. Et au Young Vic, quand le directeur, David Lan, a demandé d’indiquer une durée, je lui ai dit 1h12. Ça a duré 1h12 tous les soirs, sauf un parce qu’un spectateur a eu un malaise. « Comment as-tu fait ? » m’a demandé David Lan. Je n’ai pas « fait », je n’y peux rien, c’est comme ça.
De la même manière, la place de l’actrice sur le plateau. J’ai dit à chaque actrice : « Promène-toi, vas où tu veux, mais mon intuition est qu’il y a une place sur le plateau, la seule certitude que j’ai est que ce n’est pas au milieu. » On a fait l’exercice qu’on faisait avec Edward [Bond], je leur ai dit : « Trouve la douleur de l’espace ». C’est compliqué ce concept, mais à chaque fois les différentes actrices se sont mises à la même place. Comme je ne suis ni magicien ni alchimiste, c’est que Sarah doit nous accompagner. un jour, Ingrid me dit après la représentation : « Ce n’est pas possible, si tu ne peux pas t’en empêcher, sors. Tu n’as pas arrêté de marcher, sous les gradins. » Je lui ai répondu : « Pas du tout, j’étais dans la salle. » On s’est dit qu’on allait devenir fous. « Sarah est là. » Ça devenait anxiogène.

Est-ce qu’on peut revenir sur Blasted : le réalisme, le traitement des images, la façon de faire sentir la douleur ?
Cela interroge notre capacité à sortir de nos habitudes de représentation et à se poser la question de savoir ce qui est représentable et ce qui ne l’est pas. Qu’est-ce qui est acceptable pour toi et à quel endroit tu veux parler aux gens, commettre cette effraction chez ceux qui regardent ? La représentation que demandent les textes de Sarah nous interroge sur notre capacité intellectuelle et artistique à répondre. C’est passionnant. On ne trouvera jamais La solution. Les solutions se modifient au fil du temps. Dans mon travail, la poussière est beaucoup plus présente – pas tant ce qui tombe du plafond que la poussière comme trace. On s’interroge aussi sur la manière de faire une chose simple, sans technologie.
Avec les acteurs, on est obligé d’être très précautionneux. Par exemple, j’ai demandé à Marion [Trémontels] si elle préférait que j’aie un assistant ou une assistante. Elle a préféré une femme. Moi, ça m’intéressait d’avoir le regard d’une femme et je voulais qu’elle se sente en confiance… Les premiers moments où elle est nue et où Ian est dehors, j’ai dit à Gaëlle, mon assistante : « Je reste dehors, tu me raconteras ». J’ai dit une seule chose à Marion : « Tu ne peux pas te tenir comme si tu voulais cacher ton corps, il faut passer par-dessus et tu verras, plus personne ne fera attention parce que c’est une évidence ». Elle s’est sentie libérée. Il faut être délicat et attentif avec les actrices et les acteurs parce que c’est leurs corps qui portent le sens et bien sûr, il y a un sens à cette nudité, même si elle n’est pas facile. Pour ce qui est du sexuel, on se dit que ça ne choque plus personne. Bien sûr, on n’est pas obligé d’être de profil pour une fellation, on peut être de dos, on n’est pas obligé de cracher du gel douche pour faire croire que c’est du sperme. C’est l’impulsion, la violence avec laquelle on crache qui est intéressante. L’image la plus violente pour moi dans Blasted est quand Cate revient et qu’elle mange du saucisson. C’est d’une violence inouïe. Alors qu’elle passe son temps à dire qu’elle va vomir et qu’elle est végétarienne, elle mange du saucisson. Cette violence du sens est beaucoup plus violente que la simulation d’une fellation ou d’un viol.
Malgré le cinéma, au théâtre les spectateurs refusent souvent les choses sanguinaires – manger les yeux par exemple – ils rient ou se cachent les yeux. Alors que le sexuel est presque devenu banal. En Roumanie c’est le sexuel qui était scandaleux dans Blasted, pas la violence, pas la guerre. C’est un peuple qui a l’habitude de la barbarie, donc les spectateurs recevaient cette violence ; par contre, l’actrice nue… Quand elle était nue, tous les techniciens venaient regarder. Il m’a fallu leur dire qu’ils ne pouvaient pas faire ça. La traduction roumaine portait le titre Chocant ! [Choc], et tout était édulcoré. J’ai demandé au traducteur de retraduire vraiment et les acteurs, dont Anamaria Marinca, ont été renvoyés pour cause de théâtre pornographique. À cause de moi.
N’as-tu pas envie de monter Cleansed (Purifiés) et de travailler plus avant l’organicité de l’œuvre ?
Je n’ai pas vu la mise en scène de Katie Mitchell – d’un réalisme exacerbé –, mais j’ai vu celles d’Oskaras Koršunovas : une en Lituanie et une autre tout à fait différente pour un stage en Italie. Magnifiques. En Roumanie, j’ai monté Blasted et 4.48 Psychosis ; j’ai monté Crave aussi. Cleansed et Phaedra’s Love sont deux pièces formidables. Il faudrait que je m’y attelle. Pour moi, l’œuvre de Sarah reste Blasted et 4.48. Il y a toute l’histoire du monde dans ces deux pièces. Entre Blasted et 4.48, il y a aussi toute l’histoire de Sarah. Le monologue de A dans Crave est un des plus beaux monologues d’amour qui soit.
J’ai eu beaucoup de chance que Séverine Magois accepte de traduire 4.48 Psychosis pour moi. C’est comme si le texte avait été écrit en français. Sa traduction de Phaedra’s Love est également remarquable. Je ne dirais pas cela des autres pièces, qu’il serait urgent de retraduire. Nous avions dû retravailler la traduction de Blasted.
Faut-il inviter L’Arche à publier de nouvelles traductions, celles de Séverine Magois par exemple ? On s’est intéressés à la traduction en français canadien de 4.48 Psychose par Guillaume Corbeil pour Florent Siaud, et c’était passionnant parce que les canadianismes décalaient la langue de Kane, la donnaient à entendre autrement.
Séverine Magois a fait un travail remarquable. Quand j’ai monté la pièce en anglais, j’ai mesuré combien était magnifique la traduction de Séverine, elle devrait tout retraduire.
Une dernière question : après ta rencontre avec Sarah, tu as monté les textes de Gianina Cărbunariu et de Biljana Srbljanović. As-tu pensé leurs pièces, dans ton parcours, comme un approfondissement de l’œuvre de Kane ? Les as-tu travaillées dans une forme de continuité ?
Il y a des échos. Dans La Trilogie de Belgrade de Biljana, on entend des échos de Sarah Kane. Tout dépend d’où parlent ces femmes. Gianina est très fan de Sarah. Dans la radicalité de son écriture (Kebab par exemple), et dans le fait d’affronter des choses qui ne font pas plaisir au public, pas plaisir à voir, des choses d’ordre sexuel et économique. Le sexe lié au sang et à l’argent, c’est cela qui est gênant. L’association des deux te renvoie à ton propre rapport au sexe, au gore. Pendant un moment Gianina avait le même statut que Sarah, c’est-à-dire qu’elle n’était pas comprise. On disait : « C’est la plus grande dramaturge du moment », mais elle n’était pas comprise. La réception de la pièce dépend beaucoup du pays et de la langue : le public roumain, quand la pièce était en français, disait : « Formidable, des Français qui montent une pièce roumaine ! » Mais quand c’était en roumain, joué par des Roumains, ce n’était plus la même chose : l’hymne roumain chanté par des Roumains avec un acteur qui montre son cul, ce n’était plus la même chose ! Plus personne ne riait. Gianina fait plutôt du théâtre documentaire, elle accompagne son temps. Biljana, elle, a cette radicalité aussi, ce discours implacable sur la Serbie, en particulier quand elle parle de cette guerre barbare entre les Serbes et les Croates. Le théâtre devient dangereux. Toutes les deux ont reçu des menaces de mort. Le théâtre devient un enjeu de société, tellement fort que Sarah, elle, en est morte. Blasted, j’aurais appelé ça Dévastés plutôt.
Blasted veut dire « soufflés » par l’explosion.
Je pense qu’il faut un mot actif – donc j’ai gardé le titre en anglais. L’Arche m’a donné son accord. C’est plus juste. Sarah a ouvert un champ de possibles, pour moi elle est indépassable.
Pour citer cet article
Elisabeth Angel-Perez, « Entretien avec Christian Benedetti », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 291 [en ligne], mis à jour le 01/03/2021, URL : https://sht.asso.fr/entretien-avec-christian-benedetti/