
un cabinet en coup de fusil
La Société Française de Photographie (SFP), hébergée dans la BnF Richelieu, conserve dans ses fonds une étonnante collection de vues de répétitions, d’acteurs et d’actrices en leurs loges ou dans les coulisses dans les années 1905-1930. Des centaines de photographies qui proposent de nouveaux registres de l’intimité des acteurs et des actrices au tout début du XXe siècle. Ces excursions dans les loges où le regard des photographes dévore les corps et les espaces semblent alors être une pratique répandue, qui associe les coulisses des théâtres aux nouveaux espaces du tourisme, où, ici, les corps se consomment comme les nouveaux paysages à découvrir.
Voir aussi : Cahier Théâtre/Archives n°3, Société d’Histoire du Théâtre, 2023
Extrait de : Colette, « L’Ouvroir », L’Envers du music-hall, Paris, Flammarion, 1913
C’est une petite loge au troisième étage, un cabinet en coup de fusil dont l’unique fenêtre donne sur une ruelle. Un radiateur surchauffé y dessèche l’air, et chaque fois qu’on ouvre la porte, l’escalier en spirale envoie, comme un tuyau de cheminée, toute la chaleur des étages inférieurs, et l’odeur humaine d’une soixantaine de figurantes, et celle, plus terrible, d’un réduit tout proche…
Elles tiennent cinq là dedans, avec leurs tabourets de paille, entre la planche à maquillage et le portemanteau, fermé d’un rideau grisâtre, qui protège les costumes de la revue. Elles vivent là, de sept heures et demie à minuit vingt, le soir, et, deux fois par semaine, d’une heure et demie à six heures. Anita est la première qui franchit le seuil, essoufflée, les joues froides et la bouche humide. Elle recule et dit :
— Seigneur, on ne peut pas y tenir, ça tourne le cœur !
Puis elle s’habitue, tousse un peu, et n’y pense plus, parce qu’elle a juste le temps de se dévêtir et de se maquiller… La robe, la chemisette, cela s’enlève plus vite qu’une paire de gants, cela s’accroche n’importe où. Mais il y a un moment où la hâte se ralentit, où l’insouciance se fait grave ; Anita retire les longues épingles de son chapeau, les repique avec soin dans les mêmes trous, et protège religieusement, sous les quatre coins rabattus d’un vieux journal déployé, cet édifice voyant et pauvre qui participe de la couronne de Peau-Rouge, du bonnet phrygien et de la salade. La poudre grasse qui s’envole en nuages des houppes secouées, c’est — tout le monde sait ça ! — la mort au velours et aux plumes…
Wilson, la seconde, entre d’un air absent, mal éveillée :
— Dis donc… Flûte ! je voulais te dire quelque chose… Je l’ai mangé en route.
Elle ôte son chapeau selon les rites, puis soulève sur son front un bandeau de cheveux blonds qui cache une cicatrice mal fermée :
— Tu ne peux pas savoir comme ça m’élance encore dans la tête…
— C’est bien fait, interrompt Anita d’un ton sec. Quand on reçoit un décor sur la « cafetière », et que ça se passe chez des directeurs assez dégoûtants pour vous donner campo moyennant deux sous d’éther sur une compresse d’eau froide — même pas quarante sous pour le sapin, même pas cent sous pour le médecin ! — quand on reste huit jours à moitié claquée à la taule, et qu’on n’a pas l’amour-propre de faire un procès à la direction, on ne se plaint pas, on se tait ! Ah ! si c’était moi !…
Wilson ne répond pas, occupée à détacher, la figure tirée de côté, un cheveu d’or qui s’était méchamment collé à sa plaie. D’ailleurs on n’a pas besoin de répondre à Anita, anarchiste et furibonde de naissance, toujours prête à « porter plainte » et à « aller trouver les journaux ».
En cet automne 2025 où l’on célèbre l’écrivaine Colette (publications diverses, à la faveur de son entrée dans le domaine public, exposition Les mondes de Colette à la BnF), la SHT propose trois expositions virtuelles de photographies de coulisses de music-hall. Ce triptyque prolonge une publication de la collection Théâtre/Archives de 2023 qui avait publié une trentaine de ces photographies, accompagnées des enquêtes et analyses de Colette Morel, Vincent Guyot et Léonor Delaunay.
L’enquête continue aujourd’hui, avec L’Envers du music-hall de Colette en compagnonnage, tant ses nouvelles (plus que des chroniques) nous aider à dévoiler, dans un même mouvement, les coulisses et les images des coulisses. Ces photographies ne font pas exception. Elles sont un récit de l’intrusion et de la pose imposée. Elles témoignent d’une curiosité perverse, pratiquée par des administrateurs usant de leur autorité pour pénétrer l’intimité des coulisses et faire poser les acteurs et les actrices devant leur objectif.
L’excursion dans les coulisses se déroule sur des années (1906-1912), à raison de plusieurs visites dans de nombreux théâtres où Delamare pénètre aisément grâce à ses contacts. C’est dans les coulisses de ces théâtres de divertissements qu’il capte un quotidien et une intimité jusqu’alors peu photographiés. Les loges qu’il photographie sont des espaces de travail particulièrement exigus. Les murs sont fissurés, humides, replâtrés, ils témoignent du manque de confort et de salubrité des lieux. Sur certains clichés, on remarque le seau de toilettes à même la loge, à côté de la table de maquillage et du miroir ou sous une chaise percée, que le geste amateur du photographe n’a pas eu le réflexe d’exclure du cadre. Les draps et les rideaux de dentelles tendus au mur permettent de compartimenter l’espace, de préserver malgré tout un peu d’intimité en cas de changement de costumes à plusieurs, une intimité que le photographe préfère exposer,
En dépit de la modestie des lieux, certaines photographies montrent de quelle manière acteurs et actrices se les approprient et les personnalisent ; les murs sont couverts de coupures de journaux, de portraits, de photographies de famille et d’amis, punaisés autour de la coiffeuse et coincés dans le cadre du miroir. Les traces de la vie des artistes, parsemées ici et là dans ces minuscules espaces, offrent le tableau saisissant d’un espace hybride où l’intime et le travail, le privé et le public, se côtoient indistinctement.
Ces signes participent à la manière dont ces images nous saisissent. Ils documentent une histoire de la vie théâtrale rarement captée par le médium photographique.
Voir aussi Cahier Théâtre/Archives n°3, Société d’Histoire du Théâtre, 2023
Texte : Léonor Delaunay (enquête en cours sur l’histoire des coulisses et leurs représentations)
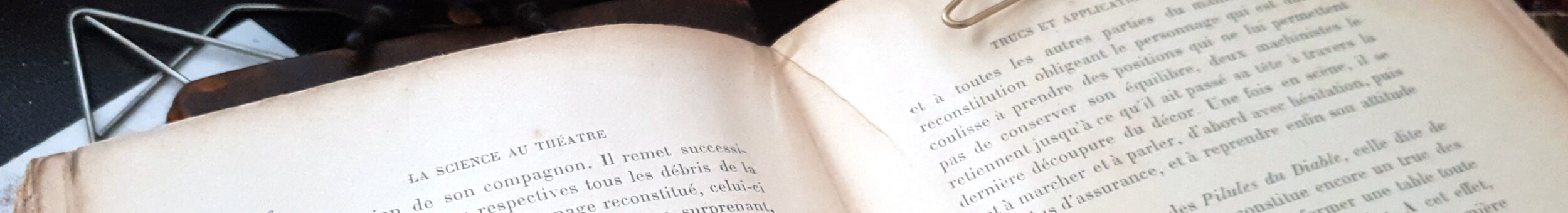
Abonnement
L’abonnement annuel constitue le soutien essentiel aux activités éditoriales de la Société d’Histoire du Théâtre et à leur pérennité. Il inclut les envois papier, l’accès aux versions numériques et à nos archives.
S’ABONNER EN LIGNE À LA VERSION PAPIER+NUMÉRIQUE France
S’ABONNER EN LIGNE À LA VERSION PAPIER+NUMÉRIQUE EUROPE/MONDE






























