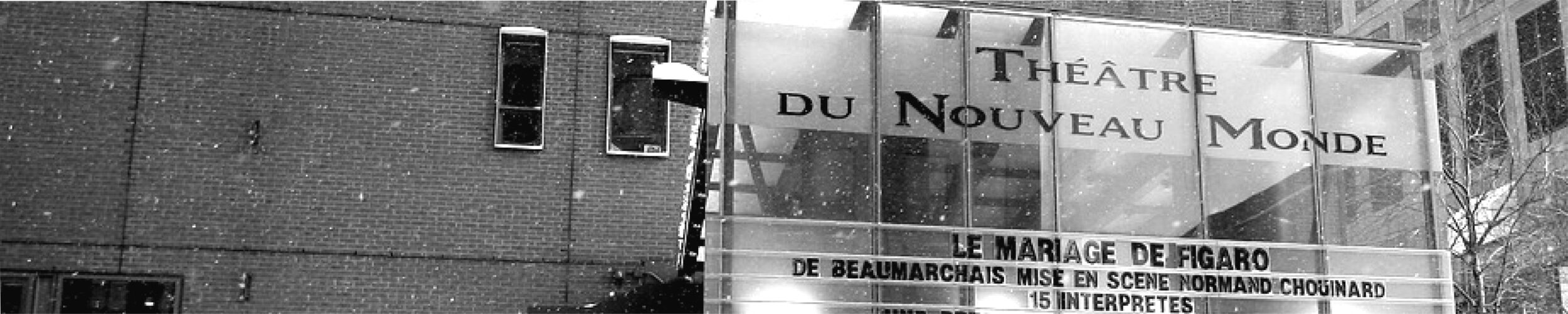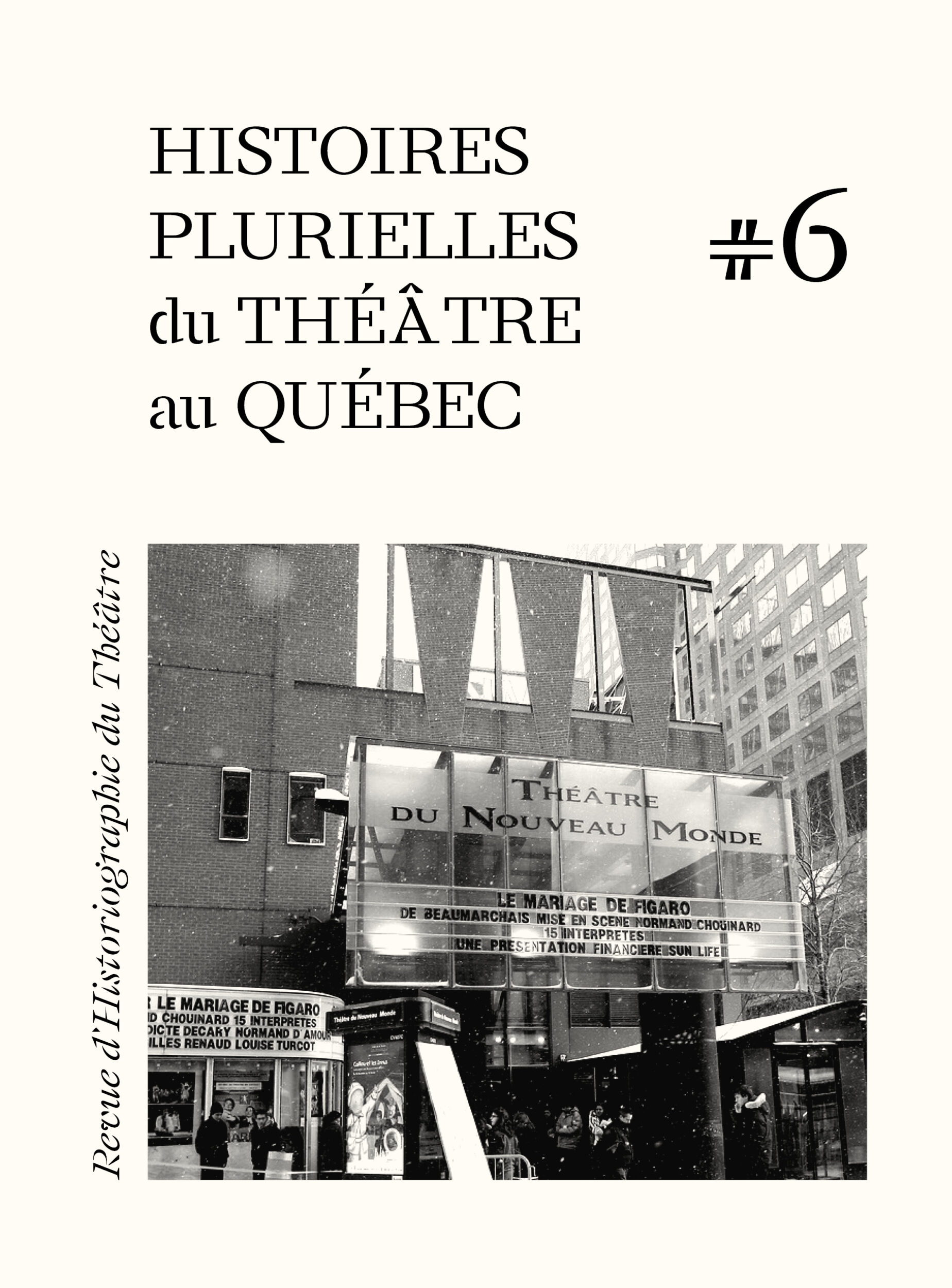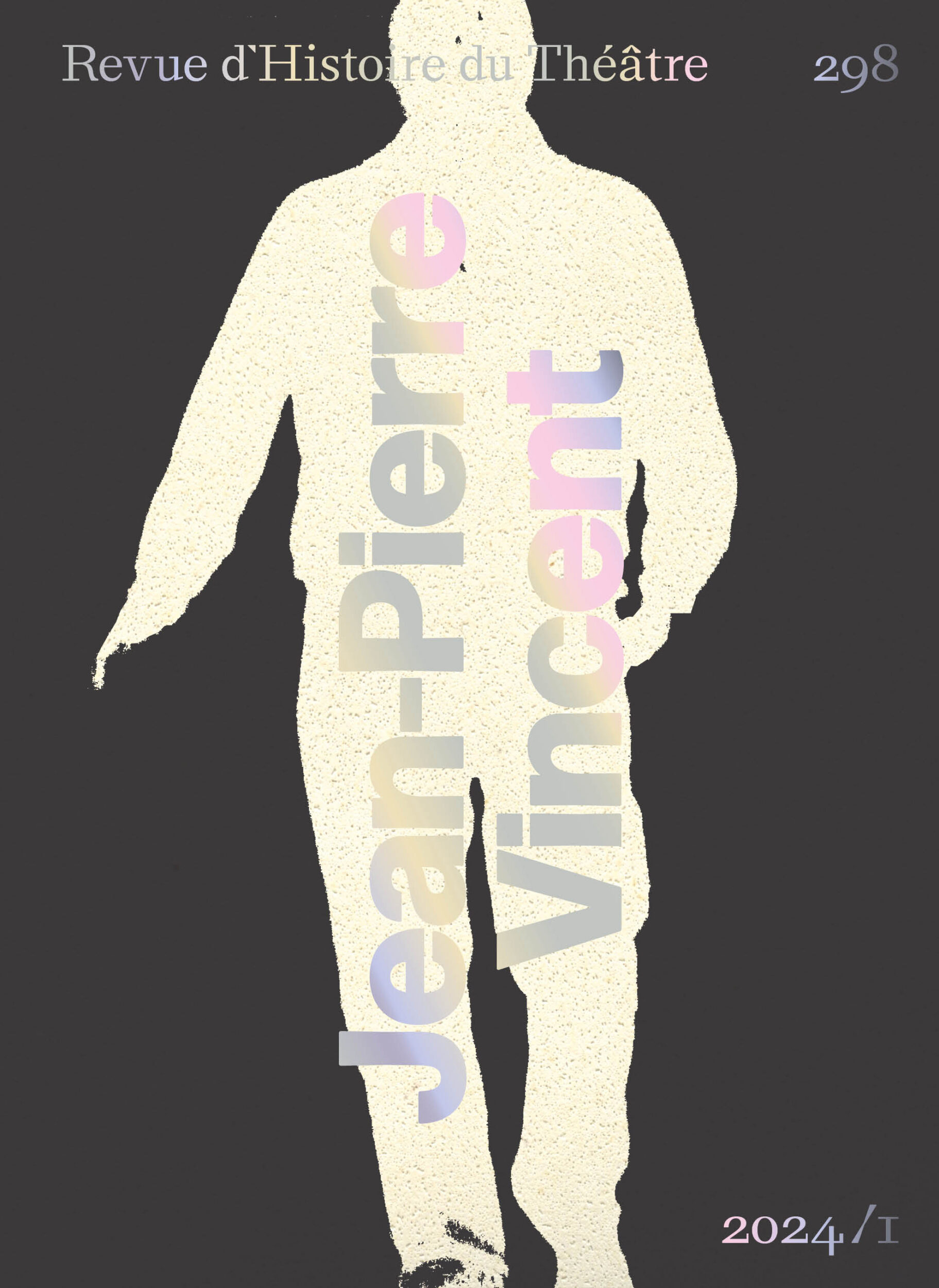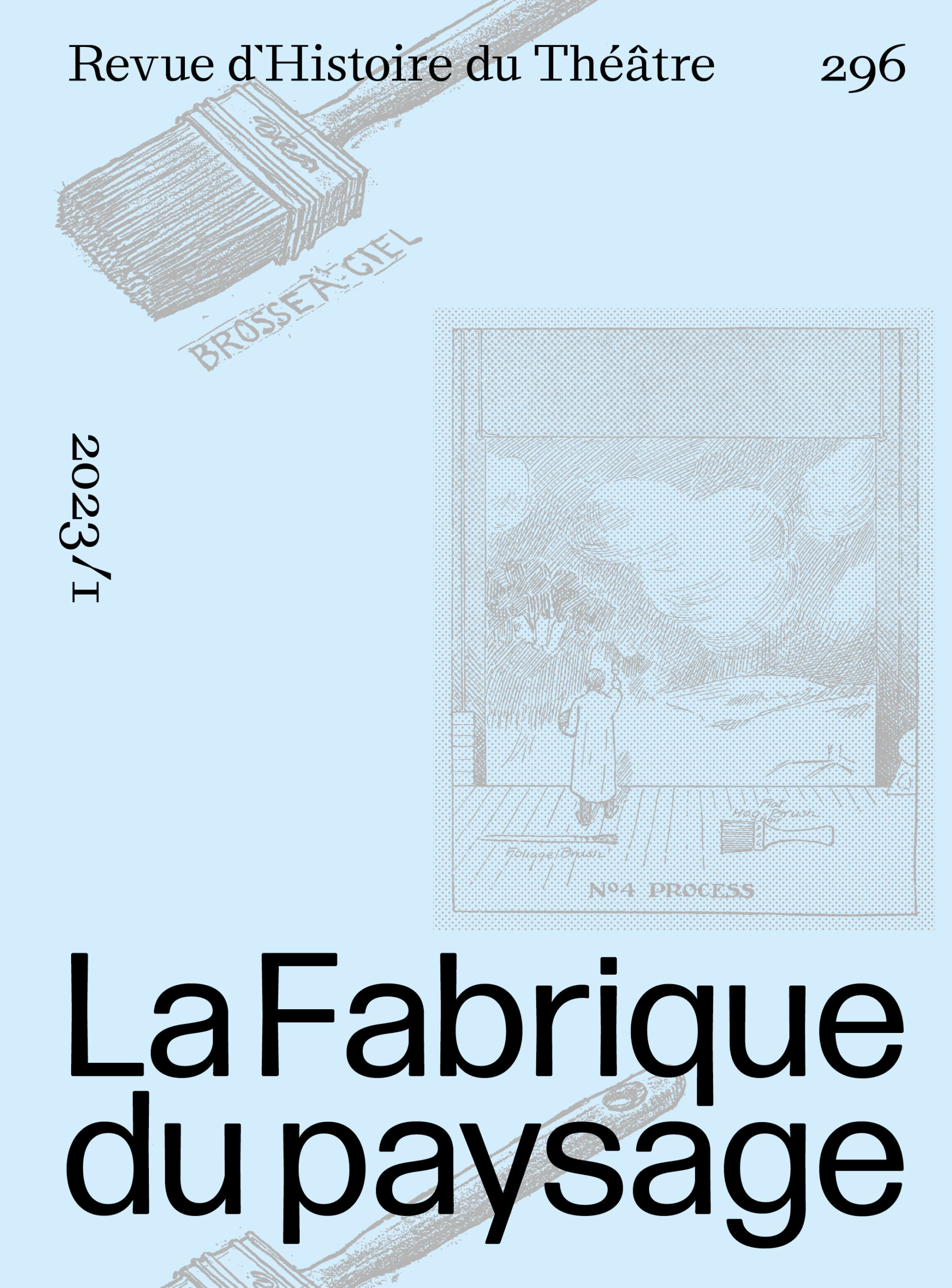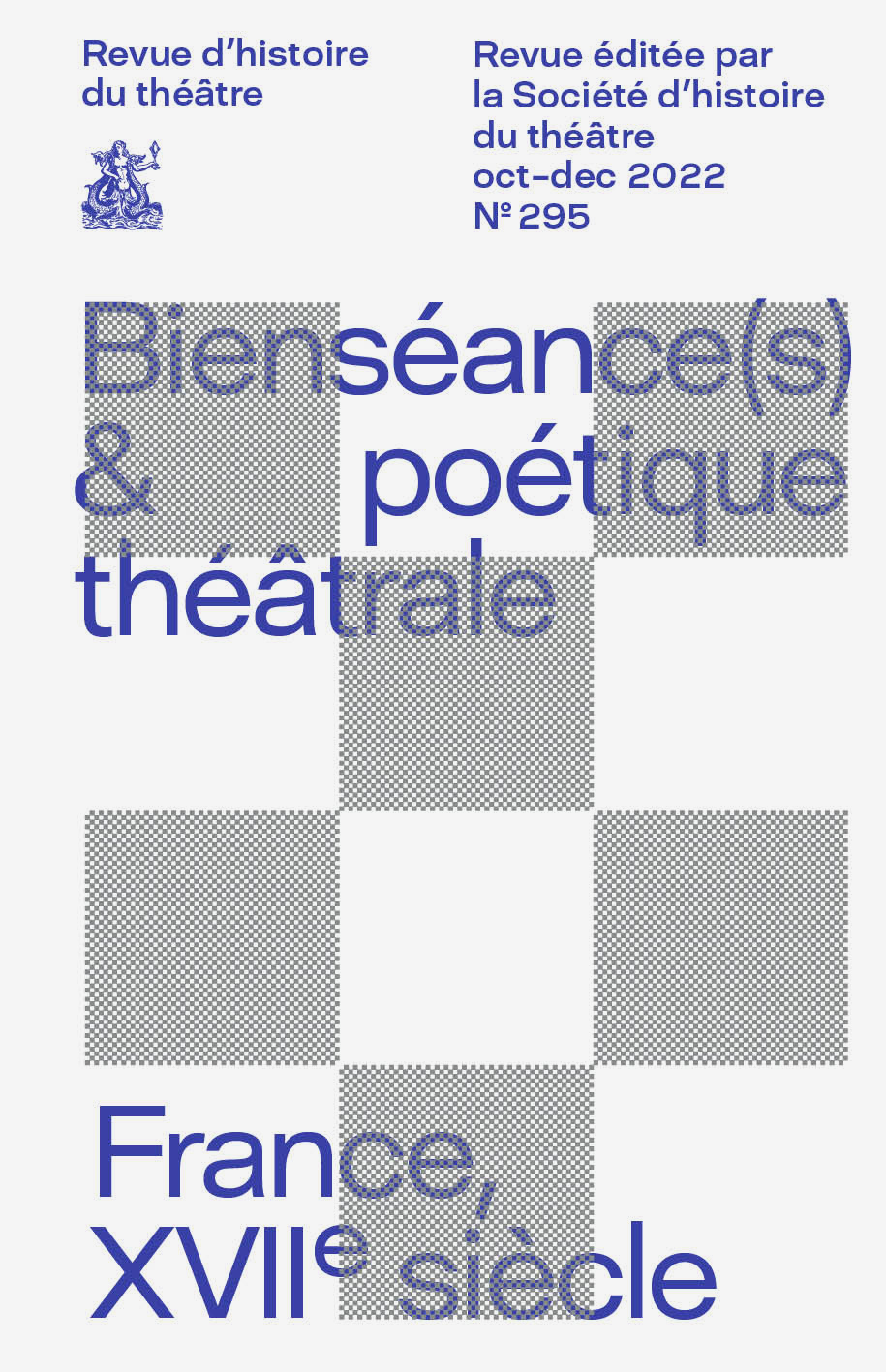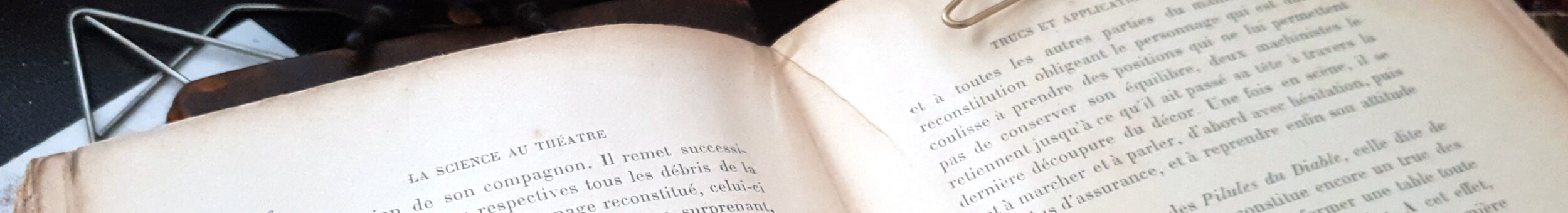Revue d’Historiographie du Théâtre • N°6 T1 2021
Introduction : bilan critique d’une aventure de recherche
Par Hervé Guay, Yves Jubinville
Résumé
L’histoire du théâtre au Québec est restée longtemps orpheline d’un récit faisant le bilan de la recherche produite dans les quarante dernières années. C’est maintenant chose faite avec la publication en 2020 de l’ouvrage Le Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et socio-esthétique. Des collaborateurs de cette entreprise scientifique ainsi que des chercheurs dans le domaine des études théâtrales québécoises se réunissent dans ce numéro pour retracer la genèse du projet et comprendre les défis qu’il représentait. Mais la perspective est également prospective en ce qu’elle tente de nommer certains points aveugles de l’historiographie théâtrale au Québec dans le but d’ouvrir la voie à d’autres histoires possibles.
Abstract
The history of theater in Quebec has long remained without a narrative taking stock of the research produced in the last forty years. This is now done with the publication in 2020 of Le Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et socio-esthétique. Collaborators in this project as well as researchers in the field of Quebec theatre studies come together in this issue to recount the genesis of this project and understand the challenges it represented. But the perspective is also prospective in that it tries to name certain blind spots in theatrical historiography in Quebec in order to open the way to other possible histories.
Texte
Si l’histoire du théâtre québécois, comme l’a observé déjà Jean-Marc Larrue1, est faite de recommencements, l’écriture de cette histoire l’est tout autant, puisqu’elle doit sans cesse être adaptée à un présent mouvant ainsi qu’aux perceptions changeantes de son devenir. C’est ce qui a guidé les auteurs de l’ouvrage Le Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et socio-esthétique2, lequel vise à raconter l’aventure théâtrale qui s’est déroulée sur le territoire québécois depuis la seconde guerre mondiale. Comme toute démarche sérieuse, celle-ci n’a pas pu se réaliser sans que soit menée une réflexion sur les formes qu’adopte aujourd’hui le discours de l’historien, sur les sources auxquelles celui-ci vient s’abreuver et sur les thèmes qu’il importe de traiter.
Cette entreprise éditoriale n’est pas étrangère à la préparation du présent dossier, lequel prolonge plusieurs des chantiers qui ont précédé ce travail. L’un des objectifs était très concret et visait à susciter de nouveaux questionnements sur le théâtre québécois. Plusieurs universitaires ont participé à cette réflexion collective menée dans le cadre de manifestations scientifiques qui ont eu lieu au Québec et aux États-Unis, et auxquelles ont été conviés des chercheurs extérieurs à l’équipe de recherche initiale. Si tous ne signent pas de contributions dans ce numéro, il n’en demeure pas moins que l’attention qu’ils ont accordée à des aspects essentiels de cette histoire a rejailli sur les textes publiés ici.
L’histoire du théâtre au Québec pose à celles et ceux qui veulent participer à sa mise en récit, mais aussi à la communauté plus vaste des historiens des arts de la scène, un certain nombre de problèmes. Certains d’entre eux, comme la place à réserver aux pratiques des minorités dans le récit commun, concernent une bonne partie de l’Occident à l’heure actuelle, alors que d’autres, comme les processus d’institutionnalisation et le rôle du nationalisme dans le développement de l’art dramatique, lui sont propres, sans être complètement coupés des réalités théâtrales qui existent ailleurs dans le monde.
Les responsables de ce dossier ont pris appui sur un examen critique des travaux effectués ces dernières années, à la fois pour détecter des points aveugles du récit historique passé et actuel, pour penser à nouveaux frais certaines catégories esthétiques et pour tenir compte de mutations historiographiques plus récentes qui influencent désormais, des deux côtés de l’Atlantique, l’écriture de l’histoire des arts de la scène. Tout en s’ancrant résolument dans une connaissance des pratiques théâtrales québécoises, l’un des fils conducteurs a consisté ainsi à se pencher sur des questions, des approches, des problèmes susceptibles de redynamiser la recherche. En cela, ce dossier s’articule autour d’une réflexion épistémologique qui fera écho à celle qui se fait à l’échelle d’autres arts, d’autres domaines d’études et qui vaudra assurément pour d’autres ancrages géographiques.
Comment écrire l’histoire
Le dossier s’ouvre avec une analyse d’Yves Jubinville portant sur les défis relatifs à l’écriture d’une synthèse historique, en particulier concernant la périodisation et l’articulation des temporalités du théâtre québécois. La réflexion commande une approche globale de la périodisation qui s’arrime aux travaux et aux débats sur l’historiographie dans le champ des études théâtrales en France et au Québec, mais qui tient également compte des avancées théoriques dans celui de l’histoire générale. En cela, il fait écho à l’étude de Marion Denizot qui suit immédiatement et qui propose, à son tour, une cartographie du domaine de l’histoire théâtrale en France en parallèle d’une lecture transversale d’une sélection d’écrits sur la scène québécoise. Ces perspectives croisées, adoptant la lunette comparatiste, témoignent d’une activité de recherche renouvelée, de thèmes et de préoccupations communes de part et d’autre de l’Atlantique. Au-delà des contextes particuliers liés à la place de l’histoire dans le développement des études théâtrales dans ces deux pays, ils conduisent à des constats similaires sur la nécessaire mise à jour du cadre épistémologique qui prescrit les bornes temporelles de l’analyse et délimite les frontières de l’objet. Ce faisant, ces deux articles illustrent un fait indéniable, en dépit de l’attachement à une « raison historique » opérant selon des règles rigoureuses : l’histoire relève d’un discours et elle engage l’historien à faire des choix, ceux-ci étant informés par des positionnements esthétiques, idéologiques et théoriques, afin de bien saisir les logiques à l’œuvre dans le développement des pratiques.
À l’enseigne du débat et de la polémique, qui stimule toute production historiographique, s’inscrit ouvertement l’article de Céline Philippe qui clôt la première partie de ce dossier. L’auteure s’attaque, tout en proposant d’en faire la généalogie, à l’un des motifs récurrents et structurants du discours sur le théâtre québécois de la période suivant le premier référendum sur la souveraineté-association du Québec de 1980. Construit sur ce qu’elle perçoit comme étant un ensemble d’a priori que l’étude des faits et des œuvres ne semble pas en mesure de soutenir, le thème de la dépolitisation ou de la dénationalisation de la production dramaturgique depuis 1980 aura en effet rallié une grande part des commentateurs au point de former une doxa. Céline Philippe examine comment celle-ci s’est élaborée, comment elle a été diffusée, pour ensuite procéder à sa réfutation au moyen d’une analyse « à rebrousse-poil » de certaines œuvres marquantes des dernières décennies dont les éléments fictionnels (personnages, temps et espace de l’action dramatique, etc.) pointent en direction d’une relecture de la question nationale.
Esthétiques et poétiques dans le discours de l’histoire : études de cas
Dans la deuxième partie du dossier, la contribution de Marie-Andrée Brault et Hélène Jacques, sur les avatars du réalisme dans le théâtre au Québec, met en lumière la fabrication d’une catégorie esthétique et idéologique qui a contribué largement à façonner l’identité de la scène québécoise depuis les années 1940 et ainsi constitué l’assise conceptuelle de son historicisation. Depuis le manifeste « Pour un théâtre national et populaire3 » de Gratien Gélinas, publié en 1949, lequel annonçait que la tâche du dramaturge était d’offrir un miroir à sa société, le credo du réalisme psychologique a inspiré de nombreuses vocations comme il a mobilisé des détracteurs, aussi bien parmi les artistes que dans la communauté critique et savante. L’éclairage qu’apportent Marie-Andrée Brault et Hélène Jacques permet de suivre à la fois les déclinaisons du réalisme dans la pensée théâtrale et d’appréhender les formes et les techniques qui, à travers le temps, lui ont permis d’évoluer, de se transformer, y compris dans des directions qui remettent en cause les généalogies construites par le discours historique.
Si le réalisme a été et demeure largement une marque distinctive du théâtre québécois, on peut en dire autant de la langue qui occupe indéniablement une place particulière dans le récit national et théâtral. Nicole Nolette rappelle à ce titre que l’avènement de la scène québécoise s’inscrit historiquement sous le signe d’une discordance avec l’usage normalisé du français et ouvrait, dans les années 1960 et 1970, un espace symbolique pour l’expression des « différences ». Depuis cette époque où triomphait Les Belles-sœurs de Michel Tremblay (1968), la langue théâtrale, associée elle-même au réalisme, a subi plusieurs métamorphoses ; mais l’auteure insiste cependant sur le fait que le parler québécois, jadis honni par les élites bien-pensantes, a acquis le statut de langue hégémonique sur les planches québécoises. C’est à ce pouvoir que doivent maintenant se mesurer les autres idiomes du théâtre et les locuteurs venus d’ailleurs, et Nicole Nolette d’analyser ici les procédés d’infiltration de ces langues dans le tissu linguistique des pièces produites au Québec. Mais elle s’intéresse également aux personnages d’étrangers dans les fictions dramatiques, qui peinent à se faire entendre à cause de leur accent, et aux artistes qui, depuis la position excentrée que leur confère notamment leur statut d’immigrant ou d’expatrié, doivent négocier leur droit de passage dans le milieu théâtral québécois en mimant l’idiolecte montréalais.
Points aveugles et autres histoires
Cette histoire des langues croise celle des communautés linguistiques cohabitant sur un même territoire scénique mais vivant des vies parallèles et se racontant des histoires différentes. Dans Le Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015, plusieurs pages sont consacrées à la production dramaturgique en anglais ; mais le récit sous-jacent que développe cet ouvrage décrit un mouvement qui aura conduit d’abord à la division progressive des artistes francophones et anglophones, et ensuite à la minorisation de ces derniers au sein du milieu théâtral québécois. Ouvrant la troisième partie du dossier, c’est précisément l’histoire retracée par l’article d’Erin Hurley qui pose, d’entrée de jeu, le paradoxe de la situation : comment une communauté disposant des leviers de la culture dominante en Amérique du Nord, par son usage de l’anglais, se retrouve-t-elle dans une position de marginalité à l’échelle de la scène ? La thèse défendue par l’auteure confirme que l’institutionnalisation de l’activité théâtrale a permis aux organismes et aux individus de se développer dans la durée ; mais en s’adaptant aux mutations politiques qui ont marqué le Québec depuis les années 1960, la communauté anglophone serait ainsi passée de culture de référence, adossée à l’empire colonial, au statut de minorité au sein de l’ensemble québécois. Signalons au passage que le théâtre de langue anglaise au Québec est par ailleurs tout sauf uniforme et monolithique, avec l’apport de communautés – dont les Juifs et les Afro-descendants – qui optent pour l’anglais sans pour autant partager une même culture dramaturgique ou un même répertoire.
Fort de ce constat, on comprend alors aisément que la situation des Premières Nations soit caractérisée par une double marginalisation, résultant d’une part de leur invisibilité dans le champ politique et d’autre part d’une différence marquée chez les peuples autochtones dans leur conception des pratiques spectaculaires avec celle en vigueur dans l’espace culturel dominant. L’article d’Astrid Tirel examine ces effets de décalage qui expliquent partiellement pourquoi la production autochtone demeure un point aveugle dans le récit du théâtre québécois, tout en mettant en évidence les multiples initiatives, récentes et moins récentes, qui témoignent d’un renouveau artistique et surtout d’une volonté de décoloniser la scène autochtone afin de stimuler la création au sein même des communautés et d’offrir à celles-ci une visibilité accrue.
En clôture de ce dossier, l’article d’Hervé Guay propose une réflexion, à partir d’une étude de cas, sur les conditions de possibilité mais également sur la fonction d’un théâtre national. L’auteur insiste sur le caractère paradoxal de cette « institution » dans l’historiographie en soulignant combien chaque génération, depuis le début du XXe siècle, a rêvé à l’établissement d’une scène nationale mais sans jamais se donner les moyens pour qu’elle advienne réellement. L’auteur raconte ici, tout compte fait, l’histoire d’une absence, d’une carence au cœur de la vie artistique qui a fait dire à certains que le théâtre québécois resterait à jamais une œuvre inachevée faute d’un lieu et d’une compagnie incarnant l’excellence en la matière et diffusant – et célébrant – celle-ci à la grandeur du territoire. En comparaison du modèle européen et de celui que représente en France la Comédie-Française, les tentatives d’édification d’une scène nationale au Québec ont été timides, pour dire le moins, en raison du manque de soutien de l’État – dont la vocation nationale apparaît déjà problématique – et d’un fonctionnement institutionnel horizontal qui reposait sur une forme d’indépendance vis-à-vis du pouvoir et sur l’arbitrage des ressources par les pairs. Au-delà du déficit de prestige lié à l’absence d’une telle scène nationale, l’analyse d’Hervé Guay permet ainsi de comprendre, dans une perspective historique, selon quelles modalités sont définies, au Québec, les relations du milieu théâtral avec l’instance politique.
Notes
1 Jean-Marc Larrue. « Mémoire et appropriation. Essai sur la mémoire théâtrale au Québec », L’Annuaire théâtral, nos 5-6, automne 1988-printemps 1989, p. 61-72.
2 Gilbert David (dir.), avec la collaboration de Hervé Guay, Hélène Jacques et Yves Jubinville, Le Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et socio-esthétique, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2020.
3 Gratien Gélinas, « Pour un théâtre national et populaire », Amérique française, nouvelle série, vol. 3, no 3, 1949, p. 32-42, allocution prononcée à l’Université de Montréal, le 31 janvier 1949.
Pour citer cet article
Hervé Guay, Yves Jubinville, « Introduction : bilan critique d’une aventure de recherche », Revue d’Historiographie du Théâtre numéro 6 [en ligne], mis à jour le 01/01/2021, URL : https://sht.asso.fr/introduction-bilan-critique-dune-aventure-de-recherche/