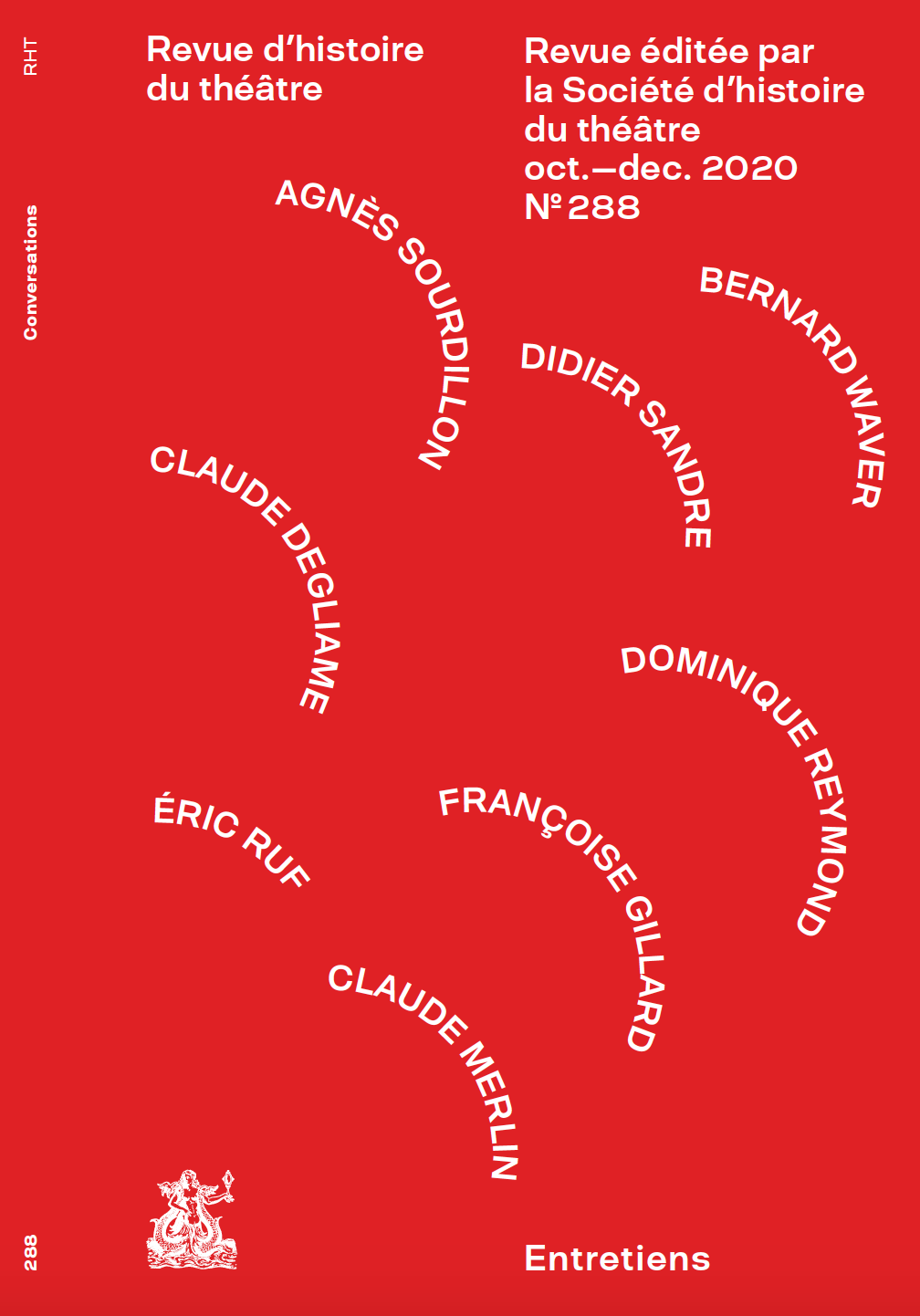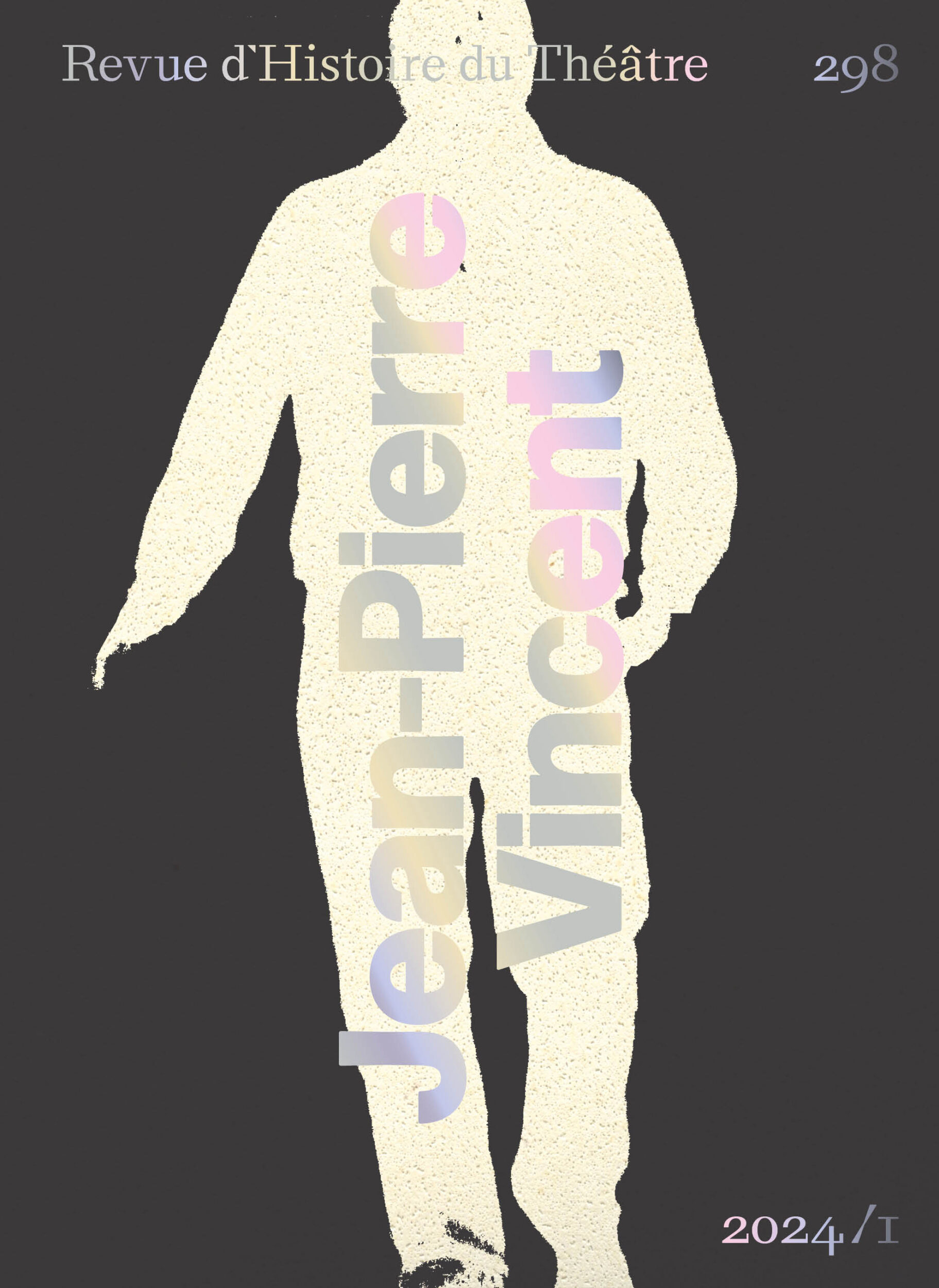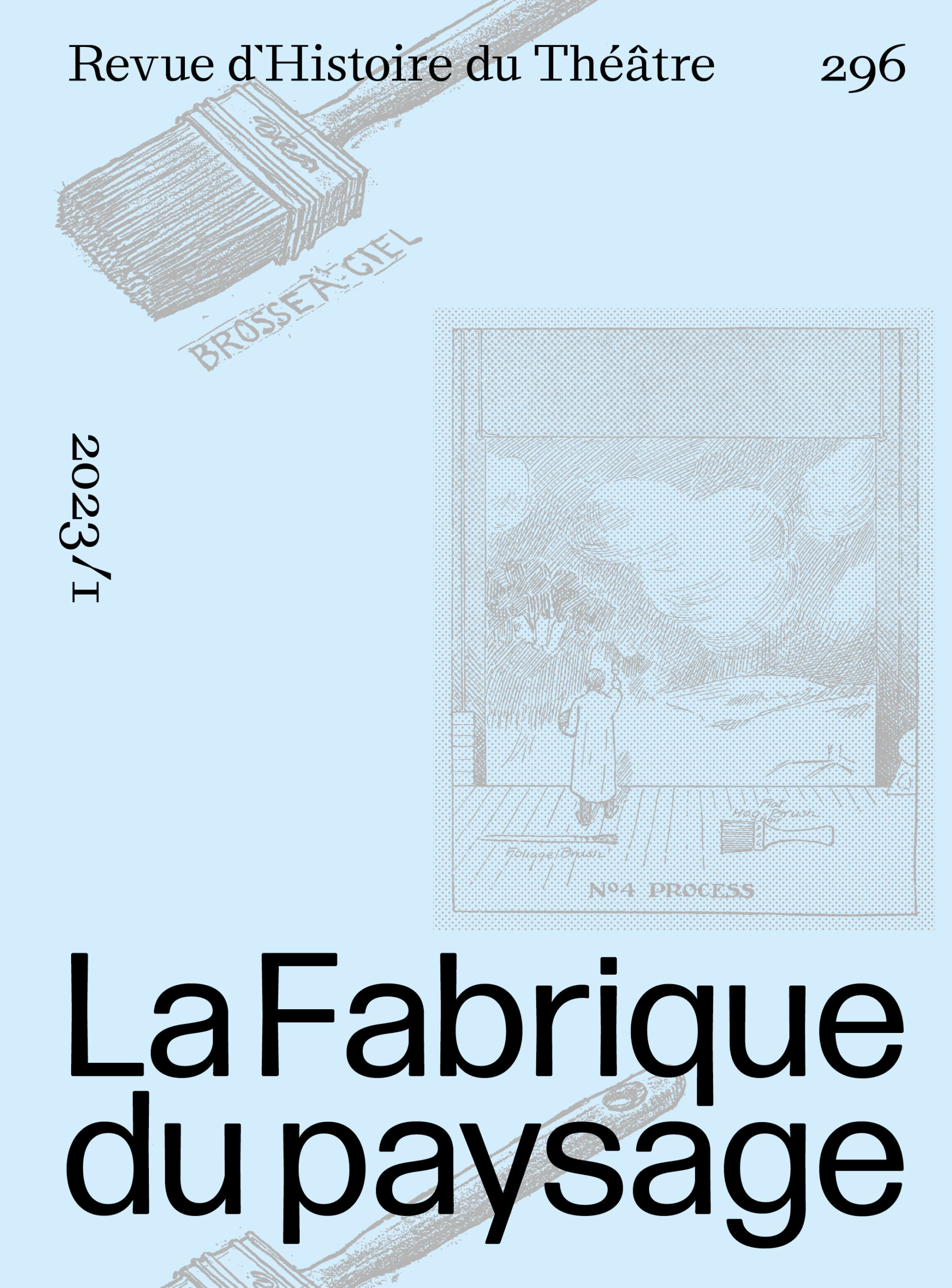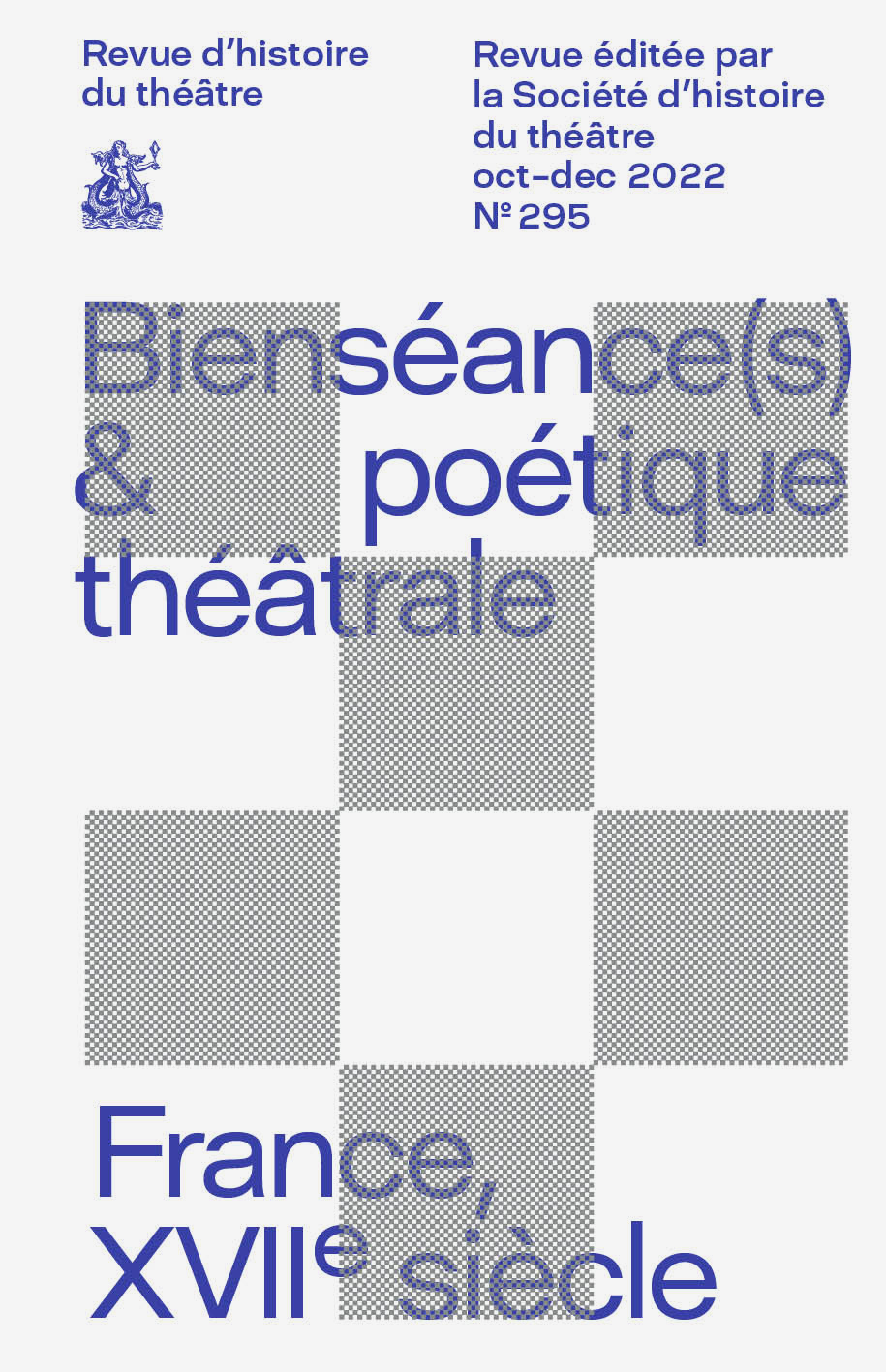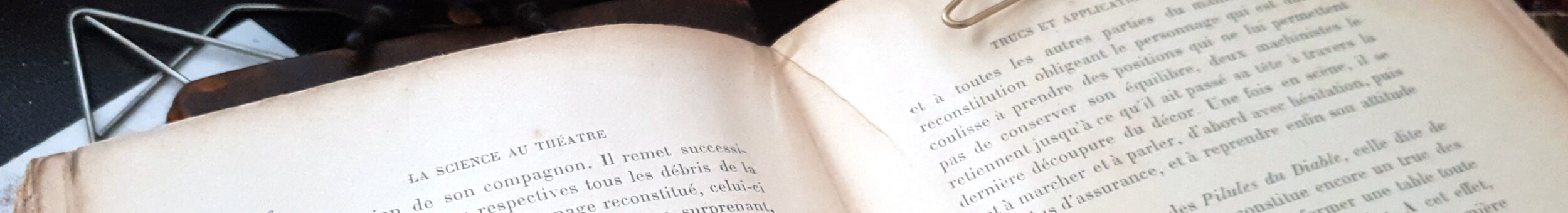Revue d’Histoire du Théâtre • N°288 T4 2020
Introduction : Paroles et écrits de l’acteur
Résumé
Les entretiens qui paraissent sous le titre Paroles et écrits de l’acteur sont nés de la question lancinante suscitée par le spectacle des comédiens en jeu : comment saisir l’écriture de ces acteurs, dont le style semble écrire une histoire au-delà des rôles qu’ils interprètent et des mises en scène qui les font entendre? Et quelle histoire composent-ils ?
Donner la parole aux acteurs eux-mêmes pour répondre à ces questions est d’abord une manière de réinscrire leurs propos dans une perspective longue, depuis l’émergence de leurs écrits à la fin du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui : c’est rétablir le statut de leur voix à travers le temps, en souligner la continuité et en interroger la rareté. C’est ensuite parier sur l’existence d’une poétique propre à cette parole, poétique qui ne peut se constituer qu’au travers d’une durée assumée, et qui, se révélant d’une nature semblable au jeu, éclairera quelque chose de sa texture, de sa structure, de son battement.
Texte
Cette publication constitue le premier volume d’une série de trois recueils d’entretiens menés avec des comédiennes et comédiens entre 2013 et 2020. Leur parution s’échelonnera sur les trois prochaines années dans les pages de la Revue d’Histoire du Théâtre. Louis Jouvet avait souhaité donner naissance à une entité – qui serait à la fois lieu de recherche, de réunion, d’exposition et organe de presse – dédiée au théâtre : son histoire, son répertoire, ses techniques et ses acteurs. Il nous a semblé que la revue issue de la Société d’Histoire du Théâtre ne pouvait être mieux indiquée pour recevoir la parole de ceux, actrices et acteurs, qui ont donné vie à cette utopique entreprise, dont le long cours s’est achevé au moment où une épidémie historique fermait pour des mois les théâtres dans le monde. Faire entendre la voix des comédiens alors que les salles ont été réduites au silence est déjà une manière de leur rendre hommage quand on ne peut plus les applaudir ; faire entendre la voix des comédiens tout court était mon projet1.
Son point de départ est d’enfance : rester fidèle aux éblouissements d’origine. Ils étaient de deux ordres, littéraires et théâtraux. Comme je n’ai eu de cesse de rechercher ce qui, au fond des textes, produit le magma au contact duquel quelques heures on brûle ; de même ai-je fixé un regard jamais rassasié sur cette matière incandescente au cœur de la représentation, l’acteur, pour tenter de saisir comment il me rivait à lui, et nous rivait ensemble à ces choses innommées auxquelles le théâtre livre fugacement accès. Ce questionnement m’a conduite à tenter d’analyser pour moi-même, en tant que spectatrice, ce que j’éprouvais des comédiens en scène ; ce que je pouvais déduire, en les observant, des moyens mis en jeu, des effets produits, des phénomènes suscités entre eux et la salle. Comme dans les romans, où j’étais attentive au geste d’écriture plutôt qu’à l’histoire racontée, il m’apparaissait que je m’attachais aux comédiens dont le style écrivait une histoire au-delà des rôles qu’ils interprétaient et des mises en scène qui les faisaient entendre. C’est cette écriture que j’allais chercher, d’un spectacle à l’autre, en suivant les acteurs d’année en année.
Comment saisir l’écriture des acteurs, et quelle histoire compose-t-elle ? Les entretiens présentés dans ces trois volumes sont une des formes qu’a prise la recherche ouverte par cette interrogation. Ils sont issus d’un double constat : dès lors qu’il s’agissait de circonscrire précisément les composantes du jeu ordonnées autour de la préparation, de la répétition et de l’interprétation d’un rôle, la voix des acteurs a toujours été présente et elle a toujours été rare. En a découlé un double besoin : entendre à nouveau la parole des comédiens sur leur pratique ; la resituer dans l’histoire longue du théâtre, dans la suite des paroles et des écrits de l’acteur, depuis leur émergence à la fin du XVIIe siècle jusqu’aujourd’hui.
On peut établir (cet avant-propos n’est pas le lieu pour le faire) les circonstances historiques et les causes, successives ou simultanées, de natures très diverses, de ce faible enclin des comédiens à parler de leur art ou à en écrire. Je mentionnerai dans un instant celles qui ont directement agi sur la constitution des entretiens. Telle fut cependant la demande adressée à celles et ceux dont le jeu a soulevé ces questions et qui sont donc, à tous égards, les auteurs de ce livre : Quelle conception avez-vous de votre art ? Comment pensez-vous votre travail, comment le formulez-vous ? Le jeu de l’acteur se laisse-t-il décrire et analyser ? Quels rapports entretenez-vous avec ceux qui en ont écrit avant vous ? On n’a cessé de qualifier d’éphémère un art qui, sans doute de ce fait même, et par la singularité du savoir qu’il tire des corps et des ressorts intimes de l’être, a au contraire fait l’objet d’une transmission particulière, de sorte qu’il s’écrit peut-être plus encore qu’un autre dans l’histoire. Les comédiens que vous êtes s’inscrivent-ils dans cette histoire – ou bien l’histoire a-t-elle aussi cessé d’avoir cours au théâtre ? Peut-on parler, parmi les acteurs, de généalogie, de filiation, de lignées ? Ces familles d’acteurs que je vois se constituer d’une génération à l’autre, en tant que spectatrice ; ces traces d’un ou d’une autre que je lis distinctement dans le jeu d’un ou d’une telle, quelle réalité ont-elles pour vous ? De leur travail, de leur recherche, de leurs aspirations, de leurs admirations, de leurs désaccords, les acteurs parlent-ils entre eux ?
L’entreprise visait avec conscience un horizon inatteignable, un impossible qui pourrait sembler départager ceux qui s’expriment dans ces pages. Pour les uns, il est vain de parler du travail de l’acteur, rien ne vient désopacifier l’inextricable assemblage d’éléments de nature si hétérogène, ni sa mise en branle à l’instant d’entrer en scène ; les autres considèrent avec intérêt une tentative qui recoupe leurs propres efforts d’élucidation d’une pratique dont tous reconnaissent qu’elle continue à leur échapper. L’activité du comédien s’éprouve, s’énonce donc, dans un présent toujours mouvant, constituant un art à part en ce qu’il n’offre pas d’objet à fixer. Tous en témoignent, et c’est comme une basse continue de leurs propos : rien qui se puisse thésauriser, mais, chaque fois, la nécessité de repartir de zéro. Toute recherche de formulation synthétique des opérations d’observation, exploration, glanage, vagabondage, feuilletage, modelage, tressage, équilibrage, sélection, condensation, composition entraînées par la création d’un rôle prend ainsi l’allure d’une gageure désespérée : à peine a-t-on dégagé une première strate du travail qu’elle manifeste son insuffisance et réclame l’apport des suivantes, qui à leur tour font entendre autrement ce qui s’est déjà dit et demandent qu’on y revienne, dans un inlassable mouvement de reprise caractéristique de l’œuvre sans fin d’un Jouvet écrivain.
En réalité, cette ligne ne départage personne. Les paroles des uns et des autres se répondent, semblablement exigeantes, critiques à leur propre égard, dubitatives et questionnantes. Un fonds commun s’en dégage, jusque dans la « surface » couverte par les mots prononcés, qui déterminent une sorte de limite perceptible bien que non-dite : à la fois plancher et plafond, au-delà desquels l’acteur, parce qu’il a l’exclusivité d’un rapport physique au langage, s’aventure hors des territoires que le verbe peut circonscrire2. De fait, des années passées à écouter une parole s’agencer, à retranscrire les enregistrements, à donner forme écrite à l’oral, à comprendre ce qui tente de se dire dans les phrases inachevées et comme souterrainement les idées se relient, ont fait entrevoir la manière dont une phrase simple d’apparence, et qui donne l’impression d’aller de soi ou d’appartenir à une certaine vulgate, peut livrer accès à ce qu’une longue expérience indissociable d’une constante réflexion permet de réactiver des facultés et des mécanismes internes fondamentaux, à la fois physiques et mentaux, de l’homme, à condition que ces derniers aient été préalablement éprouvés. De quelque côté qu’on l’envisage, la fabrique de l’acteur se joue des rets de l’organisation discursive. Aussi l’enjeu était-il de relancer une parole qui s’articule autour de cette impossibilité même, et puisse être entendue comme représentative d’un état du discours de l’acteur sur sa pratique à un moment donné, s’insérant dans la continuité de publications et témoignages précédents dont l’ensemble mettrait au jour ce que serait une poétique de l’acteur sur son art.
La véritable ligne de partage est ailleurs, entre le parlé et l’écrit. L’étape de la mise en forme du texte en vue de son édition, impliquant le choix d’une version « définitive » et la nécessité d’une relecture globale, a été décisive. Parce que le procédé de la publication transforme l’objet, parce que l’écriture pétrifie la matière vive du dialogue, en mouvement elle aussi, et que par elle ce qui s’était dit dans la chaleur d’un échange personnel devient parole publique prétendant à une vérité générale, cette étape a entraîné diverses réactions, dont le refus de publier. Le projet a plié, avec douleur et gratitude, devant l’intégrité artistique de l’« acteur-indien », ayant fait choix de son métier pour disparaître, prenant en toute rigueur le parti de consentir à l’oubli, au silence, au hasard, comme un hommage rendu à l’homme, à cet homme que le théâtre refait chaque soir : sa force de défiguration, de dépossession et de recommencement. De sorte que ce livre est tout autant, pour bien des raisons qu’il ne convient pas de détailler ici, l’histoire de son envers : à la fois le pari fait de cette parole-périlleuse en équilibre sur son fil « momentané » et le pari de son silence. Comme tout vrai tableau, chaque texte s’y écrit sur des couches successives de mots retenus, tus ou effacés, un retrait central dont la résonance traverse et densifie les mots imprimés.
C’est en quoi ces paroles sont, plus que d’autres, miroitantes, à l’image du jeu de l’acteur dont on perd la substance à vouloir le figer. Qui veut s’en saisir se retrouve les mains vides. Elles se révèlent extraordinairement vibratiles et non emprisonnables.
notes
1. Je tiens à remercier ici Leïla Adham, maître de conférences en études théâtrales à l’université de Poitiers, sans qui rien n’eût commencé, le projet ayant été initialement conçu, sous une autre forme, en collaboration avec elle dans le cadre des actions de recherches collaboratives entre les universités de Tours et de Poitiers. Les fonds n’ayant pas été obtenus, cette recherche a finalement suivi un autre cours.
2. Je remercie mon complice et remarquable analyste du fait de l’acteur, Louis Dieuzayde, des échanges qui ont nourri cette réflexion.
Pour citer cet article
Marion Chénetier-Alev, « Introduction : Paroles et écrits de l’acteur », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 288 [en ligne], mis à jour le 01/04/2020, URL : https://sht.asso.fr/introduction-paroles-et-ecrits-de-lacteur/