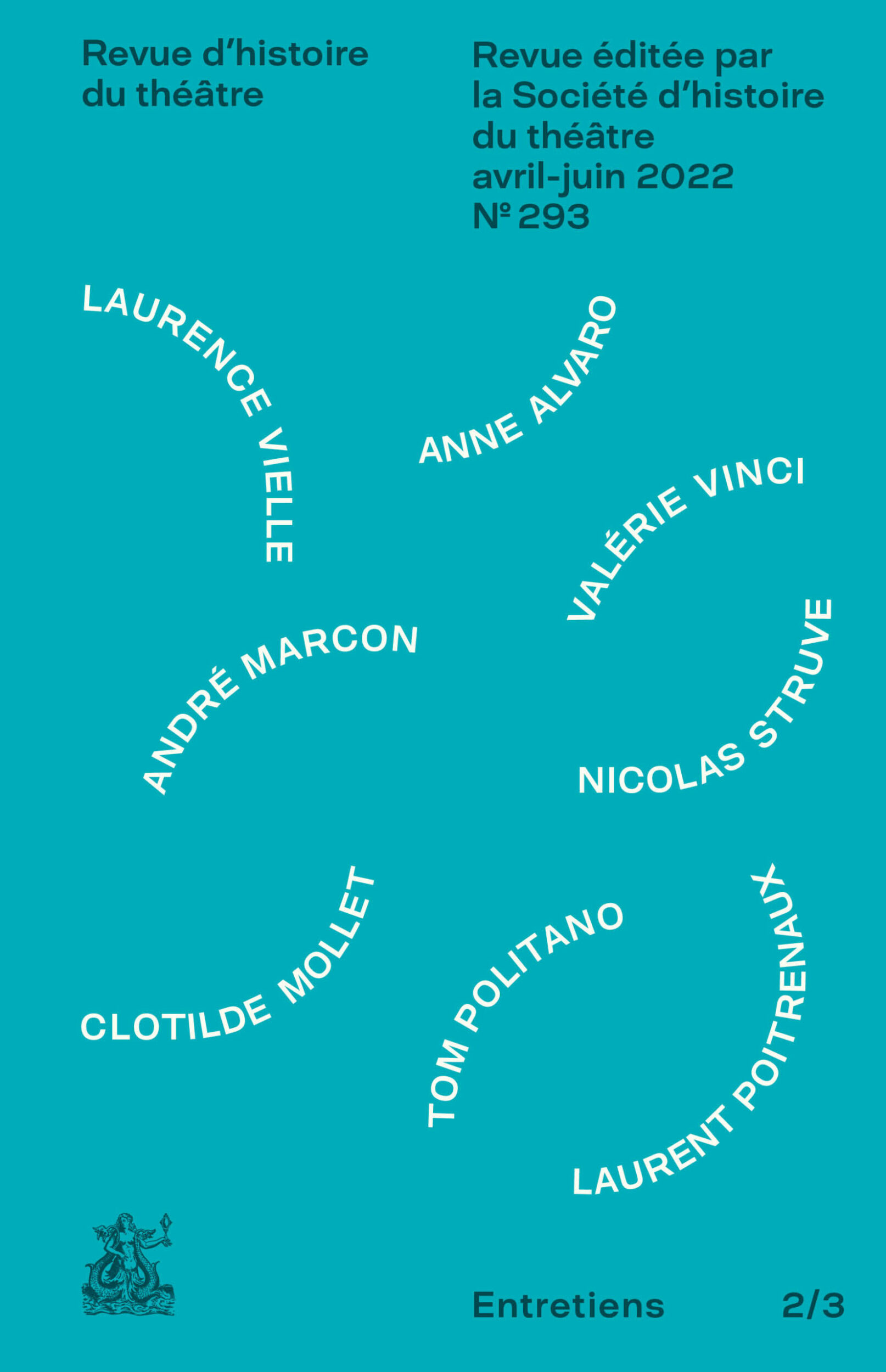Revue d’Histoire du Théâtre • N°293 T2 2022
Paroles et écrits de l’acteur
Résumé
Les entretiens qui paraissent sous le titre Paroles et écrits de l’acteur sont nés de la question lancinante suscitée par le spectacle des comédiens en jeu : comment saisir l’écriture de ces acteurs, dont le style semble écrire une histoire au-delà des rôles qu’ils interprètent et des mises en scène qui les font entendre? Et quelle histoire composent-ils ? Donner la parole aux acteurs eux-mêmes pour répondre à ces questions est d’abord une manière de réinscrire leurs propos dans une perspective longue, depuis l’émergence de leurs écrits à la fin du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui : c’est rétablir le statut de leur voix à travers le temps, en souligner la continuité et en interroger la rareté. C’est ensuite parier sur l’existence d’une poétique propre à cette parole, poétique qui ne peut se constituer qu’au travers d’une durée assumée, et qui, se révélant d’une nature semblable au jeu, éclairera quelque chose de sa texture, de sa structure, de son battement.
Texte
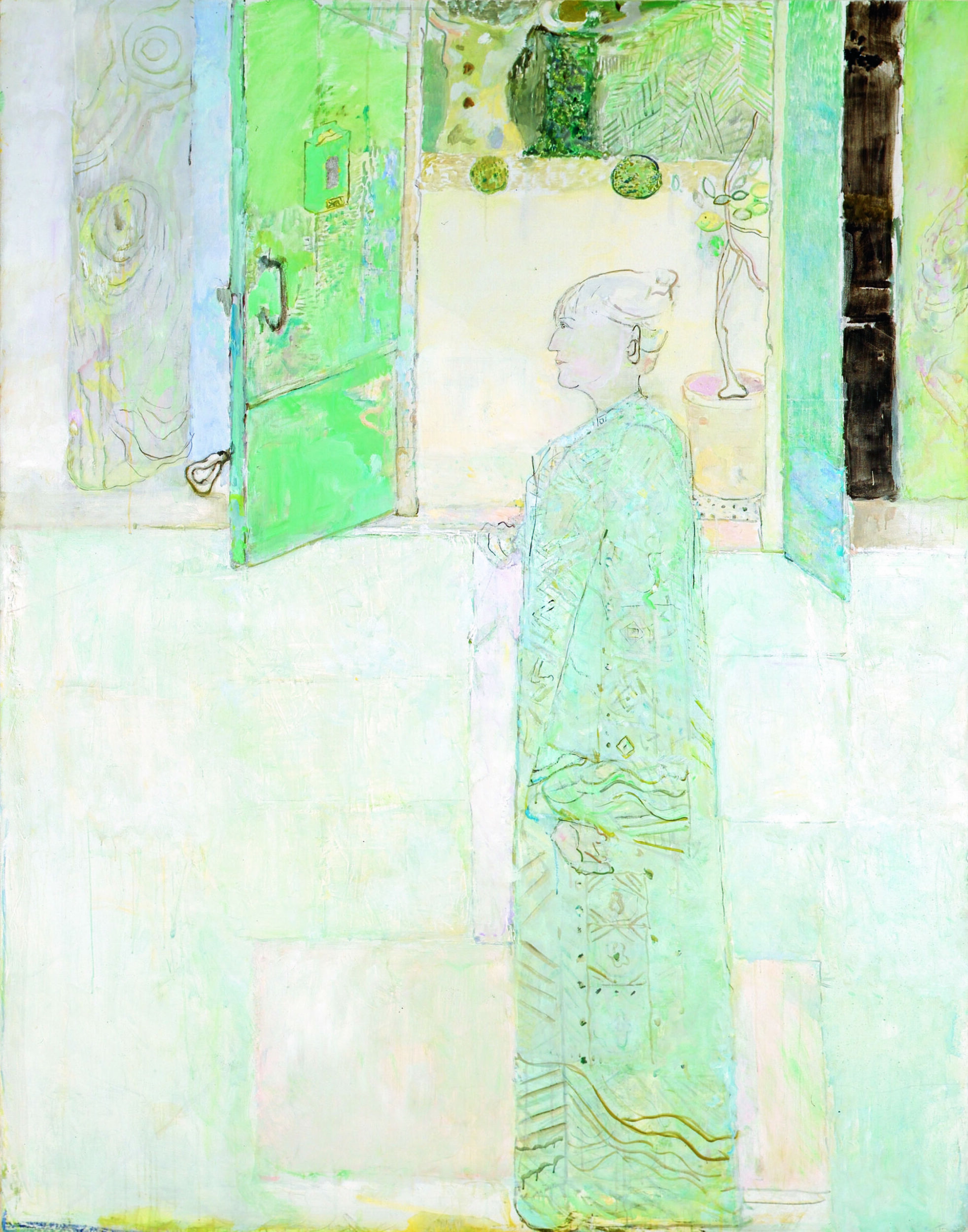
Cette publication constitue le second volume d’une série de trois recueils d’entretiens menés avec des comédiennes et comédiens entre 2013 et 2020, accueillis dans les pages de la Revue d’Histoire du Théâtre. Bien que composée d’entretiens individuels dont chacun peut être lu de façon autonome, cette trilogie a été pensée comme un ensemble, construisant à l’intérieur de chaque volume, et d’un volume à l’autre, les appuis et les espaces nécessaires aux phénomènes d’échos, de circulations, de débats, de sorte que l’on puisse entendre comme une seule conversation à vingt-quatre. Nous invitons le lecteur, s’il le souhaite, à se reporter à l’introduction du premier volume, qui revient sur les origines et les enjeux de ce projet. Elle soulève, parmi d’autres, la question de l’histoire du théâtre. Elle interroge la matière à partir de laquelle cette histoire s’écrit, et le besoin qui se fait sentir de l’écrire : celui qui poussa Jouvet à créer une société d’histoire du théâtre, suscitant un vaste réseau de correspondants chargés de collecter toute trace du passage des comédiens par les pays, les provinces et les planches. Elle interroge la manière dont acteurs et spectateurs trament cette mémoire, soit que les premiers livrent eux-mêmes des archives ou rédigent des textes, soit que les seconds témoignent de ce qu’ils ont vu à travers leurs propres œuvres ; et la possibilité qu’une telle mémoire se transmette, entre individus et entre générations. Elle évoque l’utopique tentative de donner forme par les mots à l’empreinte que laisse un acteur dans l’esprit, le regard, le corps, de ceux qui, sur scène ou dans la salle, l’ont approché.
Un acteur – une actrice – meurt – entre dans l’histoire – devient mémoire.
Au foyer de projections que son corps traversé a suscitées et diffractées, se substitue un nouveau foyer, non moins imaginaire, ni moins vivant.
En novembre 2010, dans le cadre médité par Patrice Chéreau, scénographié par Richard Peduzzi, d’un immense décor recréant sur la scène du Théâtre de la Ville le salon Denon du Louvre, le rouge enveloppant de ses murs comme une antre matricielle, ses toiles démesurées, historiques et mythologiques, apparaissait, sans qu’on puisse déterminer exactement le moment où elle était entrée, la comédienne Michelle Marquais, que je voyais pour la première fois[1]. Je la voyais, et je ne la voyais pas. J’étais assise trop haut dans la salle, sa silhouette était perdue dans le décor, l’expression de son visage ne m’était pas perceptible. Et j’étais tout entière requise par le choc de cette mise en scène de la pièce de Jon Fosse[2], a priori si éloignée de son univers, travaillant à surmonter ma réaction de rejet initial provoquée par la diction particulière de Valeria Bruni Tedeschi, avant d’être peu à peu entraînée puis captive du vertige que façonne Fosse, servi par l’interprétation brûlante de tous les comédiens au plateau. Mais je n’avais rien vu de Michelle Marquais. Je suis sortie sans mémoire d’elle.
Pouvais-je voir ? Assise au plus près de la scène, j’aurais vu sa haute stature, la découpe charpentée de son corps, la puissance retenue qui s’en dégage, que l’âge renforce, la splendeur des pieds massifs et nus dont je devine le plaisir qu’elle avait à les poser sur ce vaste plancher. Je me serais gravée dans l’esprit la trajectoire de son regard – errant d’abord, chargé de souvenirs – découvrant incrédule le public – puis dans une quête éperdue – avant que les yeux se referment et entraînent le corps dans l’affaissement de la Vierge du retable d’Issenheim – mais il n’y a plus de Jean, ici, pour le retenir. Rétablissement de l’équilibre, la fin de la phrase devient le tremplin de la suivante, la douleur qui voulait descendre remonte avec la main de la comédienne le long des tiges vertes, provoque le sanglot qui ébranle son dos et plonge son visage dans les fleurs qu’elle étreint comme on respire une dernière fois l’odeur de l’être perdu. L’expression la plus aiguë de la souffrance, qui plisse ses traits, est déjà passée, déjà passage, vers la phrase suivante, le bouquet est reposé sur le bras comme un nouveau-né, le regard se relève vers le public, il a changé sept fois, la tête tourne, attirée par les tableaux suspendus au mur, le regard change encore, tout le corps pivote.
La séquence dure soixante secondes. Elle est écrite par l’actrice en scène d’un seul trait.
Elle aurait été pour moi exemplaire de l’art de l’acteur – sa partition rigoureuse des pensées, des émotions, des sensations, son dressage intérieur, sa science très ancienne du rythme, sa parfaite maîtrise du jonglage avec les signes : assez dessinés pour qu’on les voie, assez rapides pour qu’on doute les avoir vus, assez légers pour qu’ils demeurent oiseaux, assez graves pour qu’ils nous poignent.
Mais je n’aurais pu voir cela en une seule fois. J’aurais su seulement, à cet état en moi si reconnaissable de saisissement intérieur, le corps tendu comme un chien sur la piste, que j’étais face à l’incandescence. Et dans cet état de « voyant » en quoi l’acteur juste nous transforme, quand il donne accès à l’envers des mots et à l’horizon des signes, j’aurais vu l’air déchiré de ces deux éclairs : le bouquet empoigné jusqu’au visage, et son écho amplifié, une minute après, le même bouquet décrivant un arc violent depuis la hanche jusqu’au visage qu’il vient presque fouetter, ployant la nuque, l’entraînant dans le demi-cercle qui incline tout le dos, puis les fleurs, vers le sol. Un geste-cri, de sursaut sauvage, d’appel désespéré. Un mouvement absolument singulier, inimitable (non-anticipable), alors qu’il se noue aussitôt à d’autres qui tapissent la paroi de la caverne obscure, telle fulgurance d’un acteur de Kantor, du Nô, ou de Pina Bausch. Un geste de danse, sur les premières mesures de la voix chavirée de Chavela Vargas. Qui tire son retentissement de son imprévisibilité, et de surgir sur une ligne de jeu totalement dépouillée d’effets ; de la conscience de son tracé dans l’espace ; de sa cohérence stylistique. Qui bouleverse enfin parce qu’il est exécuté de la manière la plus simple et qu’il traduit organiquement ce qu’il y a de plus profond.
Ces deux gestes, je les ai regardés cent fois. Ils font désormais partie de moi.
Mais, pendant la représentation, je n’aurais eu que le temps de me supplier de ne pas les oublier – et mes bras mentaux se seraient refermés sur le vide.
Seule la caméra me donne accès à l’écriture ineffaçable d’un rôle du silence et du hors champ[3], que l’art de l’acteur et celui du metteur en scène transmuent en foyer central, où la Mort devient présence attentive et source lumineuse de tout le tableau, où la chemise immaculée portée par Michelle Marquais, sous sa robe de chambre bleue, et l’auréole de ses cheveux blancs, répondent, verticalement, au corps livide du Christ couché sur son linceul et au manteau de la Vierge dans la Pietà de Le Brun – vision que ménage dans le décor la diagonale menant à l’arrière-plan.
Ne sachant rien de la comédienne au plateau, qu’aurais-je pu voir ?
Comment aurais-je deviné ce qu’alors elle tissait entre elle et son rôle, avec ces fleurs, qu’elle finissait par déposer aux pieds d’un tableau ? Avec les tableaux accrochés aux murs, dont elle caressait l’absence ? Avec l’espace du musée ? Avec la disparition des êtres qu’on aime le plus ?
Qu’aurais-je entendu de l’intime complicité qui s’exprimait par ce spectacle entre elle et le metteur en scène, de leur dialogue muet, par-delà les ans ? Quelles correspondances alors auraient pu naître, de sa présence fantomatique dans Rêve d’automne aux figurations transparentes qu’a faites d’elle Pierre Lesieur ?
Combien de fois faut-il regarder un acteur dans le même rôle pour commencer à entrer dans sa fabrique ? Quelle pratique du théâtre pour cette pratique du regard ? Le sociétaire Edmond Got, aussi fin comédien qu’inlassable observateur du métier, rapporte dans son Journal, à propos de Frédérick Lemaître, qu’il « le [tenait] à miracle », signifiant qu’il l’imitait à la perfection, au même titre que d’autres, Philoclès Regnier en particulier (j’aime à citer le nom de ce comédien si parfaitement oublié et qui fut déterminant à tant d’égards dans l’histoire du théâtre, dans celle de Molière et dans l’évolution du jeu), parce qu’il passait ses soirées, des années durant, à les aller voir jouer. Et il se demande, lui dont le visage ressemblait à celui du grand interprète du Boulevard : « Mais comment démarquer suffisamment pour mon profit de comédien un type encore si connu de tout Paris ? » Fils imperceptibles et précieux avec lesquels l’historien confectionne l’architecture fragile de sa toile.
Écrire sur ce qui est perdu, que le manque s’en fasse sentir, et donne lieu au désir d’y répondre. Ne pas laisser s’éteindre le feu (l’ardeur et la quête qui s’exprimaient en ce corps, par ce souffle), mais recréer le foyer, mais garder l’empreinte vivante. Tirer les fils, les croiser entre eux, les charger d’électricité, en faire ces vecteurs vibratoires qui repèrent et propagent les présences, les conduisent à se rencontrer :
Michelle Marquais, passage dialectique entre Jouvet-Baty-Le Roy et Debauche-Chéreau-Planchon ; à la bascule d’un théâtre qui opère sa mue sous la poussée du cinéma ; tenant d’une main la musique de Racine, de l’autre celle de Novarina qu’à travers la bouche d’André Marcon elle fait entendre pour la première fois[4] ; épousant Roger Blin dans une pièce d’O’Neill[5] et distribuant Philippe Clévenot dans celle de Gergely Csiky[6] ; louant la démesure des Casarès et Kedrova tout en s’inscrivant dans la lignée des intensités rentrées d’Yvonne de Bray et Lucienne Bogaert ; interprète muette d’un mémorable four de Claude Régy avant que la critique n’ait plus le droit d’en parler[7] ; interprète à deux reprises et treize années d’intervalle, avec Roland Blanche, de Tout contre un petit bois[8] ; Arkadina iconoclaste dans la mise en scène renversante de Lucian Pintilie[9] qui liquide l’héritage des Pitoëff. Neuf ans plus tard, Dominique Reymond jouait Nina sous la direction d’Antoine Vitez[10], puis, à son tour, Arkadina[11], dans un spectacle qui commençait par faire retentir, entre les murs de la Cour d’Honneur, les voix des comédiens disparus.
Le jeu de l’acteur vit des mémoires dont le spectateur le fait résonner.
[1] Michelle Marquais, née en 1926, s’est éteinte le 29 janvier 2022. Ce volume lui est dédié.
[2] Jon Fosse, Rêve d’automne, mise en scène de Patrice Chéreau, création le 22 novembre 2010 au Théâtre d’Orléans.
[3] Le spectacle de Patrice Chéreau a été filmé par Stéphane Metge en 2011, sous le titre Rêve d’automne, une production Arte France, Bel Air Media, Ina.
[4] Valère Novarina, Le Drame de la vie, mise en voix de Michelle Marquais, interprétation d’André Marcon, le 11 décembre 1982, à Théâtre Ouvert.
[5] Eugène O’Neill, De l’huile, mise en scène et réalisation de Jacques Trebouta, ORTF, 1966.
[6] Gergely Csiky, D’honorables canailles, adaptation et mise en scène de Michelle Marquais, création le 1er octobre 1998 au Théâtre de Chartres.
[7] Claude Régy, Vermeil comme le sang, mise en scène de l’auteur, création le 19 février 1974 au Théâtre national de Chaillot.
[8] Jean-Michel Ribes, Tout contre un petit bois, mise en scène de l’auteur, création le 14 septembre 1976 au Théâtre Récamier, reprise en mai 1990 au Théâtre de la Renaissance.
[9] Anton Tchekhov, La Mouette, mise en scène de Lucian Pintilie, création le 18 février 1975 au Théâtre de la Ville.
[10] Anton Tchekhov, La Mouette, mise en scène d’Antoine Vitez, création le 9 février 1984 au Théâtre National de Chaillot.
[11] Anton Tchekhov, La Mouette, mise en scène d’Arthur Nauzyciel, création le 20 juillet 2012 dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes.
Pour citer cet article
Marion Chénetier-Alev, « Paroles et écrits de l’acteur », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 293 [en ligne], mis à jour le 01/02/2022, URL : https://sht.asso.fr/paroles-et-ecrits-de-lacteur/