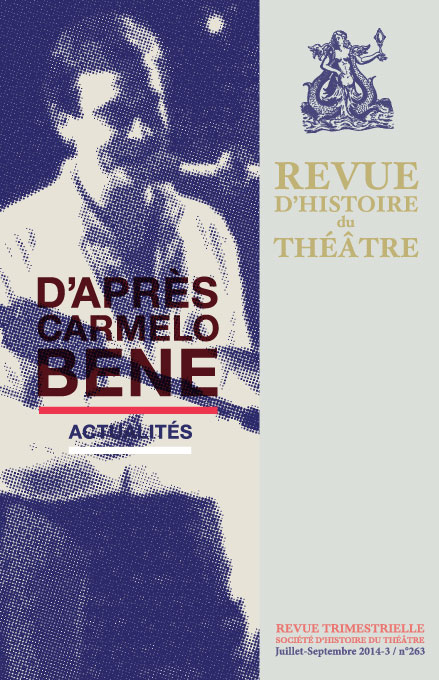Revue d’Histoire du Théâtre • N°263 T3 2014
Comptes rendus RHT#263
Par Edith Séléna, Odette Aslan, Gilbert Py, Agathe Sanjuan
Résumé
Comptes rendus des ouvrages suivants :
Louis Jouvet, introduction et choix de textes par Ève Mascarau, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Mettre en scène », novembre 2013.
Par Edith Séléna
Françoise et Roland Labarre, Seize aperçus sur le théâtre espagnol du Siècle d’or, Genève, Droz, 2013.
Par Odette Aslan
Le théâtre espagnol du Siècle d’Or en France. De la traduction au transfert culturel, P. U. de Paris Ouest, coll. « Littérature et poétique comparée », 2012.
Par Odette Aslan
Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, vol. 16 : Théâtre – écrits sur le théâtre, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 2012.
Par Gilbert Py
Nicole Bernard-Duquenet, La Comédie-Française en tournée ou Le Théâtre des cinq continents, 1868-2011, préface de Muriel Mayette, L’Harmattan, 2012.
Par Agathe Sanjuan
Texte
Louis Jouvet, introduction et choix de textes par Ève Mascarau, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Mettre en scène », novembre 2013.
| par Edith Séléna
Celui que Jacques Copeau appelait en 1913 « Mon cher petit Jouvey » (nom qui s’écrira par la suite Jouvet) et qui, quarante ans durant, ne répondit jamais que par « Mon Patron », « Mon cher petit Patron », « Mon grand Patron », devint à son tour le Patron de sa troupe. Mais il n’aura pas gagné pour autant en certitude. Il semblerait qu’au long des années, il poursuive avec lui-même ses constantes interrogations dont témoignaient toutes les lettres qu’il échangea avec Copeau à l’époque du Vieux-Colombier et bien au-delà[1]. En témoignent ses ouvrages sur l’art du comédien, la recherche du personnage, et plus éloquemment encore, le choix de textes sur la mise en scène qu’Ève Mascarau vient de rassembler dans la collection « Mettre en scène » où figuraient déjà, pour le Cartel, Charles Dullin et Gaston Baty.
On ne découvre dans ces textes épars, inédits ou épuisés, extraits du Fonds Jouvet de la Bibliothèque nationale, aucune méthode, aucun enseignement ni déclaration péremptoire. On constate l’inquiétude permanente d’un artiste qui s’interroge sur sa pratique mais ne peut dire avec des mots comment il procède. Il creuse, il taraude, tourne sans cesse autour d’une définition, d’une explication de la mise en scène qui lui demeure à jamais énigmatique. Par quelle mystérieuse alchimie tous les éléments consciemment assemblés président–ils chaque soir à l’éclosion d’un spectacle, toujours semblable mais jamais tout à fait le même d’un soir à l’autre ? Qu’est-ce qui échappe au metteur en scène, censé tout diriger ?
Pour compenser ses doutes, Jouvet s’arrime à la machinerie, aux éléments concrets du plateau, il côtoie ses machinistes, compagnons de tous ses efforts. Interrogé en 1919 sur « la technique du Vieux-Colombier », il répondait : « c’est une pratique. » Copeau et lui-même œuvraient sur le tas, inventant sur leur tréteau nu un agencement adéquat, une ordonnance de la scène, redécouvrant la perspective de la scène à l’italienne, le rapport scène-salle, le sens de la matière, l’art de la machinerie… « Nous expérimentons une physique, basée sur la connaissance du lieu dramatique »[2]. Hanté par la forme de la salle (rectangulaire ? hémi-cycloïdale ? pivotante ?), Jouvet a découvert un ouvrage en allemand, tiré de quelque vingt-cinq volumes sur l’architecture théâtrale dont il n’aura de cesse de se préoccuper, rénovant ou construisant des salles, ou préfaçant l’ouvrage de Nicola Sabbattini[3].
Il se proposait de noter toutes les phrases que prononçait Copeau. De raconter comment les décors qu’ils faisaient ensemble avaient éclos. En 1951, il préfacera les notes de régie des Fourberies de Scapin[4] mises en scène par le Patron mais ne commentera guère plus tard ses propres décors, hormis celui, célèbre, concocté avec Christian Bérard pour L’Ecole des femmes. Dans la Correspondance avec Copeau déjà, on remarquait son besoin de prendre des notes, de consigner, d’élucider, de questionner sans fin le théâtre. On le voit, dans les textes réunis par Ève Mascarau, s’observer sans cesse, s’inquiéter. S’il s’interdit d’énoncer la moindre théorie ou conception, il tente obsessionnellement de s’expliquer à lui-même, d’expliquer « un état » sensible, un travail qui procède « par tâtonnements », par « procédés aveugles ». Serviteur de l’auteur, il se veut « en état de grâce devant l’œuvre ». Il cherche un contact physique avec cette œuvre qui a un corps, « comme un animal au repos ». Le choix opéré par Ève Mascarau, son classement chronologique permettent de voir surgir l’homme derrière l’artiste, un artiste épris de rigueur qui met l’état physique et la sensibilité au service de son art et ignore résolument ce qu’on appellerait aujourd’hui la dramaturgie. Seule compte la respiration du texte, la respiration de l’auteur qu’il faut épouser au plus près pour saisir sa pensée.
Si Jouvet monte souvent sur le plateau pour « montrer », il est à l’écoute des comédiens, en osmose avec leur tempérament, leur sensibilité. Il n’est là que comme un truchement pour transmettre « les idées d’un autre » (l’auteur). Lorsqu’il joue lui-même, il se reproche de quitter son rôle pour se mettre à l’écoute du comédien, du public. Étrange paradoxe d’un artisan qui prône la primauté de la sensibilité sur l’intellect mais qui, incessamment, raisonne et tente de clarifier en son esprit, d’expliciter, d’écrire sur ce phénomène qui lui reste à jamais inconnaissable. Il a beau manier des éléments concrets : machinerie, décors, objets, éclairage et sonorisation, l’amalgame lui échappe. Il minore son rôle : le metteur en scène est par nature profonde « un comédien, pas plus ». Il est « le costumier des sentiments et des idées », il met en scène « le lieu et ses ressources », l’essentiel de son travail est « la distribution ».
Si l’on ne peut déduire de ces textes, qui se veulent témoignage d’un artisan, aucun enseignement, aucune orientation, aucune consigne, si l’on n’y trouve aucun exemple éclairant de ses mises en scène, on peut en retenir une leçon morale, le souci d’une éthique bien dans la continuation de l’école de Copeau.
Françoise et Roland Labarre, Seize aperçus sur le théâtre espagnol du Siècle d’or, Genève, Droz, 2013.
| par Odette Aslan
Ce recueil regroupe des préfaces ou des articles de revues extrêmement documentés, publiés à diverses époques par Françoise et Roland Labarre, traducteurs et enseignants : ils avaient fait appel, au long de leurs de recherches, à de multiples sources livresques, le plus souvent espagnoles, mais aussi mené un grand nombre d’entretiens avec des traducteurs, metteurs en scène, décorateurs, acteurs ayant organisé ou participé à des représentations en français d’œuvres espagnoles du Siècle d’or, et ils avaient longuement analysé le discours de presse rendant compte de la réception en France de quelques œuvres de Cervantès, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón. Toute référence est soigneusement datée – sauf pour les entretiens -, et l’on prêtera attention aux notes, copieuses et souvent aussi essentielles à lire que les textes.
Pendant plusieurs siècles, de la méconnaissance à la curiosité, du contresens au plagiat, traducteurs et metteurs en scène ont assez peu et assez mal traité d’œuvres dont aujourd’hui encore, un grand nombre ne nous est pas familier. L’ouvrage retrace, pour la période contemporaine, les initiatives d’hommes de théâtre tels que Charles Dullin, Jean-Louis Barrault, Jean Vilar, ou d’animateurs de la décentralisation qui s’efforcèrent de faire connaître un répertoire étranger dont ils ne soupçonnaient pas à quel point il était précisément « étranger » car profondément lié à l’Histoire, à la littérature, aux mœurs de l’Espagne du Siècle d’or. Un contexte trop peu connu pour ne pas donner prise aux approximations, aux erreurs, aux malentendus voire aux trahisons.
Si Cervantès s’était rendu célèbre par son Don Quichotte, son théâtre fut dédaigné en Espagne et la reconnaissance en France de ses Intermèdes fut bien tardive. Françoise et Roland Labarre nous font savoir que Le Tableau des merveilles, titre de l’adaptation de Jacques Prévert mise en scène par J.-L. Barrault en 1936, est erroné et qu’il y a des contresens dans le texte. Numance (Barrault 1937) divisa la critique mais attira un public qui fit le rapprochement entre le siège de la Numance antique et l’attaque aérienne qui venait de ravager Guernica.
Une passionnante étude s’attache à élucider « l’énigme de Fuenteovejuna ». Dans quelle mesure Lope de Vega avait-il défié les autorités espagnoles de son temps en prenant pour sujet un épisode révolutionnaire ? Cernant les données historiques, analysant de près la composition de l’ouvrage, F. et R. Labarre détectent les précautions prises par l’auteur, écrivant une comedia selon les règles, ménageant une intrigue secondaire, mettant en avant la question de l’honneur. Par ailleurs, sont soulevés avec un soin particulier des problèmes épineux de datation concernant la date de naissance d’un auteur tel que Tirso de Molina ou de la composition d’une œuvre. Et trois tragicomédies sont évoquées, Lope de Vega, Rojas Zorilla et Cristobal de Rozas ayant diversement exploité la légende de Roméo et Juliette à partir de la nouvelle de l’Italien Matteo Bandello.
Aucune conclusion ne clôt ce recueil qui ne vise pas à la synthèse mais se contente de rappeler les résultats dispersés de recherches fécondes, et se termine par dix précieuses pages d’index récapitulant les noms et les titres des œuvres cités.
On aurait aimé que l’ouvrage s’intéresse davantage à la manière dont Corneille s’appropria Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro ou souligne l’influence durable qu’exerça sur le théâtre français La Célestine de Francisco de Rojas (ici curieusement absente). Une comparaison aurait pu s’esquisser avec le théâtre italien, mieux compris et apprécié en France où de nombreuses compagnies jouèrent et même s’installèrent. La comedia espagnole, plus historique, plus littéraire et souvent même en difficulté en Espagne pour s’exprimer librement, a toutefois donné lieu en France à d’excellentes représentations dont La Vie est un songe de Calderón (présentée notamment par Dullin en 1921) est peut-être l’emblème.
Ce n’est pas l’un des moindres mérites de l’ouvrage que d’ouvrir des perspectives et de proposer des pistes pour de nouvelles recherches.
Le théâtre espagnol du Siècle d’Or en France. De la traduction au transfert culturel, P. U. de Paris Ouest, coll. « Littérature et poétique comparée », 2012.
| par Odette Aslan
Dans la suite d’un Colloque international qui avait été tenu en 2009 à l’Université de Paris-Ouest, cet ouvrage propose des contributions de spécialistes et de jeunes chercheurs des Universités de Paris-Diderot, Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris-Sorbonne, Lille 3, Nantes, Toulouse 2, Costa Rica, Madrid, Turin, sous la direction de Christian Couderc.
Il s’inscrit en faux, dans l’Introduction et sur la 4e de couverture, contre « la célèbre phrase » de Louis Jouvet : « Le théâtre du Siècle d’or est un théâtre mort ». Les spécialistes ont repensé le rapport entre le théâtre espagnol et les auteurs français qui, du xviie au xixe siècle principalement, ont voulu le faire connaître ou s’en sont inspirés. Une quinzaine de contributions s’intéressent de près à des traductions, imitations, réécritures françaises de pièces de ce répertoire et à des échanges interculturels ; une seizième – due à deux universitaires madrilènes – aborde la mise en scène de La Dévotion à la Croix de Calderón par Albert Camus qui l’avait adaptée pour Marcel Herrand en 1953, et à celle de Georges Vitaly en 1961.
La publication est structurée en quatre parties : Circulation des modèles, de Molière au roman français du XVIIe siècle, Poétique et dramaturgie comparées, Les auteurs adaptateurs, de Lesage à Boisrobert, et Au-delà du XVIIe siècle.
Nous avons de la comedia espagnole une conception assez floue, voire erronée. Nous n’en soupçonnons pas toutes les qualités intrinsèques, linguistiques, dramaturgiques, les aspects diversifiés, nous ignorons son évolution. Elle a été souvent trahie en France par des traducteurs, imitée, pillée sans vergogne, mais surtout dépréciée : on vantait en effet la suprématie du théâtre classique régi par la règle des trois unités. Des études, des thèses se sont récemment développées sur ce sujet. Dans cet ouvrage, les participants ont relevé dans des adaptations de comedias diverses déviations, le déplacement des références géographiques ou historiques, ils se sont demandé si le Dom Juan de Molière s’inspirait plutôt du baroque, ou plutôt du Don Quichotte romanesque, ils ont cité des exemples du personnage de gracioso chez Corneille, examiné la manière dont les Comédiens Italiens se sont inspirés de la comedia en y intégrant des éléments de commedia dell’arte, inspirant à leur tour aux Français des adaptations d’intrigues espagnoles teintées de l’esprit de la commedia dell’arte.
Rotrou s’efforce de recomposer les pièces en fonction de la règle des trois unités imposée en France. Lesage, qui ambitionne de renouveler le théâtre français à l’aide de la comedia, restructure les œuvres et en adapte pour les Italiens. Scarron coupe ou inverse des tableaux. Boisrobert s’efforce de réécrire de plus près des pièces espagnoles nouvellement rééditées ; on le lit, on ne le joue pas. On joue en revanche les adaptations d’Hippolyte Lucas qui écrit en fonction des exigences scéniques – entre autres Le Médecin de son honneur de Calderón.
Albert Camus, qui a pratiqué le théâtre espagnol depuis les années trente, apprécie « un théâtre d’action ». « Quand j’adapte, dit-il, c’est le metteur en scène qui travaille ». Pourtant, c’est d’un point de vue linguistique que son adaptation de La Dévotion à la Croix est scrutée. L’article cerne en outre la pensée de Camus qui fait intervenir le libre arbitre et met en évidence l’injustice des hommes plutôt qu’un fatum divin. Des audaces de traduction, autant que des audaces dans sa mise en scène (qu’il assume au Festival d’Angers en remplacement de Marcel Herrand) – bien modestes au regard de celles du théâtre d’aujourd’hui – sont soulignées, autant que l’importance du plein air, de l’immense croix inclinée vers l’arrière, et l’interprétation de Maria Casarès. La mise en scène de Georges Vitaly au Festival des Nuits de Bourgogne, dans cette même adaptation de Camus, est également évoquée. Enfin, une dernière contribution fait des réserves sur la traduction, par Guy-Lévis-Mano, de Gil Vicente, auteur écrivant en portugais et en espagnol, et un peu antérieur au Siècle d’or.
Dans quelle mesure, du XXe au XXIe siècle, les traducteurs et adaptateurs rendent-ils justice à leur modèle espagnol ? Ce pourrait faire l’objet de futures recherches.
Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, vol. 16 : Théâtre – écrits sur le théâtre, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 2012.
| par Gilbert Py
Pour célébrer le tricentenaire de la mort de Rousseau, les éditions Slatkine et Champion ont confié à deux éminents spécialistes de Rousseau le soin de diriger la publication de la nouvelle édition des Œuvres complètes de cet auteur : Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger. Cette édition thématique en 24 volumes – plus de 15 000 pages – succède à l’édition de la Pléiade publiée entre 1959 et 1995. Cette nouvelle édition se veut de mettre à jour la recherche sur Rousseau, nécessaire après de nombreuses années. Mais nous posons la question de savoir, à propos du théâtre de Rousseau, si cette nouvelle édition remplace ou complète l’édition précédente.
L’intérêt de l’édition Slatkine-Champion réside dans le choix thématique qui réserve au seul volume 16 l’essentiel des écrits de Rousseau concernant le théâtre, que ce soient les pièces proprement dites ou les écrits théoriques, alors que la Pléiade place dans le volume 2, publié en 1964, à la fois Julie ou La nouvelle Héloïse, le théâtre, les pastorales, les poésies diverses, les contes et apologues, et les Mélanges de littérature et de morale… ; le chercheur est obligé de consulter le volume 5 publié en 1995, pour lire La Lettre à d’Alembert sur les spectacles et l’ essai De l’imitation théâtrale que nous trouvons, par contre, dans le même volume de l’édition 2012 du Tricentenaire.
L’édition de la Pléiade sur le théâtre de Rousseau, confiée à Jacques Scherer, propose une introduction générale suivie dans l’ordre chronologique des sept pièces de théâtre[5], accompagnées en fin de volume d’une introduction pour chaque pièce et de notes et de variantes nombreuses. Les deux ballets et l’intermède[6] qui suivent sont édités par Charly Guyot avec le même dispositif. Reconnaissons que cette présentation peu commode oblige le chercheur à des va-et-vient continuels auxquels échappe le lecteur de la nouvelle édition. Dans l’édition Slatkine-Champion, les pièces de théâtre sont aussi distinctes des « Ballets, Pastorales » et des écrits théoriques, mais se trouvent dans le même volume, ce qui est plus pratique. Leur édition, dont l’orthographe a été modernisée, utilise comme celle de la Pléiade, différents manuscrits de la bibliothèque de Genève et de celle de Neuchâtel, et les éditions des œuvres de Rousseau depuis 1776 (édition Boubers). Le lecteur appréciera les notes bibliographiques concernant les sources de chaque pièce à la fin de chacune d’elles. Les textes de Rousseau sont accompagnés de notes et de variantes en fin de page et non plus à la fin du volume, confiées à des spécialistes du Siècle des Lumières.
Ainsi, la partie « Théâtre » est prise en charge par Emmanuelle Plagnol-Diéval, professeur à l’Université Paris XII-Créteil, dix-huitièmiste appréciée notamment par ses travaux sur le théâtre de Madame de Genlis et sur le théâtre de société.
Mais si elle donne une petite introduction pour chaque pièce, on peut regretter l’absence d’introduction générale pour présenter les caractéristiques communes des pièces et les situer par rapport aux genres traités à l’époque, à la personnalité de Jean-Jacques Rousseau et à son système philosophique. Jacques Scherer, lui, donne de précieuses indications dans son introduction générale qui nous permettent de comprendre le théâtre de Rousseau. Il nous prévient que sur les 7 pièces, il n’en a publié qu’une : Narcisse ou l’amant de lui-même. Si Rousseau semble s’être désintéressé de la publication de deux autres de ses pièces, il a fréquenté assidûment les théâtres et montré une grande connaissance de la vie dramatique de son temps. Il a acquis une culture théâtrale et une technique dramatique qu’il met au service de ses idées. Jacques Scherer discerne dans ses pièces la personnalité de Rousseau au travers de la sensibilité des personnages ; il relève les détails qui peuvent illustrer les aspects de sa création littéraire. Il souligne l’aspect autobiographique de ce théâtre, « à commencer par la comédie de Narcisse où le héros s’éprend de son image, féminisée », ce qui n’apparaît pas dans la nouvelle édition.
Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval présente les pièces de théâtre dans le même ordre que celui proposé par la Pléiade. Elle en précise les dates de composition, à partir de travaux postérieurs à l’édition de Jacques Scherer. Raymond Trousson ajoute Les Saturnales, ébauche de pièce écrite en collaboration avec Mme de Graffigny et achevée avec l’aide d’Antoine Bret.
Entre Iphis et la Mort de Lucrèce, Rousseau écrit ses 8 pièces (Les Saturnales comprises) de 1732 (année de la première version de Narcisse, sous le titre l’Amant de lui-même, si l’on en croit les Confessions,) à 1754, soit avant le Discours sur l’Origine de l’inégalité parmi les hommes, sa rupture avec les philosophes, et l’écriture de ses grandes œuvres. Il s’agit donc d’une longue période de production théâtrale au cours de laquelle se cristallisent les thèmes de sa pensée. Jacques Scherer a pu voir dans la Mort de Lucrèce l’illustration de la corruption d’une société fondée sur « l’aliénation où devoir et vertu sont des mots vides de sens» (O.C., 2, p. 1028) et « où, ayant perdu tout idéal, la classe dirigeante se mue en tyrannie illégitime ». De son côté, Mme Plagnol-Diéval souligne que, dans ses dernières pièces, Rousseau met en scène des débats liés à la morale et à l’état : « L’axe moral et politique se recoupent : la royauté et la tyrannie vont de pair avec le vice, tandis que la vertu est l’apanage des républicains ». Ainsi le paratexte de chaque pièce de théâtre complète les informations et les commentaires de Jacques Scherer que Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval cite 35 fois !
On peut rendre hommage à l’énorme travail d’érudite et d’historienne de Mme Plagnol-Diéval, notamment en ce qui concerne l’actualisation des sources et de la bibliographie sur le théâtre de Rousseau depuis 1964. Cependant on peut se demander si ses commentaires ne font pas que compléter et préciser ceux de la Pléiade. Ainsi après Jacques Scherer, elle souligne l’amélioration de l’écriture théâtrale de Rousseau (O.C., 2, p. 1865 pour la Pléiade et O.C. 16, p. 223, pour l’édition Slatkine-Champion), depuis les maladresses d’Iphis, écrit à l’âge de 25 ans, jusqu’aux dernières pièces, comme en témoigne « la longue gestation » de Narcisse, conçu à Chambéry dès les années 1732-1740, mais publié seulement en 1753. Tous deux signalent la tradition opératique des chœurs, le goût de Rousseau pour le spectacle et la tragédie politique et ses relations avec les auteurs dramatiques contemporains, notamment Marivaux qui reprend certaines pièces de Rousseau comme Narcisse, ou avec les compositeurs d’opéras comme Quinault ou Lulli. Tous deux relèvent l’intérêt de Rousseau pour les évènements de son temps (par exemple la guerre de Succession d’Autriche dans les Prisonniers de guerre.) A ce sujet, Mme Plagnol-Diéval met l’accent sur le patriotisme de Rousseau pour la France et son roi Louis xv, comme dans les Prisonniers de guerre ou dans le Prologue de La Découverte du nouveau monde (p. 73), alors que le cosmopolitisme est de bon ton auprès des Encyclopédistes. Elle inscrit le théâtre de Rousseau dans la veine du théâtre national et patriotique du xviiie siècle, tout en le rattachant au théâtre de société conçu pour un théâtre privé.
Les œuvres lyriques qui suivent[7] sont détachées de la partie réservée au théâtre et classées dans la rubrique « Ballets, Pastorales, Poésies » pour l’édition de la Pléiade et « Ballets, Pastorales » pour la nouvelle édition. On peut se demander pourquoi les deux éditions n’ont pas placé ces scènes lyriques dans le volume consacré à la musique ou au théâtre.
Dans l’édition Slatkine-Champion, les quatre œuvres lyriques sont confiées à Alain Cernuschi qui les présente avec des notes critiques, sans introduction générale. Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne, connu pour ses travaux sur Narcisse et Pygmalion, dans les Annales J.J. Rousseau, il donne les textes à l’exception des Fêtes de Ramire confiées à Raymond Trousson. Compte tenu du lien intrinsèque entre les livrets et la musique, on peut regretter qu’il n’y ait pas d’introduction d’ensemble sur les œuvres lyriques de Rousseau. Cernuschi apporte des précisions sur « la composition d’opéras, parallèlement à ses lectures théoriques et à ses réflexions sur la notation musicale ». Il situe toutes ces œuvres, à la fois dans le contexte de l’époque (la Querelle des Bouffons), et dans la vocation première de musicien de l’auteur. Les indications concernant le Devin du village sont très précieuses pour comprendre la conception qu’a Rousseau de l’opéra, mais aussi de l’évolution de l’opéra en France et en Europe. On sait gré à Alain Cernuschi d’avoir reconstitué la genèse des œuvres et les conditions de leur composition, voire de leur représentation en confrontant le récit des Confessions et les documents contemporains de leur création, avec les indications scéniques quand, surtout, elles sont jouées, comme le Devin du village, devant le roi, au château de Fontainebleau en 1752.
Les textes théoriques de Rousseau sur le théâtre, publiés dans le vol. 5 de la Pléiade en 1995 sont séparés des pièces tandis qu’ils sont rassemblés dans le même volume de la nouvelle édition, ce qui est beaucoup plus commode et intéressant. Le mérite de l’édition du Tricentenaire est de confier la Lettre à d’Alembert à Patrick Coleman, professeur à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA). Celui-ci publie d’abord les deux passages de l’article Genève de l’Encyclopédie (1757). Il donne ensuite la Lettre à d’Alembert, précédée d’une introduction qui précise les conditions dans lesquelles Rousseau a écrit cette lettre, et la situe par rapport à ses écrits et à ses préoccupations de l’époque. Les circonstances et les étapes de la composition et de l’impression de la Lettre sont indiquées. Il relève aussi les réactions à la Lettre, tant à Paris qu’à Genève. Il souligne son influence sur l’évolution du théâtre et met en relief sa dimension politique, notamment la célébration d’une fête collective comme moyen de renforcer la liberté et l’égalité. Selon Patrick Coleman, Rousseau nous conduit à réfléchir sur le rôle médiatique du théâtre aujourd’hui. Il suggère que Rousseau se démarque de la tradition polémique anti-théâtrale concernant la métaphysique de l’imitation et le rôle de la poésie. Contrairement aux critiques morales des adversaires du théâtre au 17e, Rousseau connaît le théâtre et souhaite le renouvellement de la scène au profit d’un spectacle collectif, tendant à substituer aux mots comédie et théâtre le terme de « spectacle » qui sera repris dans le titre même de la Lettre sous l’appellation Lettre sur les spectacles. Patrick Coleman apporte alors les définitions du mot « spectacle » dans le Dictionnaire de l’Académie de 1694 et de 1752. Il montre en quoi Rousseau s’oppose à la conception de la mimesis selon les règles d’Aristote, et à la conduite d’une catharsis qui puisse expurger les passions du spectateur.
Ainsi le lecteur dispose de deux introductions très riches, celle de la Pléiade et celle de Slatkine-Champion pour comprendre la Lettre à d’’Alembert et sa signification, sans compter les nombreuses notes critiques et variantes de la Pléiade et les longues notes de bas de page de l’édition du Tricentenaire qui permettent de suivre au fil du texte le raisonnement de Rousseau. Celle-ci présente en outre la réponse de d’Alembert à Rousseau, p. 625-649 en signalant celle des nombreux contradicteurs.[8]
A la fin du vol. 16, Daniel Schulthess présente l’essai De l’imitation théâtrale, composé par R. dans le contexte rédactionnel de sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Il situe dans son introduction la position de R. par rapport à la dimension métaphysique de l’imitation théâtrale chère à Platon.
En conclusion, la dernière édition du théâtre de Rousseau, publiée avec les notes critiques, est certainement d’un grand intérêt pour les chercheurs d’aujourd’hui. Ceux-ci trouveront un accès plus commode aux textes de Rousseau, une modernisation de l’orthographe, des références actualisées. Mais cette édition du Tricentenaire de la naissance de Rousseau apparaît surtout comme un complément de l’édition de la Pléiade. On n’y trouve pas notamment un regard nouveau sur le théâtre de Rousseau. Il manque une introduction générale comme celle de Jacques Scherer, il y a un demi-siècle… L’édition de la Pléiade reste toujours irremplaçable.
P.S. En terminant cet article, nous apprenons le décès récent de Raymond Trousson. Je rends hommage aux exceptionnelles qualités intellectuelles et humaines de ce grand professeur.
Nicole Bernard-Duquenet, La Comédie-Française en tournée ou Le Théâtre des cinq continents, 1868-2011, préface de Muriel Mayette, L’Harmattan, 2012.
| par Agathe Sanjuan
Incontestablement, cet ouvrage vient combler une lacune. Sa perspective est à la fois d’identifier une chronologie grâce à la compilation des archives, et celle-ci se révèle fort utile, et de replacer les tournées dans une politique culturelle plus globale. Nicole Bernard-Duquenet commence par évoquer quelques cas notoires de tournées personnelles pour les distinguer des « excursions » au xixe siècle, puis des « représentations officielles » données par la suite par les comédiens, en tant que troupe et société, qui prennent la suite des « services mondains » demandés à la troupe par les souverains successifs.
Après ces considérations introductives, Nicole Bernard-Duquenet adopte un parcours chronologique tout à fait adapté au sujet. Sa première partie, intitulée « Excursions et premières tournées de la Comédie-Française, 1868-1913 », analyse les premières tentatives, décidées suite à la fermeture’ du théâtre pour travaux en 1868 ce qui permet une tournée en province, et en conséquence des évènements de la Commune en 1871. Privés de spectateurs et donc de subsides, les comédiens décident d’assurer la continuité de la société en envoyant une partie de la troupe jouer à Londres. En tenant compte de ces deux expériences, Nicole Bernard-Duquenet cherche à définir ce qu’est une tournée officielle et celle de Londres en 1879 en dresse les caractéristiques : objectif de prestige, déplacement de l’administrateur, accord à la fois de la société et du ministère pour assurer la poursuite de l’activité en période de travaux de la salle Richelieu. L’auteure analyse la stratégie des Comédiens-Français en matière de programmation et de conquête de nouveaux publics. Les tournées constituent désormais un revenu complémentaire du théâtre, et on commence à penser qu’elles pourraient avoir un rôle à jouer sur le plan national, en matière de démocratisation culturelle.
Dans une deuxième partie intitulée « Entre préoccupations artistiques et pressions politiques, 1914-1940 », Nicole Bernard-Duquenet analyse le rodage du système tout en identifiant les critiques émises à leur encontre. Le premier conflit mondial influence durablement les tournées de la Comédie-Française dans la mesure où dans la période d’instabilité qui suit, elles deviennent un enjeu politique de mieux en mieux identifié par l’Etat. Par ailleurs, l’expérience du Théâtre aux armées a accru leur importance symbolique sur le plan national.
L’Association Française d’Action Artistique voit le jour en 1936. L’auteure s’attachera dans la suite de son livre à décrire les changements d’orientation de cet organisme financeur. L’administrateur Émile Fabre dans les années vingt, reçoit les demandes émanant des ambassades luttant contre l’influence de la culture allemande ; le terme de propagande est ouvertement utilisé. Les tournées font désormais partie des missions du Français et l’État s’en sert à des fins diplomatiques. L’analyse de la presse étrangère par Nicole Bernard-Duquenet est particulièrement intéressante pour identifier un style de jeu à la française : qualité de la diction, musicalité, mais surtout cohérence du jeu collectif, particularité de la troupe.
Dans une troisième partie intitulée « Les Comédiens-Français, Ambassadeurs de la culture française, 1945-1969 », Nicole Bernard Duquenet détaille la période la plus brillante des échanges internationaux du théâtre, sous l’égide de l’AFAA. La troupe est désormais connue de par le monde, attendue, et jugée à l’aune de ses précédents voyages. La troupe subit désormais la concurrence d’autres compagnies françaises, également subventionnées par l’AFAA pour partir en tournée (Louis Jouvet, Renaud-Barrault…). La comparaison joue parfois en défaveur de la Comédie-Française : on lui reproche un certain archaïsme, tant sur le plan artistique que sur le choix du répertoire, jugé trop vieux. Malgré tout, la venue de la Comédie est toujours un événement prestigieux.
Nicole Bernard Duquenet s’attache à redéfinir la mission des tournées, dans le nouveau contexte politique mondial : perte d’influence du français dans le monde, décolonisation en marche, rivalités artistiques entre les nations, ayant pour conséquence la montée en puissance de l’AFAA allant de pair avec l’augmentation de sa subvention, création du ministère des Affaires culturelles en 1959. Dès 1954, le Français se rapproche de pays antagonistes dans le contexte de la guerre froide : l’URSS en 1954 et l’Amérique du Nord en 1955. La tournée en URSS, de première importance, est décrite en détails par l’auteur qui démontre qu’elle est vécue dans les deux pays comme une brèche de la culture au sein des tensions politiques et diplomatiques. Dans les années qui suivent, les données économiques pèsent de plus en plus lourds sur les choix de l’administrateur. À partir de 1956, on organise des tournées « mixtes », en province et à l’étranger.
Dans la quatrième partie intitulée « L’Illustre Théâtre face aux défis contemporains, 1970-2010 », Nicole Bernard-Duquenet analyse l’évolution des tournées dans une période où les difficultés économiques rendent les montages financiers de plus en plus difficiles. Les tournées à l’étranger sont délaissées au profit de celles en province. Le nombre de tournées diminue, mais surtout, les moyens de l’AFAA ne permettent plus de suivre le rythme précédent. L’Etat se désengage de la politique culturelle hégémonique devenue trop coûteuse. Le temps des grandes tournées s’achève. Les destinations étrangères sont ciblées à quelques villes contrairement aux périples dont les comédiens étaient jusque-là familiers. La succession des administrateurs et les fluctuations des moyens mis à la disposition de la Comédie-Française dans les années quatre-vingt rendent difficile la définition d’une stratégie à moyen terme. Nicole Bernard-Duquenet s’attache à expliciter un système budgétaire de plus en plus complexe visant à l’autofinancement des tournées. Jean-Pierre Miquel présente un projet pour sanctuariser un budget fixe de l’AFAA consacré aux tournées, mais ses propositions ne sont pas retenues. En revanche, les tournées reprennent à un rythme soutenu sous les mandats de Marcel Bozonnet et de Muriel Mayette dans la dernière décennie.
Pour finir, l’auteure dresse un constat assez sévère des dernières évolutions malgré des réussites brillantes : la Comédie-Française n’a pas une programmation qui se distingue particulièrement des autres troupes françaises, et a donc perdu son statut d’institution d’exception. Malgré tout, elle reste la seule à tourner quasiment en permanence. Les ressources générées par les tournées sont désormais essentielles, mais les mandats trop courts des administrateurs permettent difficilement d’établir une politique sur le long terme.
Toutes les informations contenues dans les archives sont ici rassemblées : nombre de représentations, recettes, pièces jouées, distributions, présentation des documents de communication, réception par le public, anecdotes, mondanités etc. Le travail de compilation réalisé par Nicole Bernard-Duquenet est colossal. On regrette néanmoins que les sources ne soient pas systématiquement citées. Il est vrai que ces documents sont rarement cotés. Le livre fournit à l’historien ou au curieux un guide très utile pour entreprendre des recherches plus poussées sur une tournée particulière ou des politiques culturelles croisées.
Soulignons la qualité exceptionnelle des annexes, permettant d’analyser le répertoire joué en tournées, à l’aide de tableaux synthétiques organisés par période ou par zone géographique.
Notes
[1] Cf. la récente publication de la Correspondance Jacques Copeau et Louis Jouvet 1911-1949, introduction et notes d’Olivier Rony, Paris, Gallimard, coll. Les cahiers de la NRF, 2013.
[2] Article paru dans La Revue rhénane en juillet 1921, reproduit ibidem, p. 557.
[3] Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, préface à l’édition en langue française de Louis Jouvet, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942.
[4] Molière, Les Fourberies de Scapin. Mise en scène et commentaire de Jacques Copeau. Préface de Louis Jouvet. Dessins de Jean Dulac, Paris, Éditions du Seuil, collection Mises en scène, 1951.
[5] Iphis, la découverte du nouveau monde, les Prisonniers de guerre, l’Engagement téméraire, Arlequin amoureux malgré lui, Narcisse ou l’amant de lui-même, la Mort de Lucrèce
[6] Les Muses galantes, les Festes de Ramire et le Devin du village
[7] Les Muses galantes, Les Fêtes de Ramire, Le Devin du village, Pygmalion
[8] R. Trousson, J.J. Rousseau jugé par ses contemporains, Paris, Champion, 2000, p. 131-167.
Pour citer cet article
Edith Séléna, Odette Aslan, Gilbert Py, Agathe Sanjuan, « Comptes rendus RHT#263 », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 263 [en ligne], mis à jour le 01/03/2014, URL : https://sht.asso.fr/comptes-rendus-rht263/