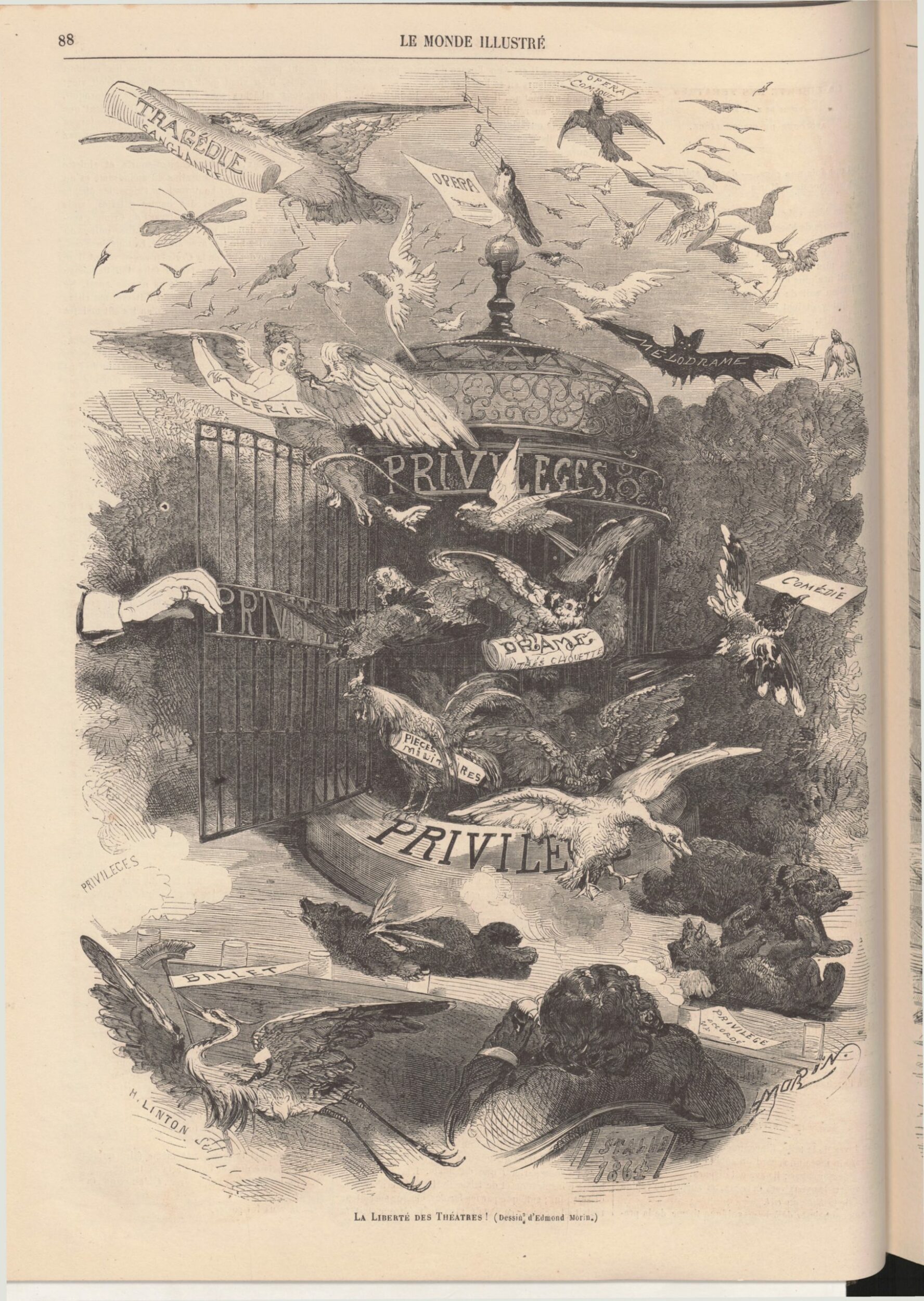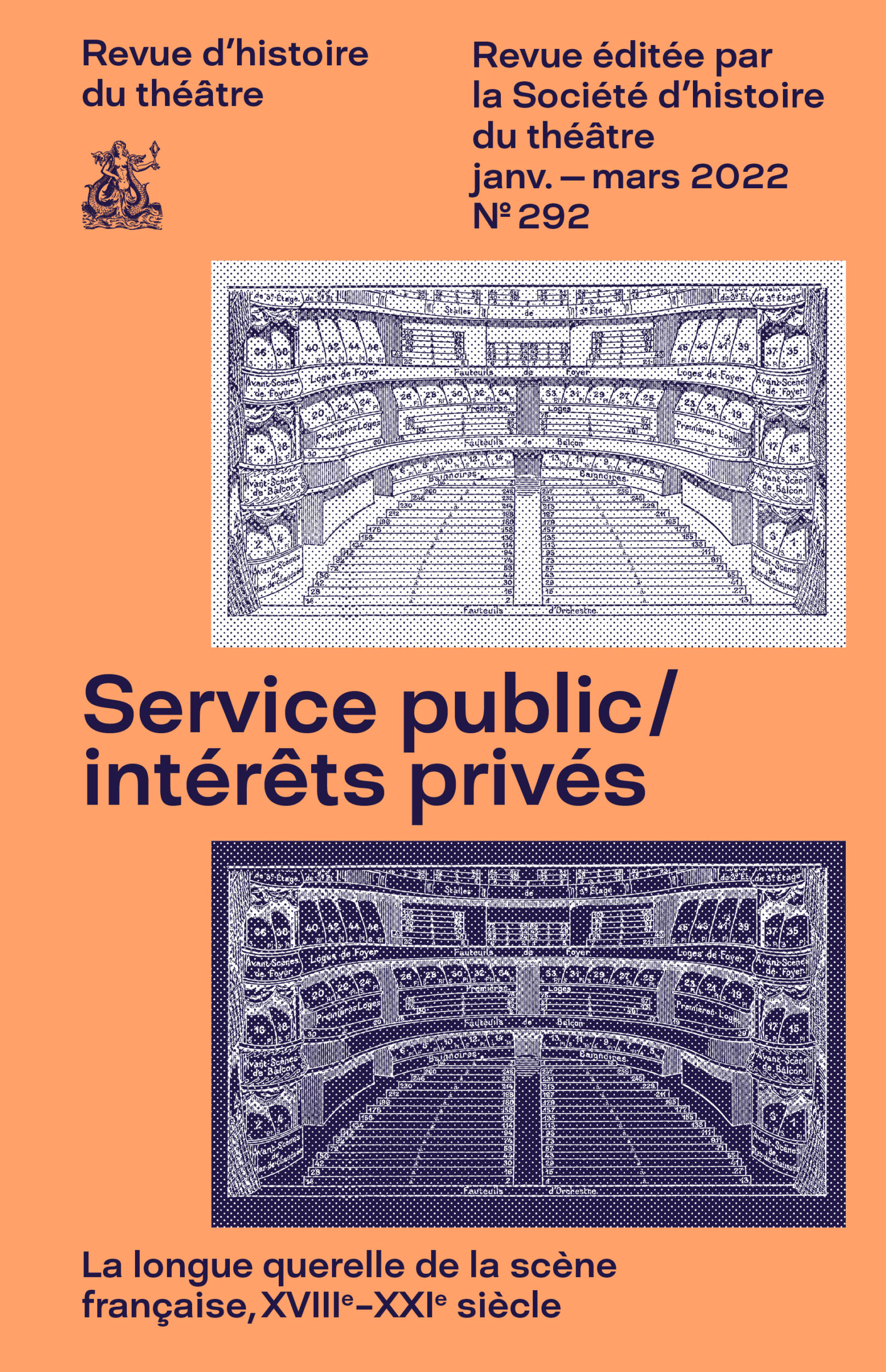Revue d’Histoire du Théâtre • N°292 T1 2022
Souvenirs d’une spectatrice de kabuki au XIXe siècle
Par Imaizumi Mine
Résumé
Traduit du japonais par Patrick De Vos
Texte
Dès que j’évoque mes souvenirs du théâtre de cette époque[1], j’ai l’impression de déployer devant mes yeux les images d’un joli rouleau peint. Aller au théâtre était alors un événement tellement attendu que la nuit précédente on ne pouvait fermer l’œil. À peine étions-nous au lit que l’on se retrouvait déjà debout à diriger nos pas vers la coiffeuse. On allumait alors la grande chandelle, dont on ne tardait pas, certes, à souffler la flamme vacillante, mais on venait la rallumer bien vite, pour l’éteindre à nouveau, et comme cela sept, voire dix fois dans la même nuit.
Quelle affaire ! Sur le coup de la septième heure[2], on allait réveiller toute la maisonnée pour s’atteler aux préparatifs. Là pour un kimono, ici pour une ceinture, tout le monde s’affairait, allant et venant en tous sens, tantôt debout, tantôt assis, ah ! quelle agitation c’était ! Et quand tous les gens avec qui l’on devait faire le trajet étaient enfin prêts, alors seulement l’heure était venue de monter à bord de la barque couverte à destination d’Asakusa[3]. Les jours où nous étions en nombre, c’était souvent une grande barque de plaisance. Sur l’embarcadère, à l’arrivée, les gens du chaya[4] que nous avions soigneusement choisi nous attendaient. Agitant leurs lanternes ornées du blason de la maison, ils nous accueillaient de la plus délicieuse façon : « Le voyage vous a-t-il été agréable ? Soyez les bienvenus », et ils nous tendaient la main pour nous aider à descendre à quai. Les théâtres se trouvaient dans le quartier de Saruwaka ; c’était là que du premier au troisième bloc s’alignaient « les trois grandes salles ». Comme c’était beau cette enfilade d’enseignes et de lanternes à la devanture des chaya qui bordaient la rue principale ! Enfin, que vous dire de notre plaisir à faire ce trajet, depuis Tsukiji[5] où l’on prenait la barque jusqu’à ces rues que l’on arpentait ? On ne tenait plus en place, tout bonnement. À l’intérieur des chaya, ce n’était à nouveau qu’hommes et femmes élégants qui, en été, portaient le kimono à même la peau avec tant de chic ; et tous ces gens respirant de fraîcheur et de netteté étaient alignés dans l’entrée pour nous recevoir le plus courtoisement du monde, avant de nous conduire vers un salon au rez-de-chaussée ou à l’étage. Là, on faisait une pause, baignant déjà complètement dans l’atmosphère du théâtre, quand le battement du ki[6] soudain retentissait. « Ça y est, ça commence ! » et nos cœurs de s’emballer. Instinctivement on se rajustait, puis, sans crier gare, c’était un grand brouhaha qui montait de toutes parts, comme si le bâtiment entier s’était mis à trembler, et l’on venait nous chercher : « C’est l’heure ! » nous disait-on. Ces instants avaient quelque chose d’infiniment exaltant. Il aurait été impossible de compter les grappes de spectateurs qui se pressaient là, et pourtant, il n’y avait pas la moindre confusion. Quel art ne fallait-il pas pour guider ces gens avec tant d’ordre et de calme…
Enfin installés à nos places, nous regardions autour de nous : encore des gens plus beaux les uns que les autres ! Chacun rivalisait d’élégance, s’était paré à l’envi des motifs les plus étudiés, à telle enseigne que la scène faisait quelquefois pâle figure comparée à une telle salle. Mais voici que le grand tambour se mettait à tonner, avant que les autres instruments n’entrent dans la danse. Et hop ! Nos regards étaient happés vers le haut, mais l’instant d’après c’était sur le côté, et devant tout ce qui se passait ensuite, notre étonnement ne connaissait plus de répit.
Jadis, à la différence d’aujourd’hui, le décor ne tenait pas seulement au fond de la scène, il venait jusqu’au milieu de la salle qui, au besoin, pouvait se transformer en forêt au cœur de la montagne, ou en profond vallon. Il arrivait ainsi que l’espace fut coupé en deux, qu’en son centre un pont rouge s’élevât au-dessus du sol, et qu’une scène de combat absolument acrobatique s’engageât au-dessus de nos têtes. À chaque tableau, c’était comme si nous aussi, spectateurs, nous nous trouvions dans la montagne ou au milieu de la lande. Tout cela pouvait paraître sans doute un peu naïf, mais ces machineries n’en étaient pas d’un effet moindre.
Quand l’entracte venait, les spectateurs refluaient vers les chaya, où de diverses manières l’on transformait sa mise. Cela aussi était un des grands plaisirs des dames de l’époque. On échangeait une tenue plutôt ordinaire contre l’élégant appareil d’une geisha, ou bien se donnait-on des airs de suivante de palais ; et, sans que nul ne s’en aperçoive, on reparaissait après ces « travestissements rapides[7] » sous l’aspect d’une tout autre personne. Autrefois on prenait ainsi ses aises, comme on ne le fait plus de nos jours. Dans les loges, on nous servait sushi ou gâteaux que nous mangions tous ensemble dans l’allégresse. Au reste, je me souviendrai toujours du délice qu’étaient ces fruits que nous prenions quand, les joues en feu, nous cherchions à étancher notre soif.
Notes
[1] Extrait de Nagori no yume (Des souvenirs comme en rêve) de Imaizumi Mine (1855—1937), publié pour la première fois en 1940. Dans cet ouvrage, l’autrice brosse un tableau de la fin de l’époque d’Edo et des années de Meiji, telles qu’elle les a vécues, en fille d’une famille de bushi, médecins au palais du shôgun.
[2] Quatre heures du matin.
[3] Faubourg populaire de ce qui était à l’époque la périphérie orientale de la ville. Situé en bordure du fleuve Sumida, il accueillit en 1842 les salles de théâtre que les autorités shogunales voulurent exclure du centre urbain. Y fut alors créé de toutes pièces un quartier des théâtres baptisé Saruwaka-chô. Avec Meiji, les grandes salles revinrent progressivement vers le centre, mais Asakusa resta longtemps un foyer culturel très actif où se côtoyaient toutes sortes de divertissements populaires.
[4] Littéralement, « maison de thé ».
[5] Quartier de Tokyo, établi à l’origine sur des terres de remblai à l’embouchure du fleuve Sumida. L’on remontait celui-ci sur six kilomètres environ pour atteindre Asakusa.
[6] Sorte de claquoir, fait de blocs de bois dur, qui émet un son sec et aigu caractéristique pour annoncer et ponctuer l’ouverture ou la fermeture du rideau.
[7] Allusion aux hayagawari des acteurs. Ces « travestissements rapides » permettaient de dévoiler une identité inconnue d’un personnage, ou un changement de son état émotif.
Pour citer cet article
Imaizumi Mine, « Souvenirs d’une spectatrice de kabuki au XIXe siècle », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 292 [en ligne], mis à jour le 01/01/2022, URL : https://sht.asso.fr/souvenirs-dune-spectatrice-de-kabuki-au-xixe-siecle/