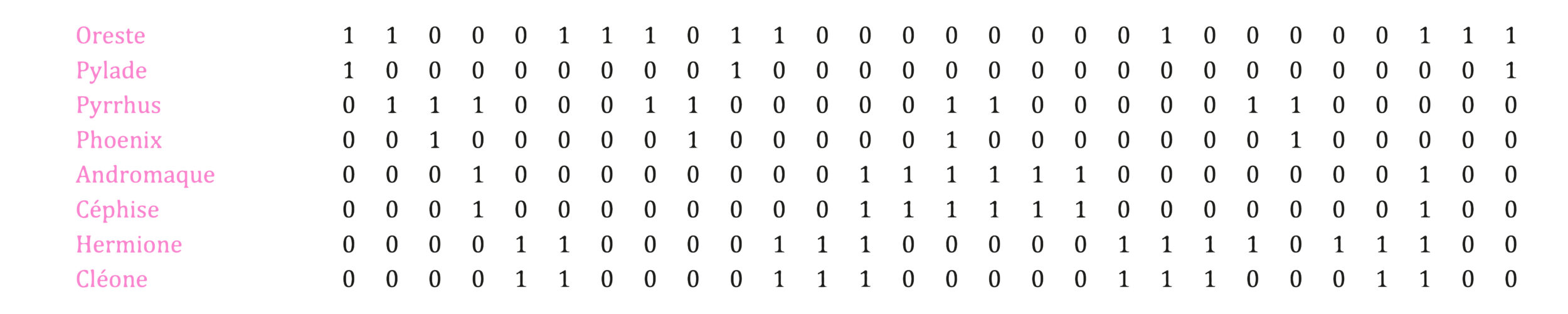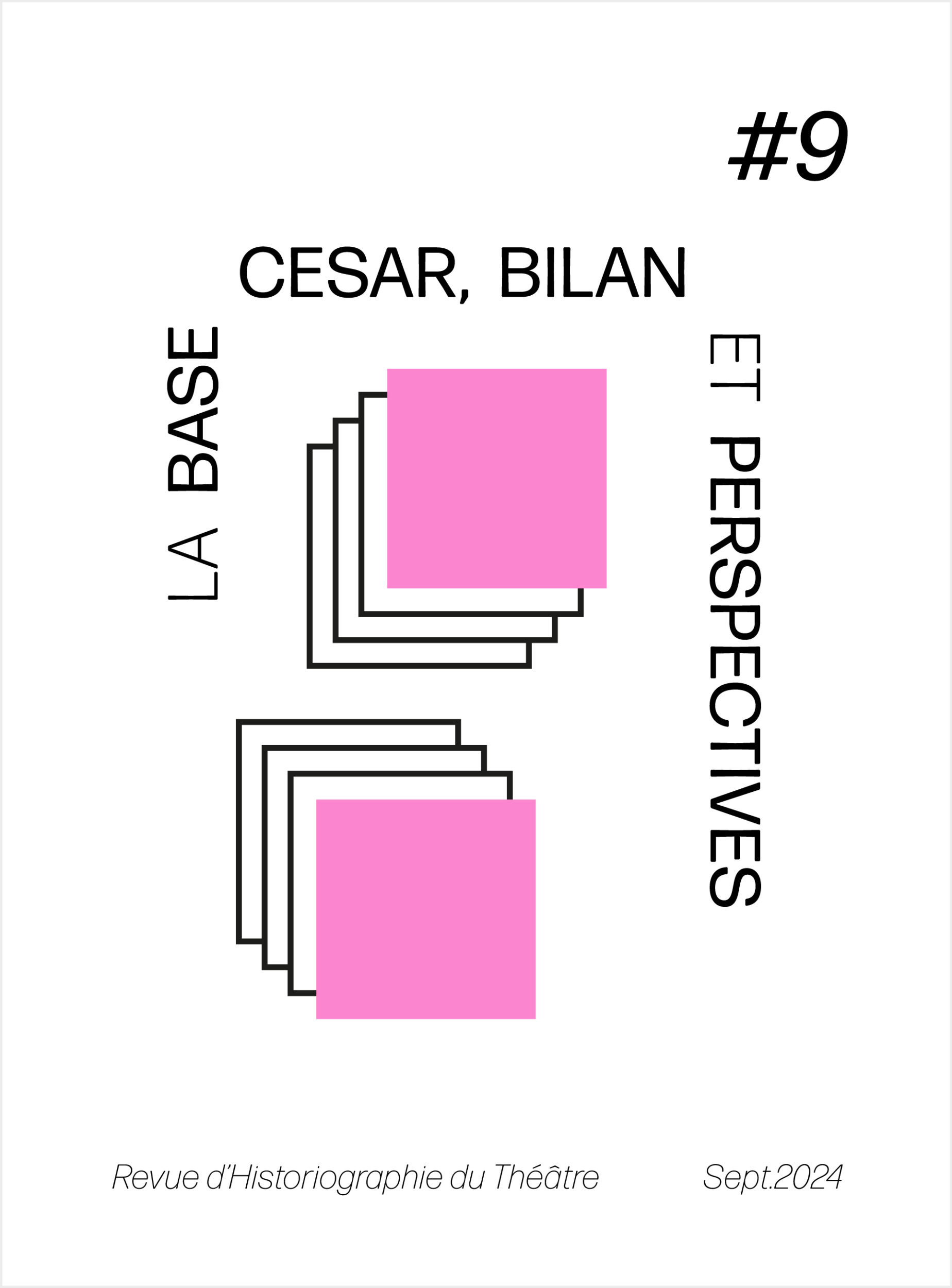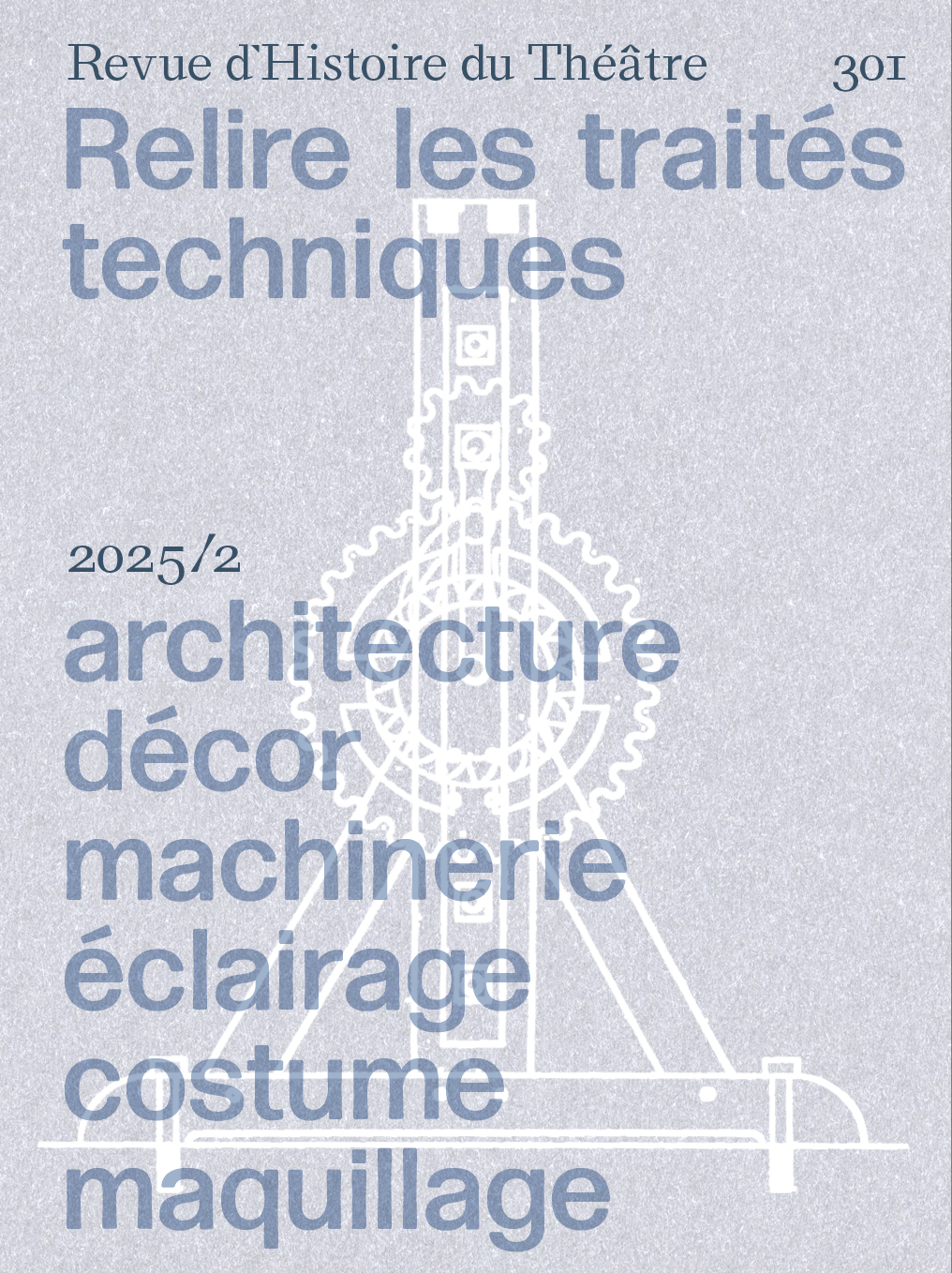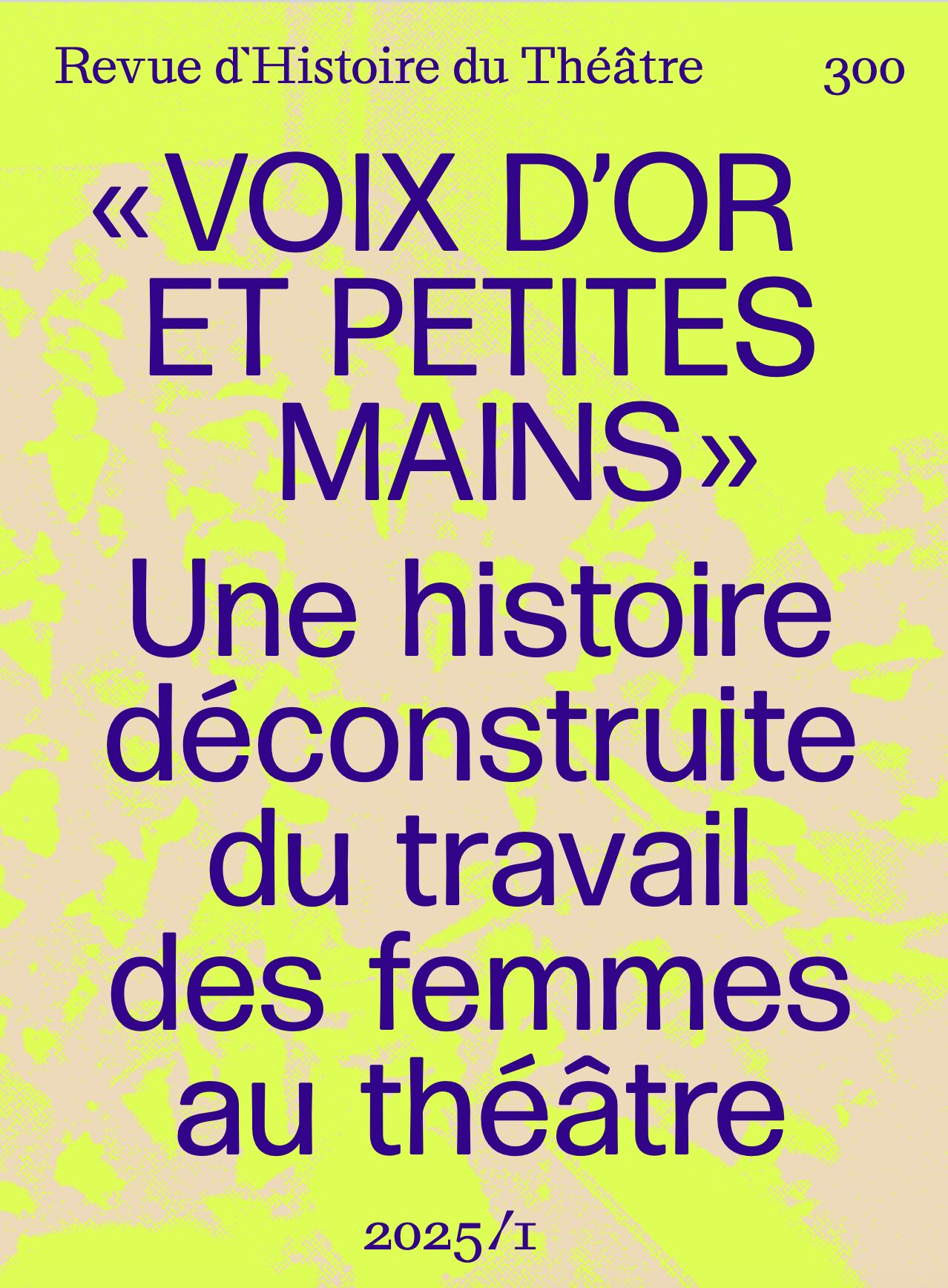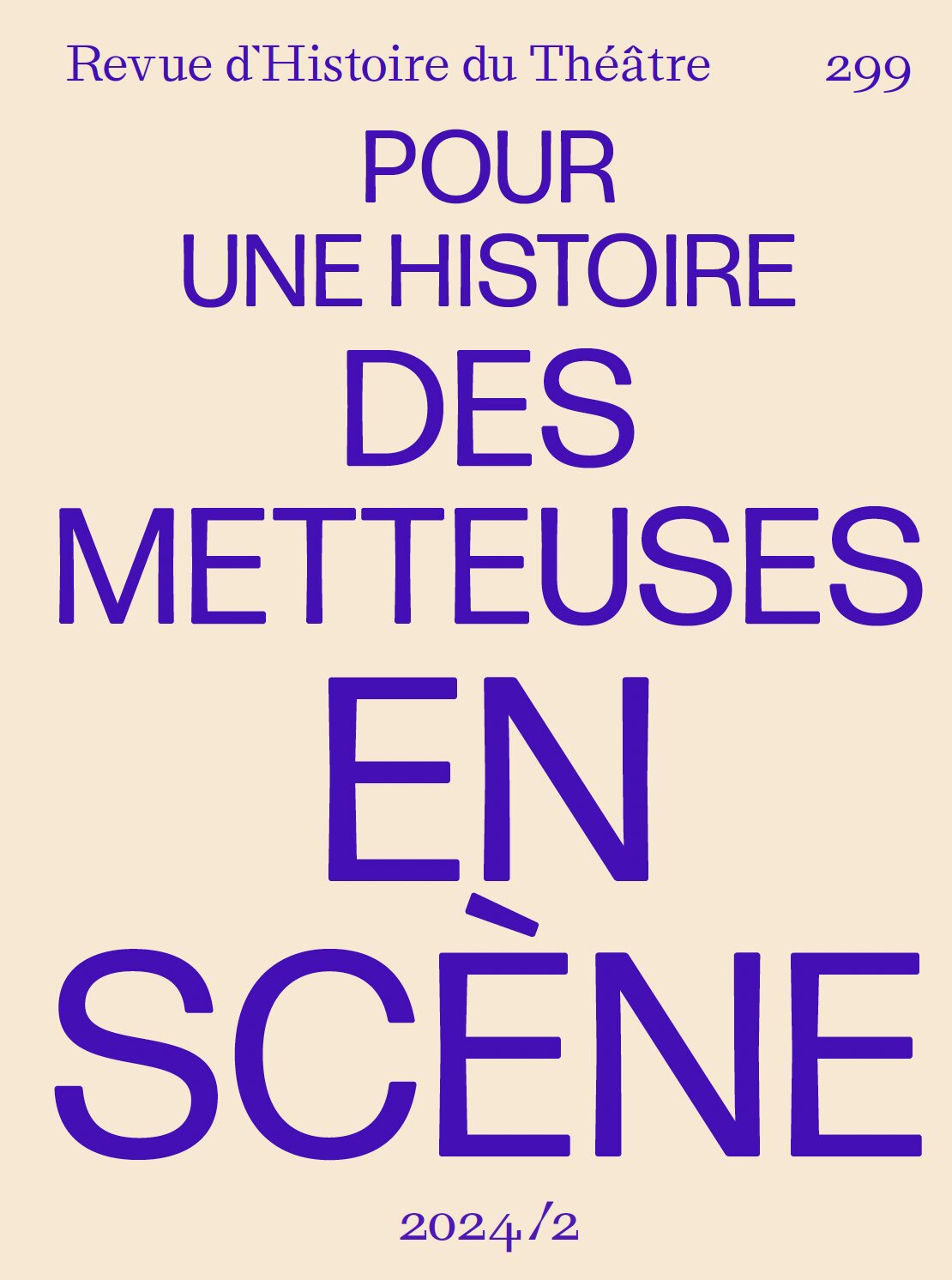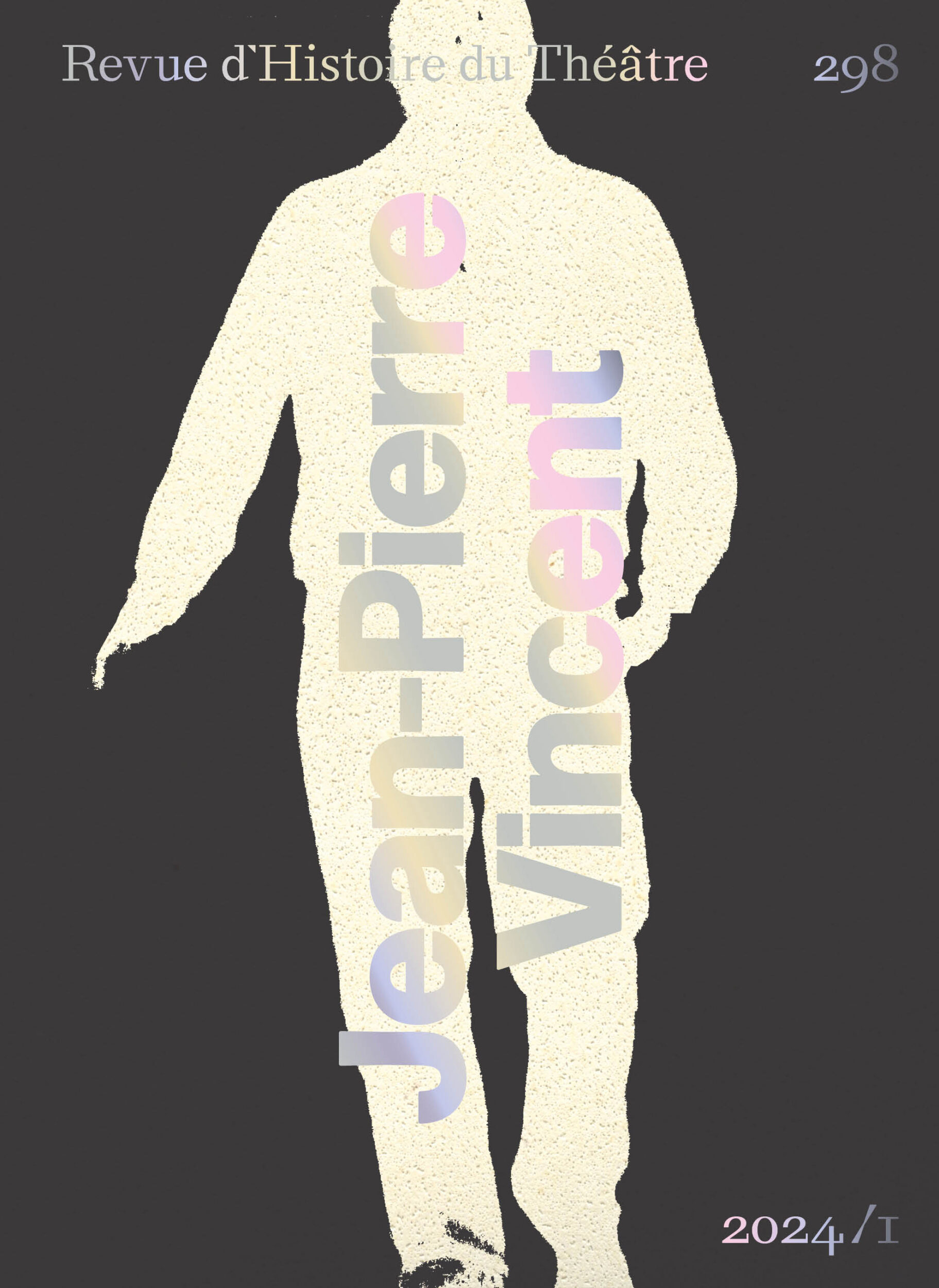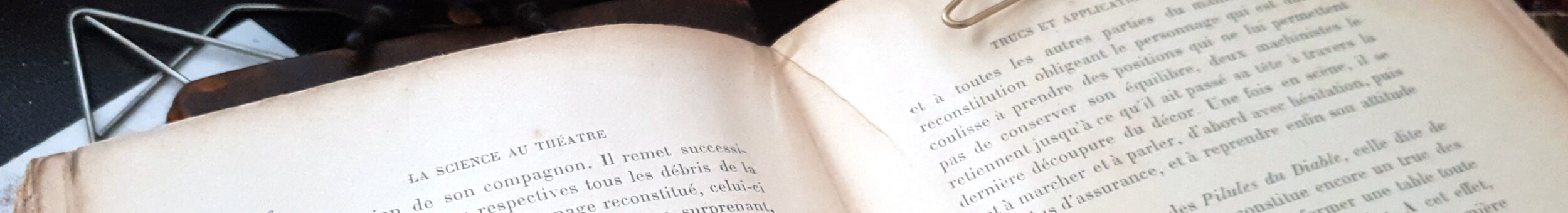Revue d’Historiographie du Théâtre • N°9 T4 2024
Introduction
Par Marc Douguet
Résumé
Fondée en 2001, la base CESAR a été un projet pionnier dans l’utilisation des technologies numériques pour l’étude de l’histoire du théâtre. À l’occasion de son vingtième anniversaire et à l’aube d’un projet de refonte majeur, le colloque La base CESAR : bilans et perspectives a réuni certains de ses contributeurs et de ses utilisateurs ainsi que les responsables de projets voisins par la méthodologie et/ou le domaine étudié. Ce numéro #9 de la Revue d’Historiographie du Théâtre dresse un état des lieux des possibilités d’enrichissement et d’amélioration sur le plan des données, de leur structuration et de leur interface de consultation, et, plus largement, s’intéresse aux enjeux de l’archivage numérique des données relatives à l’histoire des spectacles des siècles anciens (recensement des sources disponibles, évaluation de leur fiabilité, choix d’un modèle et d’un format de publication, etc.).
Texte

Le site CESAR (Calendrier électronique des spectacles sous l’Ancien Régime et la Révolution) est une base de données en ligne sur le théâtre et la vie théâtrale en France du début du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Grâce à un accord entre Oxford Brookes University et l’Université Grenoble Alpes, CESAR est accueilli depuis 2016 par le laboratoire Litt&Arts, qui entend le redynamiser. Le colloque La base CESAR : bilans et perspectives, organisé par Marc Douguet et Jean-Yves Vialleton à l’occasion du vingtième anniversaire de la base en octobre 2021, avait un objectif très concret. Il visait à alimenter une réflexion sur le développement à donner au site dans les années qui viennent : mises à jour nécessaires, meilleure adaptation à l’usage des utilisateurs, extension de la période chronologique et du domaine de données, mise en place de nouvelles fonctionnalités.
Une partie du colloque a ainsi été consacrée à des échanges d’expériences et à la présentation de projets dont les enjeux entrent en résonance avec ceux de CESAR. Les différentes méthodes de collecte, de stockage, de publication et d’analyse mises en œuvre permettent de réfléchir aux questions propres à l’archivage des données de l’histoire des spectacles anciens, qui doit mettre en relation des objets hétérogènes : d’un côté les sources (manuscrites ou imprimées), objets matériels mais souvent lacunaires ; de l’autre les représentations, objets éphémères dont ne subsistent que des témoignages. L’AGPRD (Archive of Performances of Greek and Roman Drama), dirigé par Fiona Macintosh à l’Université d’Oxford, est un projet pionnier dans ce domaine, consacré aux représentations du théâtre antique. Avec LeReMed (Les Représentations médiévales), Simon Gabay propose un répertoire des performances médiévales appuyé sur une approche philologique de leurs sources. Natalia Wawrzniak travaille, dans le cadre du projet Médialittérature (dirigé par Estelle Doudet à l’Université de Lausanne), à la constitution d’une base de données consacrée aux premiers théâtres romands (XVe et XVIe siècles). Enfin, Nathalie Berton-Blivet et Anne Piéjus ont présenté les aboutissements du programme Mercure galant (IREMUS/CNRS), qui se concentre sur cette source essentielle pour l’étude de la vie musicale, théâtrale et littéraire à la charnière des XVIIe siècle et XVIIIe siècles que constitue le périodique fondé par Donneau de Visé. Différents aspects de la base CESAR elle-même ont également fait l’objet d’interventions variées : Anastasia Sakhnovskaia a retracé la longue et riche histoire du projet ; Marc Douguet et Théo Roulet ont esquissé son projet de refonte dans le cadre du projet Dramabase, qui vise à convertir la base aux standards du web des données. Enfin, Anne Garcia-Fernandez et Élisabeth Greslou ont proposé une réflexion plus générale sur la gestion des données numériques en sciences humaines et les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine en s’appuyant sur quelques exemples de projets menés au sein de l’UMR Litt&Arts de l’Université Grenoble Alpes.
D’autres contributions ont porté sur des problématiques plus larges et ont permis de faire un état des lieux des questions que posent à la fois le recours aux méthodes des humanités numériques et la collecte de données pour certains aspects particuliers de l’histoire du théâtre. Les apports et les lacunes de CESAR dans ces domaines ont ainsi pu être mis en valeur, en adoptant le point de vue de ses utilisateurs. Malika Bastin-Hammou dresse un panorama des outils disponibles pour l’analyse transséculaire des mises en scène et, plus généralement, de la réception du théâtre grec antique, en mettant en lumière les problèmes que posent parfois l’incomplétude et l’absence de pérennité des ressources ; Marie Demeillez et Mathieu Ferrand recensent les différents types de sources qui nous renseignent sur le théâtre scolaire du XIVe au XVIIIe siècles, et analysent leur évolution, liée à l’institutionnalisation progressive du théâtre ; Bénédicte Louvat montre les problèmes spécifiques que pose l’étude de la vie théâtrale en province au XVIIe siècle, extrêmement dynamique tant en termes de créations, de représentations que d’éditions, mais encore fort peu étudiée et mal représentée dans les ressources en ligne.
Dans un récent dossier de la Revue d’Historiographie Théâtrale intitulé Écrire l’histoire des spectacles avec des bases de données, Marine Roussillon et Christophe Schuwey soulignaient la « nécessité d’une mise en cohérence des réalisations et des pratiques » aussi bien dans le rôle dévolu aux interfaces que dans la pérennisation des projets numériques. Les contributions réunies ici, qu’elles partent d’un projet particulier ou d’un questionnement scientifique, invitent aux mêmes constats. Le chercheur en histoire du théâtre des siècles anciens fait face, par la nature de son objet d’étude, à un certain nombre de difficultés : les sources sont souvent rares, parfois peu fiables, toujours disséminées dans des fonds multiples. Les humanités numériques posent à leur tour de nouveaux défis, notamment la pérennité, l’accessibilité, l’enrichissement et la mise en relation des données. Ces deux niveaux de difficultés ne doivent pas être confondus, au risque de s’additionner ; mais ils doivent chacun être abordés avec une lucidité spécifique aussi bien sur le plan scientifique, technique que politique.
Le présent numéro ne saurait rendre compte de toute la richesse des échanges, mais il paraissait néanmoins nécessaire de garder une trace de ces différentes propositions. Il ne constitue pas non plus des actes de colloque à proprement parler : la diversité des formats de publication – vidéos, podcasts, articles, diaporamas – reflète la diversité des approches mises en œuvre : études de cas, dépouillements de fonds d’archives, présentations de projets à venir, en cours ou aboutis, etc.
Numéro publié avec le soutien de l’Université Grenoble Alpes et de l’UMR 5316 Litt&Arts.
Pour citer cet article
Marc Douguet, « Introduction », Revue d’Historiographie du Théâtre numéro 9 [en ligne], mis à jour le 01/04/2024, URL : https://sht.asso.fr/introduction-8/