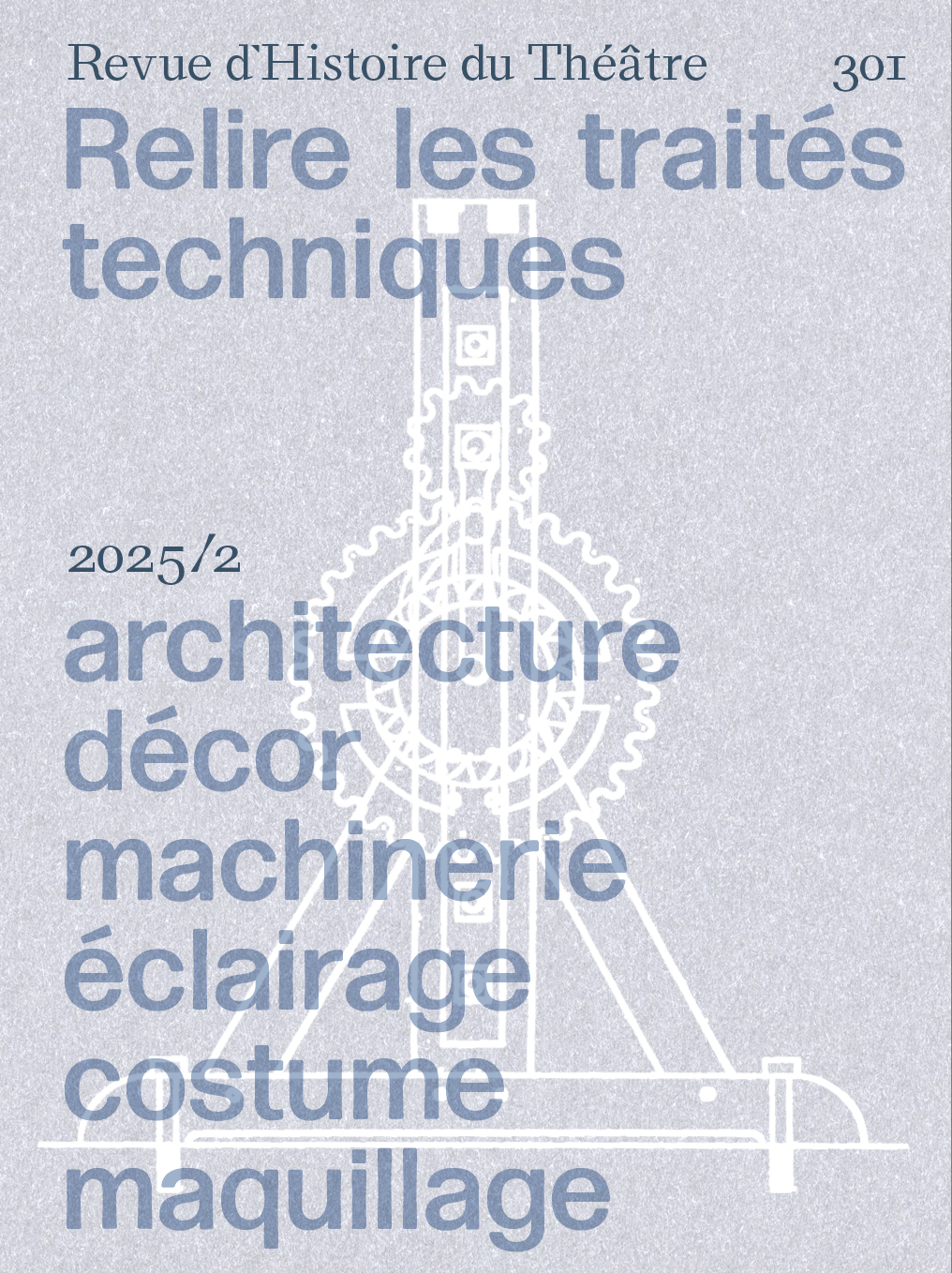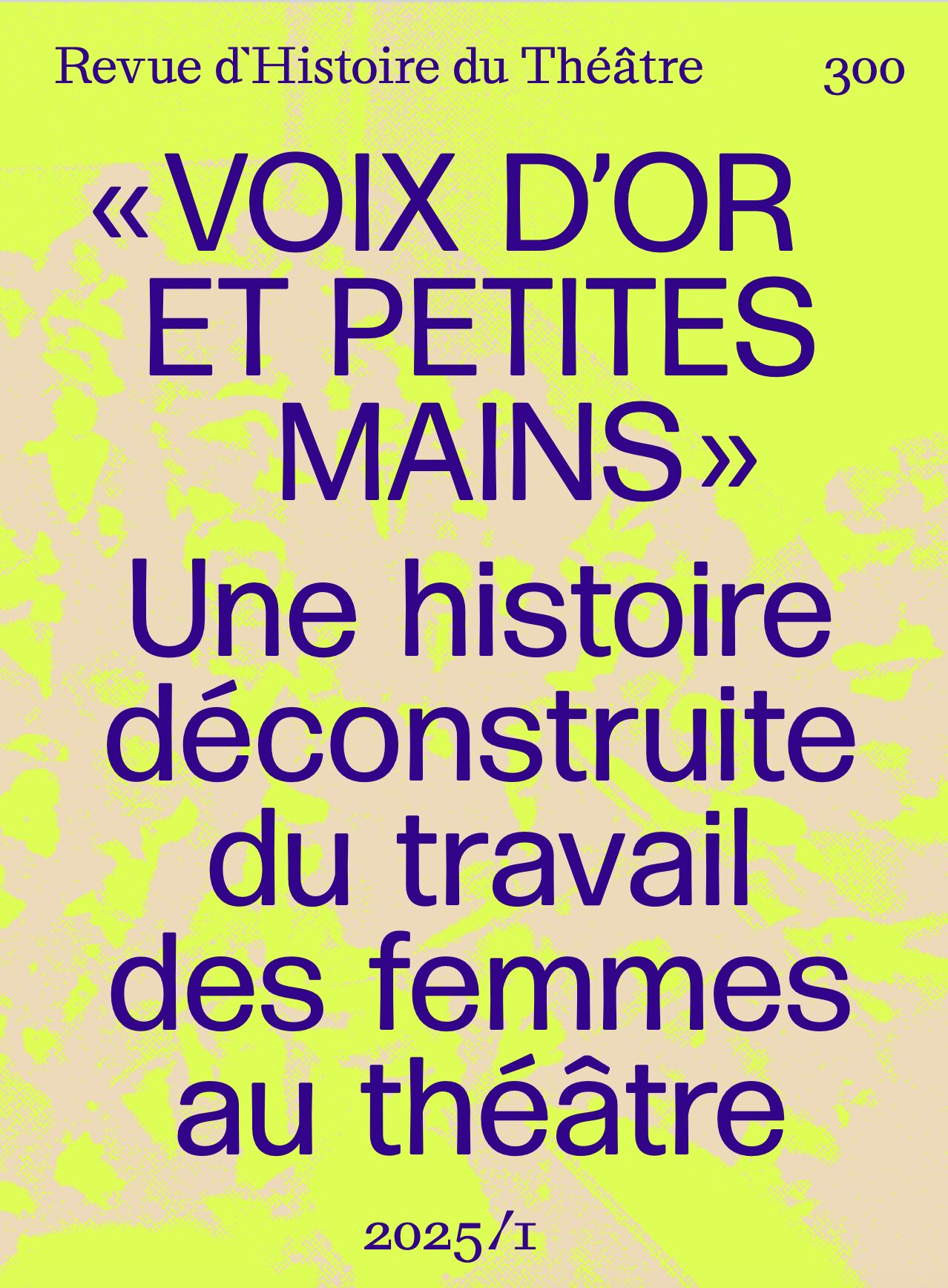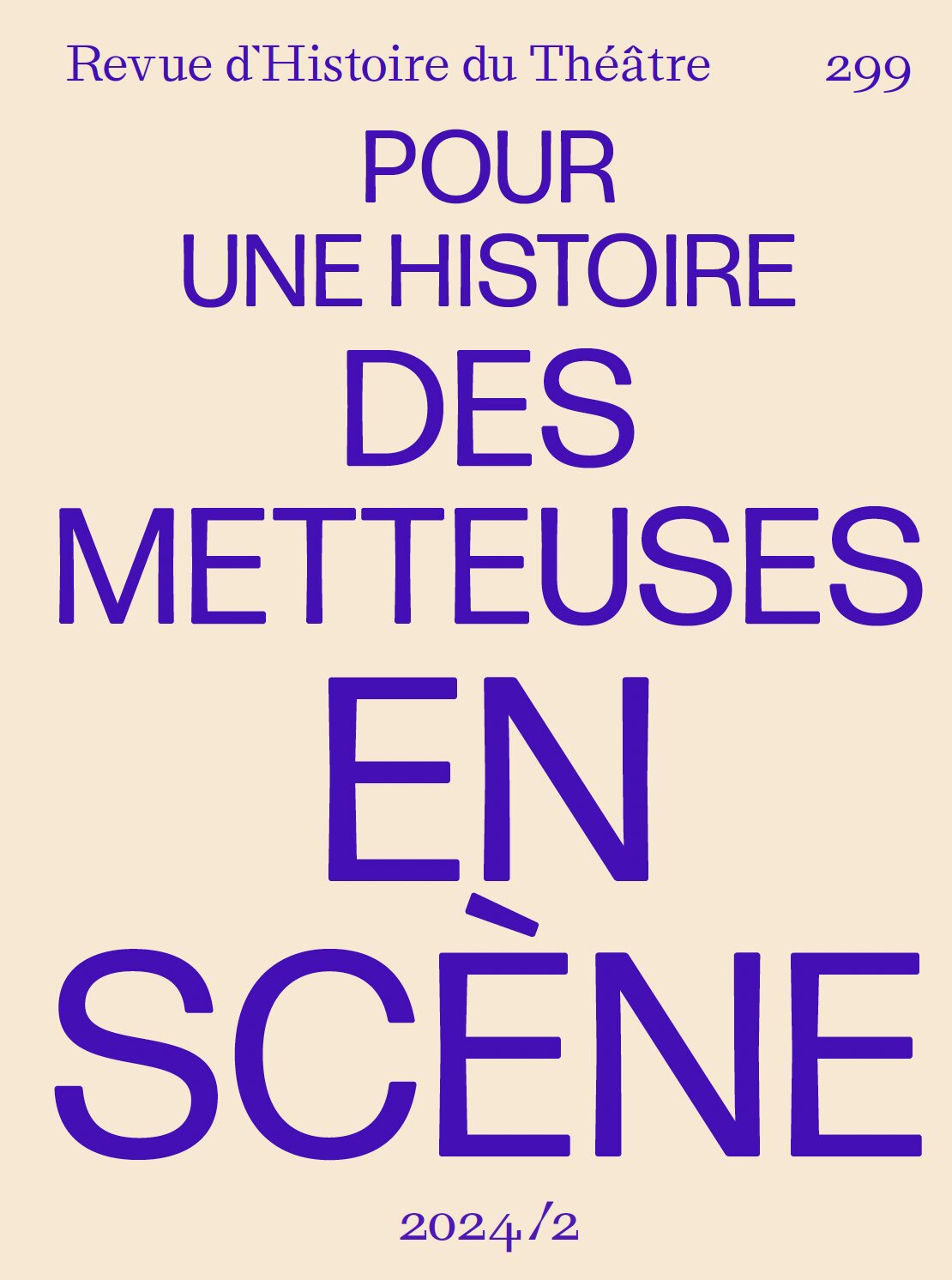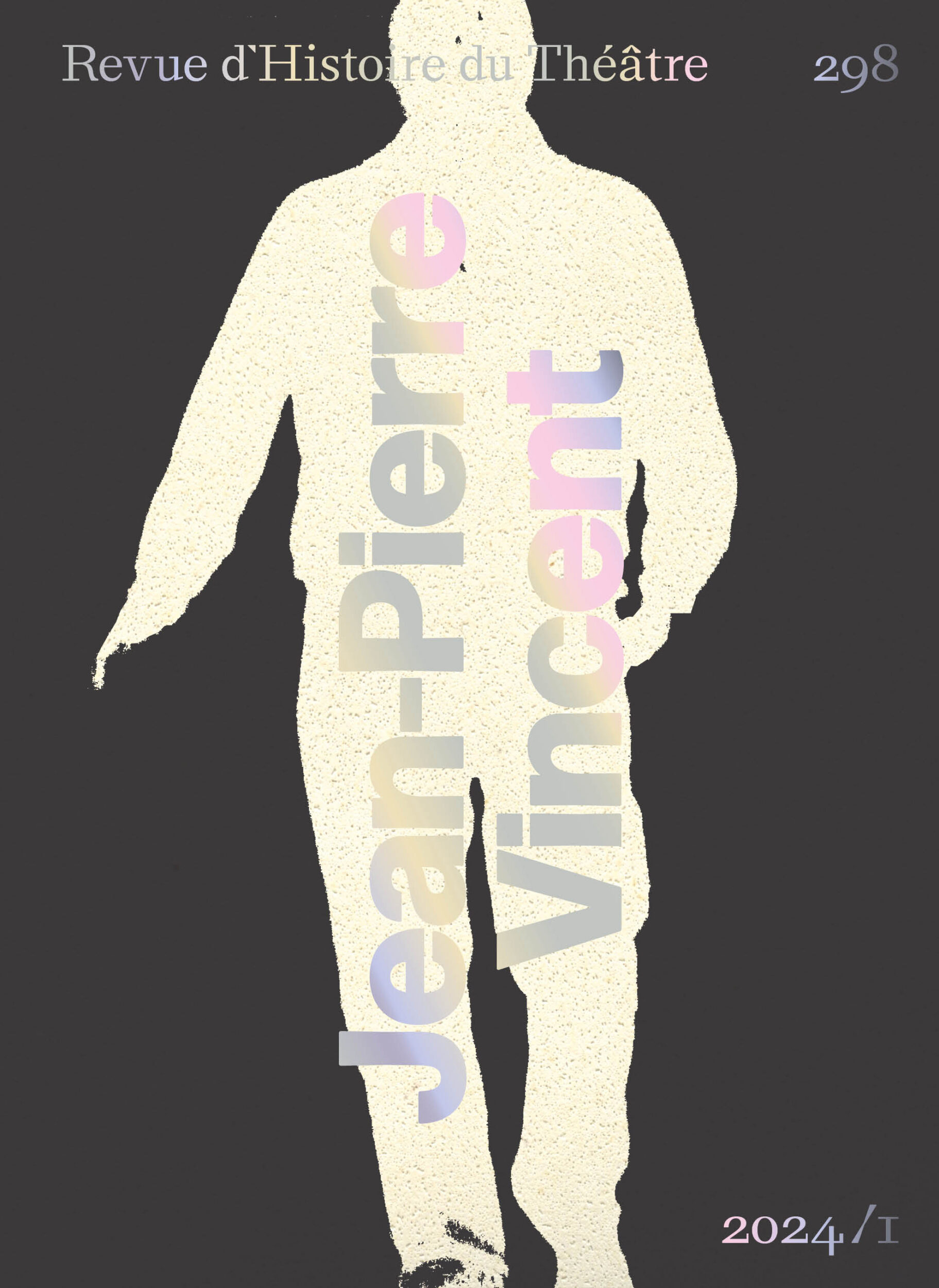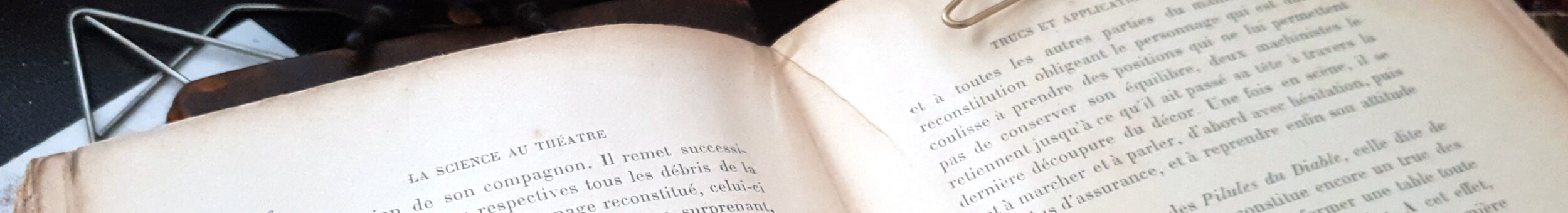Lectures & varia • N°2 S2 2025
Le programme de théâtre à la Belle Époque – la naissance d’un média
Par Julien Dubois
Résumé
Histoire matérielle, sociale et culturelle du programme de théâtre, essentiellement à Paris, à la Belle Époque. Une plongée dans cette archive aussi visuelle que ludique, afin de revisiter l’histoire du théâtre à l’aune de ses ephemera.
Texte
Aux confluents de l’édition et de la presse, du visuel et du texte, du théâtre sur papier et du théâtre sur planches, se trouve le programme de théâtre.
Son existence est le fruit de conjugaisons plurielles, à une époque où l’art et les secteurs de l’industrie et de la communication s’amplifient, se codifient, se ramifient. Le programme, tel qu’on le conçoit de nos jours, n’a pas toujours été ce dépliant illustré en papier glacé. Il l’est devenu à l’orée de la Grande Guerre.
Définition
Aux côtés des billets d’entrée, des invitations et des quittances de loge, figurent les programmes. Ils font partie des documents appelés « ephemera » ou petite estampe – des documents papiers qui n’ont cessés de se transformer durant tout le XIXe siècle, grâce aux avancées techniques d’impression et de reproduction de l’image.
Le programme comprend tous les documents de promotion de spectacles : la brochure, le livret et l’affiche. Les Anglais utilisent le mot a playbill pour désigner ce même ensemble de documents, que l’on peut traduire par « un billet à propos d’une pièce ». À ses débuts, le programme ne contient guère plus d’informations qu’une affiche. Puis il gagne en qualité – matérielle et de contenu – et se détache petit à petit de l’affiche. Il en garde toutefois le visuel sur sa première de couverture. Sa modernisation et son évolution sont liées à la prolifération de l’image sur l’imprimé. Au même titre que l’affiche, il bénéficie de la lithographie – couleur sous le Second Empire – puis de la reproduction photographique. Dès 1887, une petite révolution graphique frappe le milieu de l’art théâtral : André Antoine choisit, pour annoncer le programme du Théâtre-Libre, de collaborer avec de jeunes dessinateurs. Une nouvelle génération, post-impressionniste, range alors ses chevalets et se passionne pour le support lithographique – une démarche qui marque la Belle Époque des affiches, et, par extension, celle des programmes de théâtre. Les colonnes Morris sont alors composées d’un ensemble de programmes, comme des affiches miniatures.

Fonction
La première fonction du programme de spectacle est d’annoncer, puis d’informer sur le contenu de ce dernier. Les synopsis ou comptes rendus sont courant, mais pas indispensable pour autant. Il peut parfois s’agir d’un mot de l’auteur au public. Les principaux ingrédients à la composition d’un programme sont le titre de la pièce, l’auteur ou l’autrice, la distribution, le lieu, la date et l’heure. Ironiquement, ces dernières ne sont pas systématiquement indiquées. Un grand nombre de programmes est ainsi difficile à dater, témoignant par la même de ce caractère éphémère.
Alors qu’il gagne en qualité au cours du siècle, le prix du programme apparait sur la couverture – les programmes sont longtemps payants, ce qui demeure encore aujourd’hui le cas dans certains théâtres. À la fin du XIXe siècle, il oscille entre 10 et 50 centimes de francs, approchant presque le prix du siège qu’il nous propose de rejoindre. Son contenu s’étoffe également. Des informations pratiques complètent l’adresse du lieu comme les tarifs de la billetterie, le plan de la salle avec le numéro des places, le prix des consommations, et parfois même des indications sur le code vestimentaire. Parfois, on prévient même que « la salle est aérée » ou bien que « deux poêles la chaufferont aussi bien que possible » – la qualité de l’air et la lutte contre l’incendie sont deux obsessions de cette époque.
Avec l’essor de la presse, le programme se fait aussi espace de communication entre annonceurs et clients potentiels. Ces derniers sont informés des cafés-restaurants proches du théâtre – afin de prolonger la soirée – ainsi que des produits de la modernité qu’on leur somme d’acquérir. L’augmentation croissante du nombre de ses pages permet qu’on y insère des articles à visée pédagogique ou divertissante, ainsi que des jeux concours, favorisant l’émergence d’un lectorat et le rapprochant de plus en plus du format magazine. La fin du XIXe siècle marque donc la transition entre simple feuillet – manuscrit ou imprimé – et livret composé, enrichi d’illustrations en couleur et de photographies.

Interpeler, amuser, attendrir… le programme, un document vivant
Le programme de théâtre témoigne d’un extraordinaire bouillonnement créatif. Les éditeurs redoublent d’imagination afin de séduire spectatrices & spectateurs. On déploie tout un cortège de formes et de couleurs. Trois formats reviennent le plus souvent : le tract ou prospectus – simple feuillet – puis le dépliant – deux ou trois volets – et enfin le livret. De nombreux exemples d’hybridité naissent durant cette période, à l’image du moulin-programme du Moulin Rouge, ou encore du rideau-programme du Trianon :

Pourtant, le format du programme s’homogénéise dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Les caractéristiques de cette uniformisation sont : l’utilisation du papier glacé, l’augmentation du nombre de pages et les dimensions. Il passe ainsi du format in-8° à in-4°, voire se calque sur les nouveaux grands formats de magazine, tel celui du Comœdia illustré dans le cas du Moulin Rouge. Ce formatage s’effectue sur plusieurs décennies. Les éditeurs, soucieux de trouver la recette la plus originale et rentable, ont bien souvent mélangé les matières dans le but d’offrir un caractère prestigieux au papier. Le théâtre de la cour d’Angleterre a ainsi recours à la soie et au satin pour confectionner ses programmes de productions royales officielles. Ils étaient parfois même saupoudrés d’or. À Paris, l’Eden-Théâtre et l’éditeur Maison Rapide produiront quelques « bijoux-programmes » de 1886 à 1890, entièrement confectionnés en simili-japon ou papier washi japonais.

Les programmes du Théâtre-Libre sont quant à eux pour la plupart en papier vélin – parfois simili-japon –, un nouveau papier très onéreux. L’invention du papier de bois, peu coûteux, date de 1880, auparavant le papier était issu des chutes textiles. De manière analogue, le supplément théâtral de L’Illustration – lancé en 1889 – se distingue par son ruban textile ornemental, aussi joli que soyeux. De nombreux programmes-magazines reprendront cet attribut fibreux dans les années suivantes, notamment le Photo-programme (1895-1897), La Soirée (1898-1902) et le Petit Orchestre (1901-1906). Il y aura même un mouchoir-programme, entièrement imprimé sur tissu et édité à l’occasion de la première de L’Aiglon.

Aux antipodes de la douceur du fin ruban, on trouve le rugueux d’un gaufrage de couverture. Des sculpteurs, tels que Auguste Rodin et Alexandre-Charpentier, se livrent à la réalisation de programmes de théâtre. Ce dernier se fit même connaître pour sa technique de « l’estampage en relief » appliquée au programme. À la façon du sculpteur antique Lycurgue à l’entrée du théâtre d’Athènes, le Théâtre-Libre expose par ailleurs dans le hall d’entrée les bustes de ses dramaturges, réalisés par Alexandre-Charpentier.

Bien que plus rare, le domaine olfactif n’est pas en reste. Son association à l’ornementation du papier est une pratique ancienne, Madame de Sévigné en évoque l’usage. On sait que l’entrepreneur et parfumeur britannique Rimmel – mécène et collaborateur de Jules Chéret lors de ses années passées en Angleterre – parfumait les imprimés qu’il éditait dans les années 1860 et 1870, dont des programmes de spectacles. Un précurseur en matière de marketing olfactif. Vers 1878, son concurrent, l’éditeur Aubert, fera de même pour une grande partie des programmes de théâtres londoniens dont il assurait la production. On ne sait pourtant si cette pratique eut des émules en France. En revanche, l’un des bijoux-programmes de l’Eden-Théâtre – celui daté de 1889 et exposé un peu plus haut – comporte la mention « Imprimé et Parfumé par la Maison Rapide ». Il demeure, à notre connaissance, le seul de son espèce.
En dernier lieu, le caractère hybride du programme de théâtre ne pourrait mieux être exprimé que par son aptitude à usurper l’apparence et même la fonction d’un autre objet. Alors que sous le Second Empire on expérimente des programmes sous forme de jeu de carte, la Troisième République voit fleurir le programme-éventail. Accessoire de mode par excellence, l’éventail constitue le symbole ultime du raffinement. Après s’être grandement fait remarquer lors des représentations théâtrales de cour de l’Ancien Régime, il est en passe au XIXe siècle d’entamer sa résurrection. Grâce au développement de l’image imprimée, mais également en devenant support de choix chez toute une génération de peintres. Soutenu par des pales de bois, ou se dépliant tout cartonné, il emprunte parfois ses formes à l’Art nouveau.


Pour finir, présentons le fameux et unique mouchoir-programme. Édité à l’occasion de la sortie de l’Aiglon d’Edmond Rostand, sa préciosité marque l’arrivée du XXe siècle. Tissant le lien entre spectateur et spectacle, sa fonction de mouchoir témoigne de son caractère intime.

Programmes-témoins
On peut apercevoir, sur ce programme-mouchoir, la signature de Napoléon, son personnage principal. Généralement, l’esthétique du programme s’inspire de celle du spectacle. Le régisseur, le directeur du théâtre, ou, plus tard, le metteur en scène, est en charge de sa production. Pour les programmes avant-gardistes, le lithographe en charge de sa réalisation est parfois aussi en charge des costumes ou des décors. C’est le cas d’une pièce indienne, Le Chariot de terre cuite, représentée au Théâtre de l’Œuvre, pour laquelle Henri de Toulouse-Lautrec s’est attelé à la réalisation des décors et du programme. Ce dernier constitue le dernier vestige pour s’imaginer les décors de ce spectacle.

L’esthétique du spectacle passe ainsi par son harmonie, qui va du décor au programme. Ce dernier est le prolongement de l’œuvre scénique annoncée. L’affaire judiciaire du Select-Programme semble corréler cette nouvelle dimension graphique et visuelle du programme :
Un soir d’avril 1903, à l’Opéra-Comique, eu lieu la première représentation de Pelléas et Mélisande de Maeterlinck. Or, le soir même, aux abords du théâtre, se vendait le Select-Programme, de l’éditeur M. Hennequin. Entrepreneur spécialisé dans l’édition de programmes, il avait déjà été condamné l’année précédente pour y avoir publié en douce des analyses de l’éditeur Calmann-Lévy. Le directeur de salle M. Albert Carré accusa cette fois-ci M. Hennequin de pervertir l’œuvre avant même qu’elle ne fut présentée au public. M. Carré jugea le ton sarcastique de l’éditeur « mauvais », d’un style « moitié auvergnat, moitié faubourien » et voulut appliquer à ce dernier une peine exemplaire, afin de dissuader d’autres éditeurs officieux de suivre le même chemin. L’accusation présenta l’argument que l’auteur s’efforçait de ne pas préciser les temps et les lieux, quand le Select-Programme en détaillait grossièrement les scènes et personnages. M. Hennequin fut condamné à 500 francs de dommages et intérêts, contre les 10.000 francs quémandés initialement, en raison d’un droit à la critique – bonne comme mauvaise –, toutefois teinté d’un manque de tact en matière de distribution.
Porter atteinte à la représentation d’une œuvre par le biais d’un programme a donc été jugé condamnable. Les directeurs de salle voyaient en ces programmes officieux une concurrence déloyale, ne serait-ce qu’au niveau financier (ils étaient souvent moins chers que ceux qu’ils vendaient officiellement dans le théâtre). L’apposition en couverture du sigle « programme officiel » semble émerger vers 1900, avec l’ouverture du Théâtre Sarah-Bernhardt, une période où les théâtres vont progressivement reprendre les rênes de la production de leur programme.
Surfaces esthétiques
« Des nombreux décors de Vuillard, Cérusier, Maurice Denis, Dethomas, futurs collaborateurs de Rouché, il ne reste que des programmes, à travers lesquels on peut imaginer un style. » Gilles Quéant (dir.), Encyclopédie du théâtre contemporain, volume 1 : 1850-1914, Paris, Les Publications de France, Coll. « Théâtre de France », 1959, p. 143.
La plupart des courants esthétiques contemporains se retrouvent dans le programme de théâtre, renforçant le caractère hétérogène de leur collection. On peut observer les lignes courbes de l’Art nouveau dans l’éventail du Théâtre Marigny, l’orientalisme alors très en vogue dans les Bijoux-Programmes et dans le programme du Chariot de Terre Cuite. Les courants naturalistes ou symbolistes s’y retrouvent également : signé pour composer les huit programmes de la saison 1892-1893 du Théâtre-Libre, le journaliste nabi Henri-Gabriel Ibels se fait remarquer par son utilisation « spectaculaire » d’une lithographie huit couleurs. Le Courrier Français ne manque pas de signaler avec humour que ces « couleurs semblent vouloir s’attacher aux mains qui les touchent », annonçant « la mort des gants clairs ». Ibels aime représenter les gens du peuple de son style tacheté – qui n’est pas sans rappeler celui des macchiaioli, peintres véristes italiens des années 1870 dont le nom signifie « tâchistes » –, offrant à ses dessins une véritable dimension naturaliste. L’utilisation de couleurs vives – articulée à un style caricatural préfigurant le fauvisme et l’expressionnisme – rappelle aussi le symbolisme, courant esthétique qui refusait la rationalité du langage sémiotique naturaliste et puisait son inspiration dans la poésie de Baudelaire, Verlaine et Mallarmé.

Tout comme le Moulin-Rouge déclinera son image de marque sous forme de programmes, la plupart des salles vont présenter et médiatiser leur projet esthétique au travers de leurs programmes. Les lettres ensanglantées du programme du Grand-Guignol annoncent ainsi efficacement le genre de pièces jouées. Le Théâtre du Palais-Royal se concentre sur son histoire passée, tandis que le Nouveau-Cirque décline sur ses programmes l’imagerie du cheval, ici symbole des classes aisées et aristocrates.

Encore plus curieux, l’utilisation de la photographie pour saisir les espaces scéniques : les programmes du cabaret de la Pie qui Chante se composent ainsi d’un cliché de l’intérieur du théâtre et, en couverture/ouverture, de l’entrée de la salle.

Le programme est un espace de communication où s’entrecroisent des iconographies plurielles. On en distingue principalement trois : l’iconographie du spectacle, l’éditorial et le publicitaire. Les éditeurs sont les premiers à développer et à soigner leur image grâce au logo, souvent apposé en quatrième de couverture.

En définitive, la mise en page des programmes a considérablement évolué durant la Belle Époque. On peut parler de théâtralisation de l’édition. Face aux raffinements de la composition des programmes d’avant-garde, la photographie seule ne suffit plus à provoquer la fascination. Elle se fait mise en scène.

Stars et portraits
Le terme « vedette » – signifiant autrefois une position surélevée – désigne dès le XVIIIe siècle les mots imprimés en grand sur une affiche, puis, par métonymie, les artistes les plus importants d’un spectacle. La modernisation de la célébrité fut induite par les mutations de l’espace médiatique, rassemblant désormais un large public d’admirateurs autour d’une vedette. La photographie de portrait – imprimée et enrichie de contenu textuel – va renforcer ce lien entre star et fans, renforcer bientôt par le cinéma. Ces portraits-photos, accompagnés de biographies, deviennent rapidement une composante clé du programme de théâtre. Tout comme les éditeurs du Moyen-Âge utilisaient le portrait des poètes pour faire meilleure publicité de leurs manuscrits, les entrepreneurs de spectacle du XIXe siècle s’appuient désormais sur la présence de véritables têtes d’affiches dans le but d’augmenter la probabilité de rentabilité d’une pièce. C’est l’avènement du star-system.
André Antoine fonde son Théâtre-Libre notamment en réaction à ce système, privilégiant l’homogénéité de la troupe sur la valorisation de quelques individus, ainsi que le dessin de tradition picturale sur la photographie. La présence de portrait de vedette au sein de programmes n’est toutefois pas forcément synonyme de vénalité. À titre d’exemple, la figure d’Offenbach fut utilisée à des fins caritatives lors d’un concert organisé par le Théâtre Femina en 1912. Les pages de son programme sont exclusivement couvertes de portraits du célèbre compositeur, alternant entre photographies et caricatures.

La photographie est « le meilleur esratz de la présence réelle ». Sa matérialité permet de « la contempler et l’adorer » comme si elle était une poussière d’âme prélevée sur la vedette, un morceau d’elle-même. Toute une économie se développe autour des célébrités, basée principalement sur la reproduction photographique, mais également sur des produits appartenant à l’univers de la vedette. Ce sont en général des marchandises liées à la beauté, « équivalents modernes des philtres d’amour ». Les marques sponsorisent les vedettes en leur faisant porter vêtements, chapeaux et parfums. L’industrie de mode naît autour de ces célébrités partenaires, que l’on nommera bientôt « égéries ».

Il existe des cas plus particuliers de sponsoring : Firmin Gémier, directeur du Théâtre Antoine dès 1906, annonce la tournée estivale passée dans son programme officiel, marquée du sceau de l’industrie automobile. Ces derniers ne manqueront pas de signaler que « 7.690 kilom. » ont été parcourus en « 38 jours », et ce « sans aucune panne ». Les grandes tournées de vedette se sont développées lors du Second Empire, grâce à l’argent généré et surtout grâce au développement des transports. Alors qu’une vedette comme Rachel dispose dès 1849 de sa « propre voiture », permettant d’assurer 74 représentations dans 35 villes en moins de deux mois, Firmin Gémier assure 42 dates de représentations en un peu moins d’un mois. Ce semblant d’ubiquité conféré à la star, renforcé par le portrait-photo mais aussi par l’élitisme des nouveaux moyens de transport, a sans doute contribué à l’aura divine des célébrités. Ainsi que préfiguré à l’omniprésence de la star dans les médias que seront le cinéma et la radio.
La réclame, une fenêtre sur la vie moderne
L’histoire publicitaire est indissociable de celle du journal. Théophraste Renaudot, créateur du premier journal français en 1631, est également connu pour avoir créé, deux ans plus tard, la petite annonce. Lorsque la presse entama les prémices de sa révolution, la publicité devint une composante clé de l’augmentation du nombre de page, permettant d’amoindrir le coût de production. On doit ce tour de force à Émile de Girardin, fondateur du quotidien La Presse en 1836, qui en augmentera les pages vers 1844 en y multipliant sponsors et annonceurs publicitaires. Une profonde mutation médiatique qui donnera naissance à la presse moderne. L’essor des annonces entraîne alors leur diversification.
Vers 1850, Édouard Lebey, gérant de la publicité de La Presse, rédige le premier traité pratique sur la publicité. Il y distingue notamment trois types d’annonces. Tout d’abord l’annonce-uniforme, ou annonce anglaise, n’utilisant aucun effet typographique. Ensuite l’annonce-affiche, de taille très variable et aux multiples artifices visuels. Elle est en quelque sorte la transposition dans le journal des affichettes que les libraires apposaient contre leurs vitrines. Enfin, et non des moindres, la réclame ou le « fait-Paris payé » (petit article reprenant une nouvelle mondaine), soit une publicité déguisée en article et ayant pour but de « tromper le lecteur ». Il peut s’agir d’un article purement textuel, ou encore de manière plus pernicieuse d’un trompe-l’œil imitant la mise en page du programme, comme par exemple la biographie d’artiste accolée à son portrait-photo.

La méthode est proche de ce que les anglais appellent le puffing, c’est à dire la sollicitation des journaux dans le but d’insérer des articles élogieux. Le caractère peu scrupuleux de tels publicités participera à la représentation négative de la réclame publicitaire.
Sur l’ensemble des programmes que j’ai pu observer – soit une petite centaine – le secteur publicitaire dominant est celui du soin du corps et de la mode. Le public visé semble donc essentiellement féminin, au Théâtre du Palais-Royal comme à celui d’Antoine. Toutefois une minorité d’annonces s’adressent aux hommes, et notamment à ceux dont les crânes sont les plus dégarnis. De nouveaux idéaux de beauté était en train de se répandre sur de nombreux supports, dont le programme de théâtre, à une échelle encore jamais atteinte historiquement. Cette conception moderne de la beauté physique se propagea notamment grâce à l’exposition médiatique croissante des vedettes. Le public projette ainsi sa propre perception de la beauté sur des stars l’incarnant pour de vrai, en photographie.


Cette prise de conscience accentuée du corps humain s’accompagne du besoin de le chérir. Une politique d’hygiène publique se développe au fil du siècle, que l’on nomme « hygiénisme » à partir de la Troisième République. Le bain mensuel, autrefois réservé à une élite, est en passe de se démocratiser avec l’ouverture de bains publics. Il devient même l’un des arguments principaux en faveur de la réinstauration du repos hebdomadaire, afin que les ouvriers puissent se laver. C’est ainsi que l’industrie réintégrera le dimanche en 1892, puis l’ensemble des salariés en 1900. Ceci explique en partie la présence écrasante de publicités visant à soigner le corps dans l’ensemble des programmes parisiens de l’époque. La salle de bain y est notamment très présente et s’y illustre en gravure ou en photographie, généralement accompagnée d’une femme ou d’enfants. Ce nouvel espace domestique va rapidement s’imposer comme le lieu phare où la bourgeoisie nouvelle se toilette et se parfume, se prépare pour le spectacle.

Tout un imaginaire de l’intérieur domestique se développe ainsi, mis en vitrine par la scène théâtrale et par le cliché reproduit sur papier. Le secteur de l’ameublement va ainsi pouvoir exposer l’étendue de son catalogue – autrefois entièrement textuel – de manière visuelle afin de susciter le désir d’ordre, de confort et de sérénité. De manière plus générale, c’est tout un art de vivre bourgeois qui transparait dans l’iconographie publicitaire du programme de théâtre. Alors que l’expression « art culinaire » s’impose durablement à partir des années 1880 – notamment grâce aux nombreuses expositions dédiées – des services de table se mettent en scène sur papier.

Cette nouvelle société, friande de confort et de loisirs, aime à posséder, dans son séjour, un superbe piano à queue comme ceux d’Antoine Bord. Les diverses publicités du genre semblent viser essentiellement un public jeune et féminin. Il était sans doute de bon aloi, pour une jeune fille de bonne famille, de savoir jouer de ce noble instrument en présence d’invités.

De nouveaux loisirs, plus modernes, vont également émerger en cette période. C’est le cas de la musique enregistrée, avec par exemple le gramophone – breveté en 1887 – qui sera dépeint dans quelques programmes. On peut également évoquer la photographie, loisir en douce voie de démocratisation, et notamment l’appareil photographique couleur Autochrome que les frères Lumière brevètent fin 1903.

Produite en série dès 1891 par Panhard & Levassor, l’automobile va progressivement s’imposer comme le moyen de transport du XXe siècle. Elle joint en effet l’utile à l’agréable, la vitesse au confort, modernité et élégance. Les constructeurs vont évidemment préférer miser sur l’aspect ludique du véhicule, proche du jouet, plutôt que sur sa dangerosité. Les automobiles Berliet communiquent quant à elles autour du cérémoniel de l’entrée au théâtre, qui plus est lors d’une nuit pluvieuse.

Le programme peut aussi devenir le théâtre d’opérations publicitaires. Par exemple l’éditeur Pierre Lafitte offre des places de spectacle aux abonnés de ses publications, pour l’ouverture du Théâtre Femina, dont il est le directeur. Aussi, de nombreux bons à découper se disséminent dans les programmes. Certains éditeurs peu scrupuleux vont jusqu’à affirmer que ces « primes » remboursent « dix fois le prix du programme ». Dans un autre programme – celui de la Scala, 1906 – une annonce-uniforme nous suggère de « demander dans tous les restaurants les desserts “Attraction” contenant des billets de théâtres et concerts ». C’est en cette fin de siècle que le terme « publicité » va se doter de son sens commercial, les frontières entre économie et publication se précisant davantage.
Un objet hybride, voici ce qui définit sans doute le mieux le programme de théâtre. Partagé entre sa fonction promotionnelle et mnémonique, son statut de support publicitaire et celui de prolongement de l’œuvre scénique, il est un point de liaison entre théâtre et presse, publicité et art, commerce et divertissement. Dans un contexte de libéralisation de l’art, il présente une incroyable diversité de prototypes imprimés, qui témoignent matériellement et graphiquement du foisonnement artistique de la Belle Époque.
Pour citer cet article
Julien Dubois, « Le programme de théâtre à la Belle Époque – la naissance d’un média », Lectures & varia numéro 2 [en ligne], mis à jour le 01/03/2025, URL : https://sht.asso.fr/le-programme-de-theatre-a-la-belle-epoque/