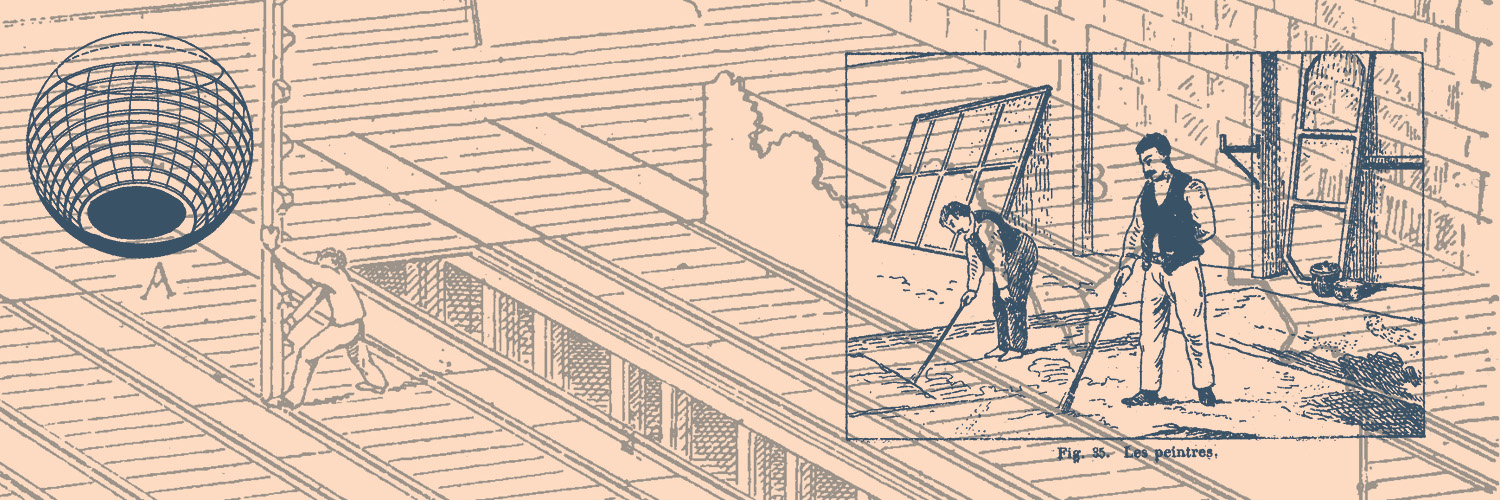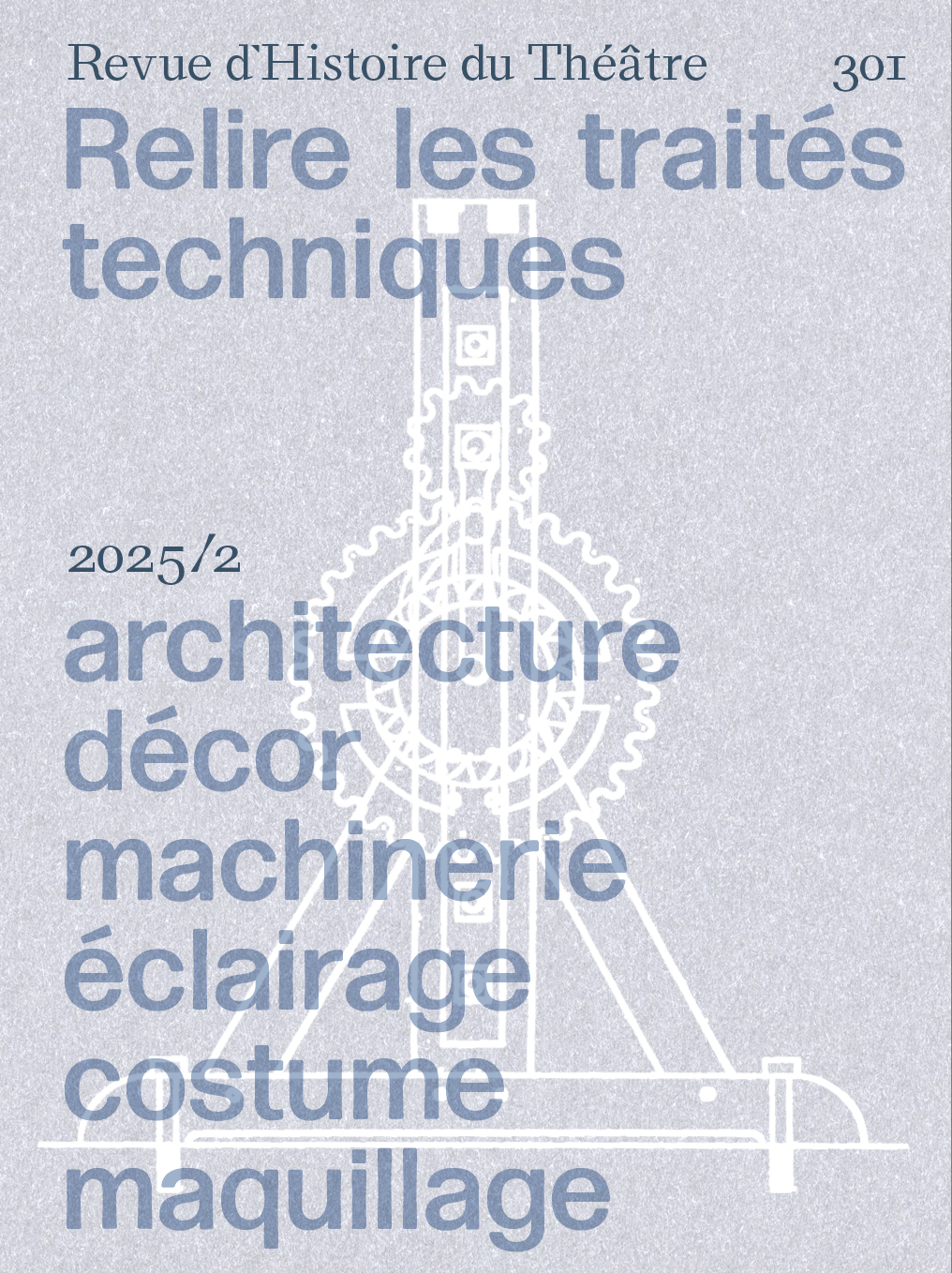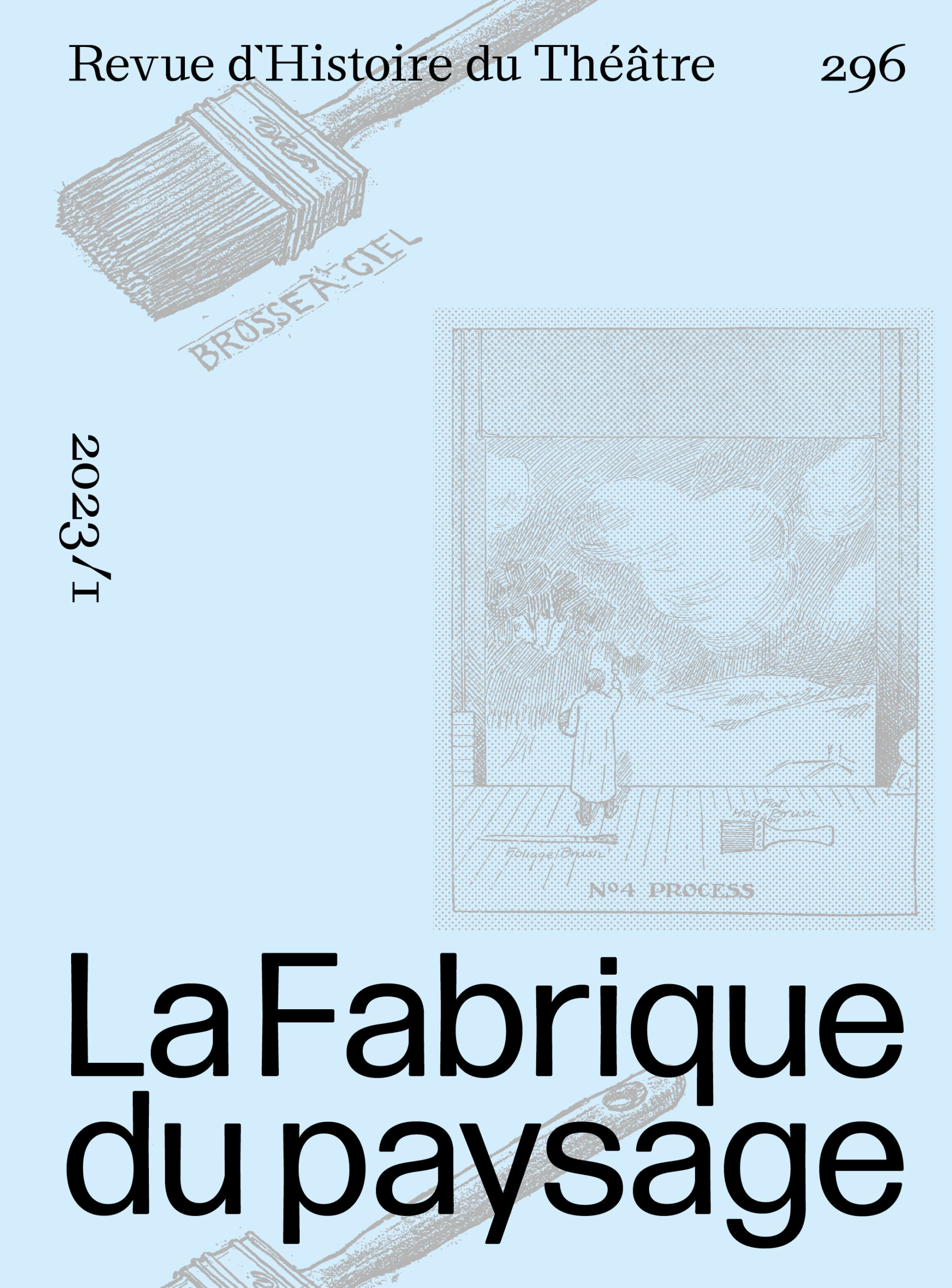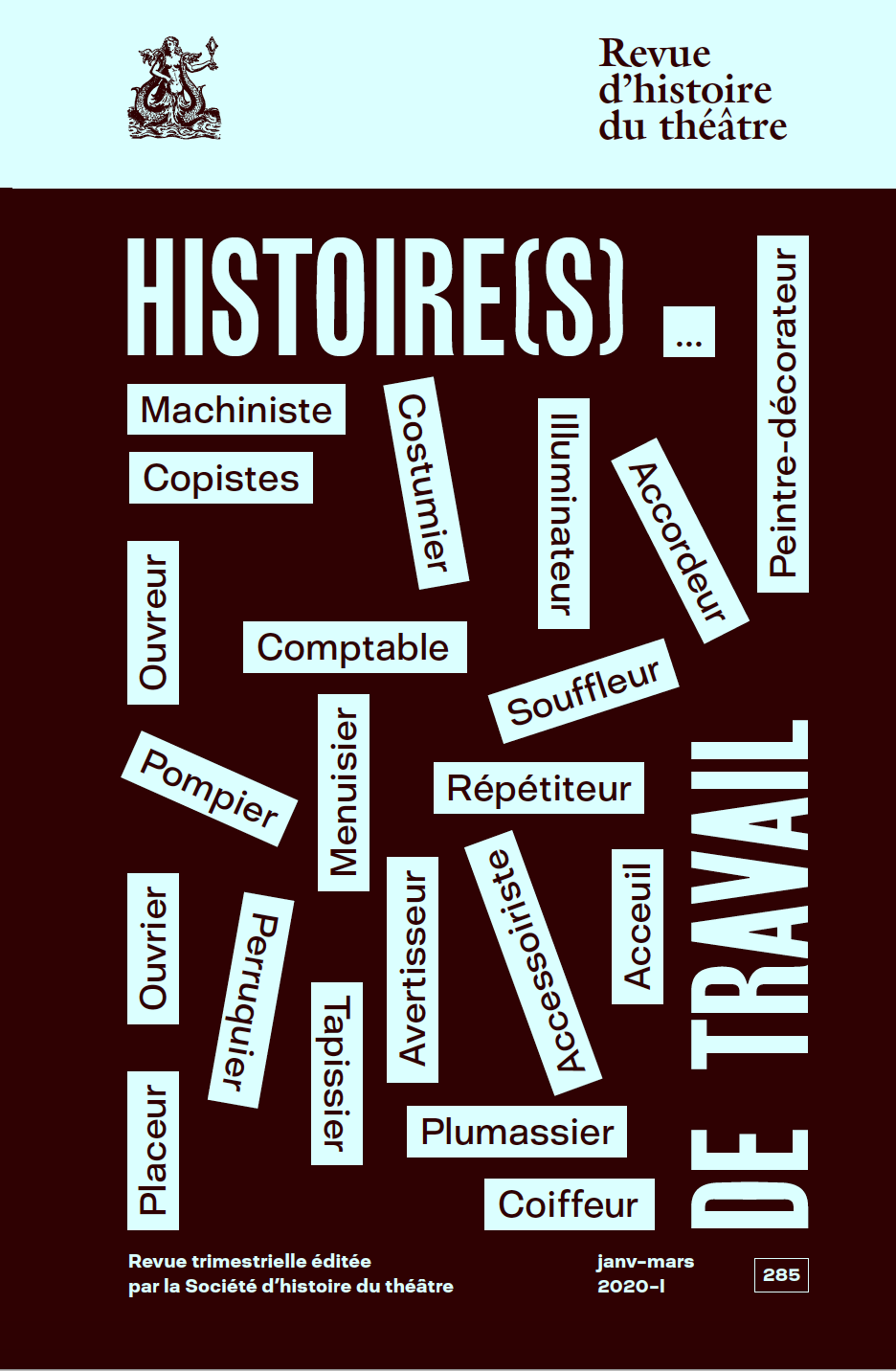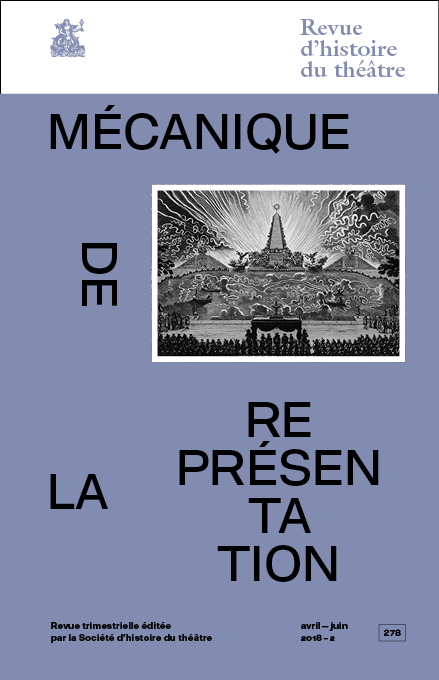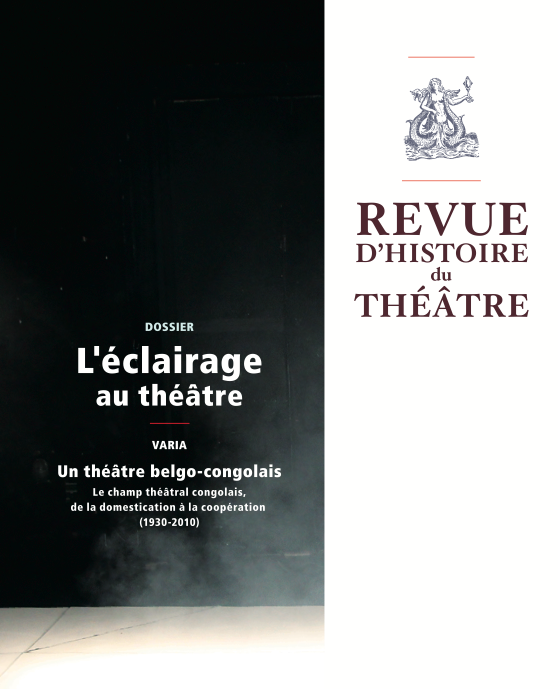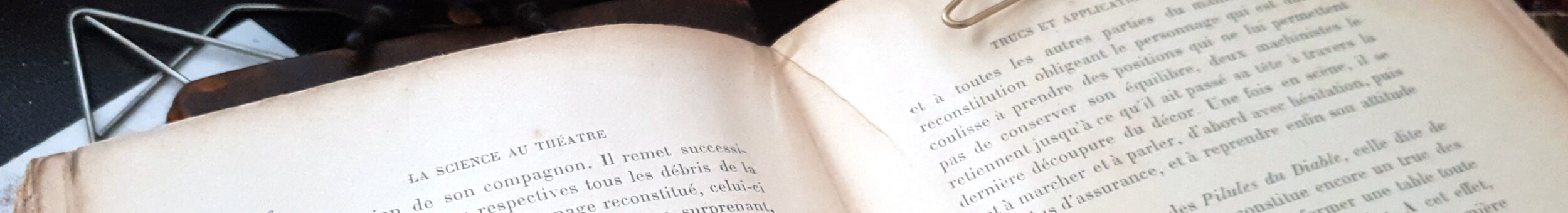Revue d’Histoire du Théâtre • N°301 S2 2025
Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments
Par Simon Willemin
Résumé
Ce dossier présente une édition de documents jusqu’alors inédits se rapportant à la préface de Louis Jouvet pour Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicola Sabbattini (Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942).
Il contient : le texte d’une conférence de Jouvet sur la machinerie (23 avril 1938), des notes préparatoires pour la préface (env. 1941), la correspondance entre Louis Jouvet et l’éditeur Fred Uhler (1941-1942) ; un texte anonyme et fictif inspiré de la vie de Sabbattini qui se trouve au sein de la documentation rassemblée par Jouvet ; et trois bibliographies.
Texte
Pour citer ce dossier : Simon Willemin, « Le Sabbattini de Louis Jouvet : Compléments », dossier complémentaire à Revue d’Histoire du Théâtre, no 301, 2025.
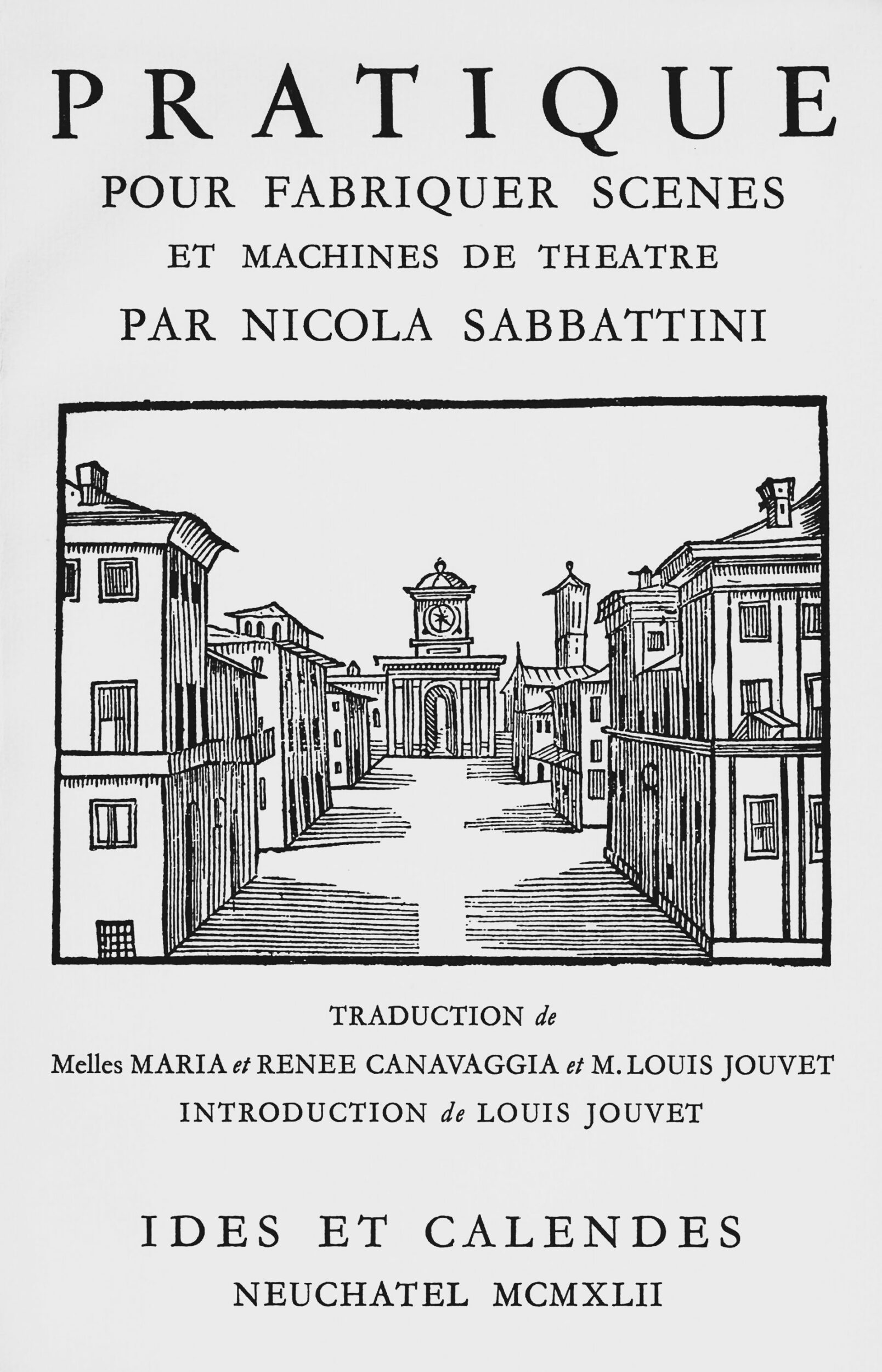
Ce dossier en ligne, en complément de l’article « Le Sabbattini de Louis Jouvet : Traité d’un machiniste et livre de méditation » paru dans la Revue d’Histoire du Théâtre no 301, présente une édition de documents jusqu’alors inédits se rapportant à la préface de Louis Jouvet pour Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicola Sabbattini (Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942). On trouvera ci-après :
1. Causerie sur la machinerie théâtrale (23 avril 1938), le texte d’une conférence de Louis Jouvet, vraisemblablement prononcée avant qu’il ne découvre le traité de Sabbattini (il était néanmoins au fait de son existence), et dont il reprendra des idées dans la première moitié de la préface ;
2. Notes préparatoires pour la préface au traité de Sabbattini (env. 1941), des notes de Louis Jouvet où l’on reconnaît une partie des thèmes abordés dans la deuxième moitié de la préface ;
3. Correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler (1941-1942), une correspondance qui s’ouvre sur la prise de contact de l’éditeur Fred Uhler avec Louis Jouvet afin de lui demander de le mettre en relation avec Jean Giraudoux et qui se termine sur une lettre où Uhler rapporte avoir remis l’un des premiers exemplaires de Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre à Giraudoux ;
4. « Histoire à propos de Sabbattini », un récit fictif inspiré de la vie de l’auteur italien, anonyme et non daté, qui se trouve au sein de la documentation rassemblée par Louis Jouvet ;
5. Bibliographies se rapportant à Nicola Sabbattini, Louis Jouvet et Fred Uhler, trois bibliographies contenant les éditions du traité de Nicola Sabbattini, les pré-éditions et rééditions de la préface ou d’extraits de la préface de Louis Jouvet et les livres édités par Fred Uhler entre 1941 et 1943.
Provenance
Les documents édités et les archives dont il est question dans les notes proviennent du fonds Louis Jouvet (cotes commençant pas LJ) et du fonds Jeanne Mathieu (cotes commençant par 4-COL-352) conservés au Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France (BnF), ainsi que du fonds Frédéric Uhler (cotes commençant par FUHL) conservé à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN).
Protocole éditorial et annotation
Le texte établi correspond à l’état du texte après amendement des corrections et ajouts manuscrits ou dactylographiés et après correction des coquilles manifestes[1]. Pour les textes dactylographiés, les corrections et ajouts manuscrits qui ne portent pas sur des coquilles manifestes ont été signalées dans des notes de fin (situées à la suite de chaque document édité), à l’exception de quelques soulignements.
Les conventions éditoriales suivantes sont adoptées :
- XXX indique un texte barré à la machine à écrire.
- XXX indique un texte souligné.
- ‹XXX› indique un texte dont le déchiffrage est incertain.
- [1 mot ill.] indique un mot illisible.
Un double système de notes est adopté : les notes qui apportent des éclaircissements, en chiffres arabes, se trouvent en bas de page ; les notes qui indiquent des particularités de rédaction (ajouts manuscrits, mots barrés, etc.), en chiffres romains, sont qualifiées de philologiques et se trouve, à la suite de chacun des documents édités, dans un cartouche où leurs caractéristiques physiques (description, collation, etc.) sont précisées[2].
Abréviation
DdS : Louis Jouvet, « Découverte de Sabbattini », dans Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942, p. XV-IV.
Remerciements
J’adresse mes remerciements à Laurent Uhler, Anne-Catherine Uhler et Stephan Uhler, qui m’ont autorisé à éditer la correspondance entre Fred Uhler et Louis Jouvet. Je remercie également les responsables des fonds conservés à la BnF et à la BPUN pour leur accueil et leur disponibilité. Enfin, je remercie Pierre Causse pour sa relecture attentive et ses précieuses suggestions.
1. Louis Jouvet, Causerie sur la machinerie théâtrale (1938)
Le 23 avril 1938, Louis Jouvet donne au Théâtre de l’Athénée une causerie ou conférence-démonstration sur la machinerie théâtrale dont la presse rend compte élogieusement : « Jolie par la simplicité du parler, l’ordre et la concision de la pensée. Émouvante aussi par l’allure grave de l’homme, la concentration évidente des idées et l’amour candide de son travail[3] ».
Le document reproduit ci-dessous est une mise au net du texte de cette conférence en deux parties : une partie introductive où Jouvet initie son auditoire à la machinerie en le mettant en garde contre certaines idées reçues, en définissant des termes techniques (tambour, cabestan, palan, trappes, trapillons, costières…) et en proposant une caractérisation des trois ordres d’architecture dramatique et de leur machinerie respective (f. 1-13) suivie d’une partie démonstrative où les machinistes, accompagnés d’un commentaire où le jargon introduit dans la première partie est employé, décomposent les opérations nécessaires aux changements de décors du Corsaire (1938) de Marcel Achard, une pièce qui était alors jouée au Théâtre de l’Athénée (f. 13-15).
Quelques éléments de cette conférence seront repris par Jouvet dans la préface à Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, en particulier dans sa première moitié, dans les sections intitulées « Qu’est-ce que la machinerie ? », « L’architecture dramatique » et « Les quatre ordres de la mise en scène[4] ». Jouvet ne mentionne pas le traité italien lors de sa causerie, bien qu’il soit au fait de son existence, ainsi qu’en témoignent des notes préparatoires à cette conférence[5]. Le traitement qui est fait du traité dans ces notes suggère que Jouvet avait peut-être lu les extraits traduits par Juliette Bertrand[6] et parus en 1933, mais que sa « découverte de Sabbattini » est plus tardive. Le 23 avril 1938 constitue ainsi un possible terminus post quem pour ce qui concerne la lecture révélatrice dont il est question dans la préface datée de décembre 1941.
Dans sa conférence de 1938, Jouvet oppose la machinerie au machinisme et prône une machinerie reposant sur des principes mécaniques et actionnée par un être humain. Dans la préface rédigée en 1941, le machinisme n’est pas évoqué et l’accent est plutôt placé sur ce qui se passe dans l’esprit de celui qui a la charge de la scène : « […] construire un décor, le peindre, le mettre en place, l’éclairer, cela se fait par l’imagination et le cœur et non par l’usage de la raison[7] ». La comparaison entre la conférence de 1938 et la préface de 1941 permet ainsi de mesurer quels ont pu être les effets de la découverte du traité italien sur la manière dont Jouvet a envisagé la machinerie.
[f. 1]
Causerie à l’Athénée – le 23 Avril 1938
Je suis très heureux d’accueillir les lecteurs de « Marianne[8] » et très heureux de voir leur curiosité à l’égard des choses de théâtre.
Jean-Jacques Rousseau à qui on proposait un jour de visiter les coulisses de l’Opéra répondit qu’il ne s’en souciait pas et qu’il était fort peu curieux de connaître les grands moyens avec lesquels on fait de si petites choses[9]. Je me réjouis de constater que ça n’est pas votre avis.
Pourtant j’ai quelque inquiétude sur ce que vous attendez de mes machinistes et de moi. C’est une très vaste question que celle de la machinerie au théâtre et qui demanderait pour vous initier une longue conférence préalable, que je ne me sens pas le courage de vous imposer.
Je me suis donc décidé à improviser des explications que je donnerai au moment où vous verrez fonctionner la machinerie du « Corsaire[10] » et je serais très heureux que cette réunion soit une véritable causerie et que ceux qui ont des questions à poser m’interrogentI.
Il ne faut pas croire que la machinerie ceII soit de la physique amusante. Le public ne la connaît généralement que par des histoires courtelinesques où l’on raconte que la mer se fait au théâtre par une grande toile posée à plat sur la scène et sous laquelle [f. 2] s’agitent des figurants plus ou moins désordonnés qui vident des querelles particulières en se donnant des coups de pied au derrière cependant qu’ils font concomitamment les flots[11].
Le public la connaît par ces artifices utilisés même aujourd’hui par les grands magasins à l’occasion des fêtes de Noël (glaces transparentes travaillant autour d’un axe et cascades de tulle argenté), et autres expériences qui relèvent plutôt de cet ouvrage qu’on appelle « Tom Tit[12]« , où on apprend à faire tenir ensemble 40 bouts d’allumettes, à enflammer de l’eau avec un peu de sodium ou autres prestidigitations à l’usage des enfants.
Il ne faut pas croire non plus que la machinerie ce soit des inventions sensationnelles dont vous avez entendu parler dans les journaux et qui s’appellent : scènes tournantes, cycloramas, scènes à ascenseurs. Toutes ces inventions sont relativement modernes et n’ont rien à voir avec la machinerie. Elles ont été apportées au théâtre par des ingénieurs et des techniciens qui ne sont malheureusement pas des gens du métier et qui ont cru pouvoir appliquer au théâtre les moteurs électriques, le principe mécanique des ponts transbordeurs, ou celui des vannes qu’on voit dans les grands barrages construits de nos jours. [f. 3]
Toutes ces inventions mécaniques sont le contraire de la machinerie et les théâtres qui en sont dotés sont des théâtres où on ne peut justement pas faire de machinerie. Je citerai – à voix basse – le théâtre Pigalle dans lequel on a dépensé 75 millions pour équiper une scène de quatre ascenseurs électriques, avec emploi pour les manœuvres de super-structure – ce qu’on appelle les cintres – de la force hydraulique[13].
La véritable machinerie est faite à bras d’homme et avec des principes mécaniques extrêmement simples, presque primitifs, qui sont tous empruntés à l’art du navigateur au temps de la marine à voiles. La plupart des machinistes, autrefois, étaient des gabiers, c’est-à-dire – sur les bâtiments à voiles – les meilleurs marins, ceux qui étaient chargés des cordages, des mâts, des gréments, des ancres et des embarcations.
Les principes mécaniques auxquels la machinerie fait appel sont :
le tambour, qui est une forme plus savante du treuil ;
le cabestan qui est aussi une forme du treuil, utilisé dans la marine ;
et toutes les variétés de palans. Le palan, comme vous le savez est un système de poulies qui permettent de multiplier la force, ou de multiplier le poids de charge.
Avec les contre-poids, ce sont là les principaux [f. 4] éléments moteurs de la machinerie.
Toutes les inventions réalisées en machinerie le sont par l’application de ces procédés, de ces instruments ; quant aux inventions de détail, elles sont innombrables : la scène d’un théâtre est une machine à illusions.
Je définirai donc la machinerie comme l’ensemble des machinesIII destinées à produire créer l’illusion dramatique, ou à y contribuer.
Si j’en avais le loisir, j’essaierais de vous expliquer plus amplement la différence qui existe entre la machinerie et le machinisme.
La machinerie est un art vivant qui exige de ceux qui le pratiquent – et au même titre que chez l’acteur – un sentiment dramatique, soit que le machiniste invente son appareil, soit qu’il le construise, soit qu’il le conduise, c’est-à-dire qu’il le fasse fonctionner[14]. Le machiniste n’est jamais comparable à l’ouvrier d’usine qui travaille à la chaîne et que l’automatisme asservit de plus en plus. La machinerie théâtrale est, si je puis dire, humanisée par le machiniste et reste ce que sont restés les métiers primitifs du tisserand, du potier, du marin à voilesIV.
Je définirai donc encore la machinerie comme l’art du merveilleux et de la convention théâtrale.
Toutes les inventions mécaniques qui ne sont pas rigoureusement traditionnellesV sont contraires à l’art théâtral. [f. 5]
Vous allez voir tout à l’heure manœuvrer un certain nombre de ces machines construites, mues et conduites par des hommes. Vous comprendrez alors plus clairement ce que je viens de vous dire.
Si je ne craignais pas d’être trop long, je vous donnerais quelques explications sur l’architecture théâtrale :
Il y a trois ordres d’architecture dramatique[15] :
l’ordre grec et romain ;
l’ordre qu’on a appelé shakespearien ou élisabéthain ;
l’ordre italien, c’est celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui[16].
La machinerie, dans chacun de ces trois ordres, correspond à l’édifice ; elle en est la partie vivante, c’est elle qui explique le dispositif architectural.
Chez les Grecs et chez les Romains – dans le premier ordre, par conséquent – le théâtre est un hémicycle construit en gradins ; sur le grand diamètre de cet hémicycle est élevée une scène rectangulaire qui est généralement limitée par un mur percé de portes. Il y a à Orange un théâtre romain que vous avez pu voir. L’Italie, la Sicile et la Grèce possèdent des théâtres qui répondent à cette disposition.
En quoi consiste la machinerie dans ce premier ordre ?
Les Grecs et les Romains utilisent déjà les mêmes principes : c’est-à-dire : le chariot roulant qui sert aux apparitions et qui s’appelle l’ekkikléma ; [f. 6]
un câble sur un cabestan qui sert à faire descendre du haut du mur de scène au milieu de celle-ci un char, ou à faire voler dans les airs des personnagesVI. C’est la méchanée, une espèce de grue :
un chariot roulant qui était situé également sur le haut du mur de scène et qui sert à l’apparition des dieux ; c’est le théologéionVII.
Le théâtre grec utilisait déjà les trappes, c’est-à-dire des ouvertures ménagées dans le plancherVIII de scène et qui communiquaient avec les dessous.
Il faisait aussi usage de ce qu’on appelait les périactes. C’était, de chaque côté de la scène, des châssisIX à trois faces équilatérales qui présentaient chacune une décoration : tragique, comique ou champêtre et qui pivotaient sous les yeux des spectateurs à chaque changement de scène.______
Il serait trop long de vous parler en détail du dispositif shakespearien et de sa machinerie. L’édifice dans lequel jouaient Shakespeare et ses contemporains était un cirque aménagé avec une estrade qui avançait en triangle jusqu’au centre de cette arène (l’orchestre de nos jours) où étaient les spectateurs qui se tenaient debout.
La machinerie ne s’est pas développée beaucoup dans cet ordre architectural. L’imagination des spectateurs de Shakespeare était assez grande, comme [f. 7] celle des spectateurs de l’Antiquité pour se contenter d’artifices simples et apparents comme l’étaient ceux des pièces d’alors.
La machinerie fondée sur l’artifice est noble ou ignoble selon le machiniste qui la pratique, selon le spectateur auquel elle est présentée. Elle est noble quand elle est embellie et magnifiée par l’imagination du public ou par le sentiment dramatique du machiniste et de l’auteur.______
La Renaissance nous porte alors au troisième ordre théâtral. C’est l’édifice italien inventé par les architectes en tête desquels il faut placer Serlio et Palladio et qui date de trois siècles déjà.
La scène est devenue ici, très particulièrement et grâce aux peintures et à la décoration perspective, un dispositif pratique où la machinerie a joué depuis le 17ème siècle un rôle considérable.
Le théâtre dans lequel nous nous trouvons en ce moment est un théâtre italien. Pour expliquer ce qu’est ce théâtre, il faut d’abord dire que cette forme architecturale a été conçue vers le 16ème siècle. Entre les branches du fer à cheval que forment les murs de la salle, se trouve une surface rectangulaire qu’on appelle la scène et qui est destinée au jeu. [f. 8]
Cet ordre architectural est basé sur l’art de la perspective et sur l’utilisation des lois de la perspective pour la fabrication des décors.
Le secret de cette architecture, qui est à peu près perdu à l’heure actuelle pour la plupart des architectes modernes, réside dans cette disposition particulière des spectateurs par rapport à l’image fabriquée par le décorateur.
Chaque spectateur, de sa place, bénéficie de la perspective de cette peinture, exécutée sur des panneaux plats ; il jouit en même temps d’une audition parfaite de la musique, de la [f. 9] voix des acteurs et des chanteurs. C’est cette disposition parfaite qu’on a appelée la courbe auditovisuelle[17] et qui est le secret de toutes les architectures dramatiques.
En somme le théâtre italien se trouve être un appareil où chaque spectateur doit voir et entendre parfaitement et où la position de chacun dans la salle, sa vision personnelle, totalise et commande, par une série de lignes dites perspectives imposées au décorateur, la perspective même du décor qu’il doit peindre.
Il faut dire que ce théâtre italien, tel qu’il est actuellement, ne comporte plus les décors plats. Certains d’entre vous ont pu voir dans des théâtres de province ces décors constitués par des châssis posés à plat les uns derrière les autres, de chaque côté de la scène, dans sa profondeur, et représentant une forêt, un château, des fortifications, etc…
On peut encore voir de ces décors à l’Opéra dans certains spectacles, dans des patronages, ou sur des scènes de province, surtout lorsqu’il s’agit de représenter des arbres. Peu à peu ces décors plats ont été remplacés par d’autres, les décors vrais, c’est-à-dire entièrement construits. Cette modification du décor tient essentiellement à deux causes :
l’une est l’importance que l’éclairage a acquise, de sorte que l’imagination du spectateur a diminué [f. 10] parce que sa vision est devenue plus claire, plus précise ;
l’autre cause, c’est la production dramatique elle-même ; à partir d’Émile Augier et d’Alexandre Dumas, (1845) les pièces se passaient presque entièrement dans des salons ; à partir surtout du Théâtre-Libre où l’on voulait donner sur la scène un réalisme que, grâce à Dieu, le cinéma a repris à son compte, ces décors dits à coulisse, ces décors de peinture perspective ont presque disparu.
L’instrument est resté. Cet instrument comporte, comme vous le voyez, un plancher de scène qui est divisé en un certain nombre de plans. C’est un plancher entièrement mobile ; il est supporté par des chandelles de bois coiffées de poutrelles légères entre lesquelles s’insèrent des carrés de planches qu’on appelle des trappes. Un plan, au théâtre, comporte une trappeX et un ou deux trapillons. Les trapillons sont séparés comme les trappes elles-mêmes par des chapeaux de bois qui sont également mobiles et qui constituent ce qu’on appelle une costière.
Tout ce plancher est mobile, comme vous le verrez tout à l’heure. Il est déplacé par des agencements de machinerie proprement dits qui s’appellent des tiroirs. Sous ce plancher, il y a le dessous de scène, qui se divise en premier dessous, deuxième dessous, troisième dessous. [f. 11]
La hauteur du dessous de scène est à peu près égale à celle de la cage de la scène. Ainsi à l’Athénée, le dessous de scène a 7 mètres de profondeur ; la hauteur de la cage de scène (du plancher au cintre) est de 7 mètres aussi environ ; c’est aussi la hauteur du dessus de scène, du cintre à la grille.
Au-dessous et au-dessus de la scène sont disposés les appareils de manœuvres de machinerie.
La scène est donc divisée en trois espaces très distincts : le dessous, la scène proprement dite, les cintres.______
Je ne vous parlerai guère de la lumière, qui nécessiterait un chapitre spécial[18]. Vous en verrez les effets tout à l’heure ; qu’il me suffise de vous dire que le théâtre antique, comme le théâtre élisabéthain était joué en plein jour, ou à la tombée de la nuit, que la scène était éclairée par quelques torches seulement.
Dans l’ordre italien, c’est-à-dire il y a trois cents ans, on n’avait pour éclairer la scène qu’une rangée de chandelles et quelques lustres suspendus au-dessus des acteurs.
C’est vers le milieu du 18ème siècle qu’on a inventé le quinquet, la lampe à huile, qui n’était guère plus puissant que la chandelle. Il faut arriver au milieu du 19ème siècle pour voir l’innovation de l’éclairage au gaz, et c’est seulement depuis une [f. 12] cinquantaine d’années que l’électricité a remplacé les autres systèmes d’éclairage.
Je me bornerais à indiquer que la scène actuelle, par rapport à celle de l’époque de Molière, est 500 ou 600 fois plus éclairée.______
Les machinistes vont maintenant vous décomposer les opérations du changement de décor[19]. Elles sont au nombre de huit :
1°) l’entrée d’une table ;
2°) la montée d’une plateforme mue par tambour, au niveau de la scène ;
3°) la montée de cette plateforme au-dessus du niveau de la scène avec des mouvements secondaires ;
tambours et contrepoids ;
(ouverture des murs de l’École des femmes)
4°) le placement de la proue de bateau qui est à l’autre bout, au fond du décor :
ouverture de deux trappes pour apercevoir les potelets qui supportent le plancher et qui sont accessibles (preuve par la plateforme centrale) ; derrière ces potelets, et dans l’espace compris entre ces poutres, se trouvent les chariots de costière.
5°)
A) équipé sur tambour ; 4 fils d’acier – 1600 K° de charge ; contrepoids 1.200 K° (équipe montée sans interrompre les représentations). Restent 400 K°, palanqués soit une fois, soit 200 K° poids réel, [f. 13] qui sont axés sur tambour, lequel triple la puissance, ce qui fait que ces 1.600 K° sont déplacés à bras d’homme avec un effort de 35 kilogs pour chacun des deux hommes qui manœuvrent.
butées automatiques en bois commandées par fil.
B) châssis coulissants à rainure équipés sur tambour, dans l’intérieur des bâtis de la plateforme ;
C) le plafond, commande directe par fil dont les manœuvres et les poulies sont dissimulées dans le panneau même de la construction.
sabords, équipe simple et directe sur fil
toute cette manœuvre se fait à deux hommes.
D) l’ouverture du plancher du théâtre.
ouverture dite à tiroirs – équipé sur tambour – un fil sans fin, principe du rideau des tapissiers avec utilisation du tambour ;
6°) montée de ce qu’on appelle une ferme de théâtre ; 300 K° équilibrés sur tambour
2 mouvements
principe fréquent au théâtre (ex. du rideau des anciens).
7°) descente d’une décoration qui vient du cintre : descente des échelles de cordage et des haubans ; des voiles, du mât ; de la vergue (vergue latine ou d’artimon).
manœuvre dite des cintres – poids contrebalancés, 8 fils de commande ; sauf les 2 voiles de lointain qui sont à la main. [f. 14]
8°) le changement des châssis gris qui entourent actuellement la scène :
châssis du studio dit châssis du pourtour : 6 fils soutiennent chacun des 6 châssis de trois faces construits à angles droits (2 fils par face et par châssis) ce qui fait 36 fils qui sont enroulés autour d’un tambour appelé : tambour différentiel, c’est-à-dire que les circonférences du tambour correspondent rigoureusement à la chute de chacun des châssis. – le châssis du bas, qui accomplit un trajet plus long est commandé par un fil qui s’enroule autour de la circonférence la plus grande du tambour ;
contrebalancé à 140 kilogs, manœuvré par un homme.
Pont
frise sur le même tambour
cubilots, à la main sur tambour.
Et maintenant le changement total.
Pour ceux qui n’ont pas vu la pièce, il s’agit, comme vous pouvez le deviner d’un décor de studio de cinéma. Dans ce studio, le producteur et le scénariste racontent à un acteur une histoire qu’ils ont l’intention de tourner et le récit est interrompu par le changement de décor dans lequel l’action se joue en réalité. Cette action se passe sur une frégate vers 1716 ; c’est le deuxième tableau de la pièce. Au troisième tableau, il y a un nouveau changement qui rétablit le décor précédent, celui du deuxième tableau (au studio) où le scénariste finira son récit et conclura l’engagementXI [f. 15] des acteurs destinés à ce film.
Louis Jouvet.
Description : 1 tapuscrit
Collation : 15 feuillets dactylographiés
Cotes : LJ-D-67 (7), f. 1-15 (tapuscrit complet, sans inscriptions manuscrites) ; LJ-D-14 (4), f. 1-2, 4-15, doc. 14-27 (autre exemplaire du tapuscrit, incomplet, avec corrections et ajouts manuscrits généralement signalés dans les notes philologiques)
Notes philologiques :
I « Je suis très heureux… m’interrogent. » : barré (doc. 14).
II « ce » : barré (doc. 14).
III « des machines » : souligné (doc. 16).
IV « Le sentiment du dramatique ‹vient› dans les machines ‹il en est des dramatiques› » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 16).
V « et dramatiques » : ajout manuscrit après « traditionnelles » (doc. 16).
VI « : » : ajout manuscrit en remplacement de « . » (doc. 18).
VII « C’est la méchanée… le théologéion. » : afin de faciliter la lecture, le texte est retranscrit sans le retour à la ligne qui précède « C’est la méchanée » et avec un retrait après le retour à la ligne qui précède « un chariot ».
VIII « plancher » : suivi d’un point d’interrogation manuscrit et accompagné d’un ajout manuscrit en marge droite : « Il est en ‹plus vrai que› dispositif primitif (Epidaure – Delphes) » (doc. 18).
IX « en triangle » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 18).
X « une » entouré et « trappe » souligné, accompagné d’un ajout manuscrit en marge gauche : « faux / ‹même› pour les héros et trapillons et chaque plan comporte un nombre de trappes qui dépend de l’espacement des poutrelles et de la longueur du plan » (doc. 22).
XI « Les machinistes vont maintenant… conclura l’engagement » : barré (doc. 25-26).
2. Louis Jouvet, Notes préparatoires pour la préface au traité de Sabbattini (env. 1941)
Le texte de Jouvet qui introduit Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre est intitulé « Découverte de Sabbattini » et est qualifié de « préface[20] ». La correspondance du comédien avec son éditeur permet de constater qu’au mois d’août 1941, Jouvet avait envisagé de préparer une introduction faite d’une préface suivie de confidences au lecteur (voir ci-dessous, complément 3, lettres 8 et 10). Le texte qu’il envoie à son éditeur garde la trace de cette bipartition ; on trouve en effet au milieu de la préface une partie qui s’ouvre ainsi : « Ce n’est pas dans les limites d’une préface qu’on peut parler de Sabbattini ou présenter ce livre au public. Il faut se borner aux affirmations et aux confidences[21] ».
Les notes préparatoires à la préface éditées ci-dessous contiennent une ébauche de plan et des développements qui sont relativement indépendants de ceux que l’on trouve dans la causerie de 1938 (voir ci-dessus, complément 1) et qui annoncent une partie de ceux de la préface, en particulier de sa deuxième partie. Ces notes permettent de découvrir quelles ont été les intentions de Jouvet (« Expliquer… », « Dire comment… », « Parler de… », « Raconter… »). Elles paraissent plus nuancées que le texte de la préface dans la mesure où le traité de Sabbattini y rejoint d’autres documents auxquels des vertus similaires sont attribuées. Elles introduisent enfin des perspectives, notamment religieuses, que Jouvet a finalement préféré ne pas expliciter.
Ces notes semblent également annoncer des écrits de Jouvet publiés après sa mort. Ce n’est qu’en 2022, avec la publication du deuxième tome de L’Art du théâtre, que paraît le premier ouvrage dont Jouvet est l’auteur principal et où le nom de Sabbattini apparaît[22]. Les éditeurs de cette publication se fondent sur un corpus plus large que ceux qui les ont précédés et leur publication permet des rapprochements d’intérêt. Ainsi, pour peu que l’on ignore les différences qui semblent en partie dues à des choix éditoriaux[23], les pages 134 à 143 de Témoignages sur le théâtre (1952) correspondent aux pages 68 à 81 de L’Art du théâtre[24]. Au contraire de la version de 1952, celle qui est parue en 2022 contient trois occurrences du nom de Sabbattini ainsi que des propositions qui, en raison de leur proximité avec les notes préparatoires éditées ci-dessous, laissent penser que la partie de Témoignages sur le théâtre où Jouvet fait l’éloge de la machinerie est une reprise de notes rédigées au moment de préparer la préface, en 1941[25]. Les textes sur la machinerie parus après 1942 pourraient ainsi faire partie des quatre cinquièmes du travail réalisé par Jouvet et non retenu pour son introduction (voir ci-dessous, complément 3, lettre 14). Il se pourrait en particulier que l’essentiel des écrits de Jouvet consacrés à Sabbattini aient été ébauchés en 1941.
[f. 1]
Que faut-il lire pour apprendre la mise en scène ? pour comprendre le théâtre ? Par quel « biais » peut-on entrer dans cette profession qui offre tant d’aspects, présente tant de compartiments ?
Si je pense à mon expérience personnelle, je répondrai que c’est par la machinerie qu’on peut le mieux apprendre le théâtre, et je puis dire que j’ai commencé, au théâtre, en étant d’abord machiniste, en m’initiant à la machinerie.
Expliquer la différence qu’il y a entre l’acteur et le machiniste.
Dire ce qu’est le théâtre pour un machiniste. C’est le machiniste qui a le sentiment le plus pur, le plus désintéressé. Ce désintéressement, cette pureté, sont peut-être un des caractères du sentiment dramatique.
Toute ma vie, j’ai souhaité faire un éloge du machiniste. Mais ce livre, pour ceux qui le liront et le comprendront, vaudra certainement mieux que toutes les louanges que j’aurais pu décerner aux machinistes.
Dire comment tout l’art dramatique, toute l’expression théâtrale, procèdent non pas de la machinerie, mais de cet espace dramatique, de ce lieu qui appartiennent au machiniste, de cette optique théâtrale, de tout ce dont il est le premier serviteur et le premier magicien.
Le métier de machiniste est un artisanat, c’est-à-dire un métier fait de tradition et d’amour. [f. 2]
Sabattini est le plus réussi, le plus parfait de tous ces artisans.
Pour faire du théâtre, il me semble qu’il faut d’abord être machiniste : le sens du décor, de la peinture, de l’éclairage, vient naturellement, procède naturellement de la connaissance de cet espace dramatique où vit le machiniste.
Une fois qu’il a acquis ce sens, qu’on a senti ce sentiment dramatique du lieu et de son agencement, tout s’éclaire : on comprend les époques précédentes du théâtre par une imagination sensible qui rappelle celle qui animait Cuvier lorsque, devant un fragment de vertèbre ou de fémur, il reconstruisait l’animal préhistorique[26].
Parler de la tradition – voir comment on peut l’expliquer[27] – en donner une vraie définition.
Raconter mon apprentissage de la machinerie, et comment de la machinerie, j’ai acquis le sens du théâtre en tant qu’acteur, en tant que peintre, en tant que décorateur, qu’éclairagiste, que costumier, que metteur en scène. Comment souvent même le sens d’une pièce m’est venu par le sentiment du lieu dramatique et de son utilisation.
Plus que l’acteur, le machiniste est le vrai servant de l’art dramatique, le prêtre.
Pourquoi serait-on machiniste ?
La vocation de machiniste est du même ordre que la vocation d’acteur. Elle a les mêmes incertitudes, la même façon de se [f. 3] tromper et ne s’acquiert vraiment qu’au contact avec le lieu.______
Ce qu’il faut dire, ce qu’il faut s’avouer, ce qu’il faut constater, c’est qu’au fond on ne peut rien dire ou écrire sur le théâtre, sur cet art qui estI fait de faux-semblants, d’apparences, etII où tout est secret et mystère.
Raconter ce que m’a dit le normalien qui me conseillait de lire Aristote[28], « La Pratique du Théâtre » de d’Aubignac, Hegel, Lessing.
On ne peut rien dire sur le théâtre. Expliquer pourquoi. En dehors de cette raison essentielle que je viens de donner, que tout repose sur une illusionIII, que tout est fait pour cette illusion dans un consentement unanime, on ne peut rien expliquer, parce qu’il y a trop de différences entre les époques : différences d’édifices, de façons de jouer, différences dans les accessoires, dans les costumes, dans tous les procédés employés, différences dans les textes ; différences dans la construction scénique et dans la construction dramatique, et dans l’exécution scénique, à cause de ce secretIV.
Ce secretV que Sabattini nous montre comme constituantVI l’art du théâtreVII : écriture, exécution, aménagement scénique, inventions picturales et luminaires, de cetVIII art en partie double où il faut définir à la fois plusieurs éléments provocateurs qui se conjuguentIX : machiniste, auteur, acteur, etX cet élément provoqué qu’est le public – tous les éléments dont le caractère, l’esprit, changent à chaque époque, comme la mode. [f. 4]
Il y a toute une variété de systèmes d’ordre architectural, de façons de jouer, de façons d’écrire, de façons de s’émouvoir ou de s’amuser ; mais pas une époque n’a laissé de traces autres que quelques vestiges d’architecture et des livres imprimés.
On ne peut rien dire parce que, dans ce métier de théâtre, tout est dans l’esprit. C’est une philosophie de l’humain qu’il faudrait faire. Le théâtre relève de la métaphysique à l’exclusion de tout système de morale, et le mot qui traduit le mieux le sens de la cérémonie théâtrale avec ses participants, est celui de religionXI.
Il n’y a pour se documenter sur le théâtre, que des livres de gravure, des photographies, des documents rassemblés par des amateurs en général et non par des professionnels. La plupart des gens qui ont écrit sur le théâtre ne faisaient pas partie de la profession. Ce sont d’anciens capitaines du génie en retraite, des colonels d’artillerie[29], des savants, des philosophes, qui n’avaient certes pas l’habitude des coulisses. Certains ont laissé des livres de psychologie édités chez Alcan[30].
A part les dessins de Vitruve[31], ceux de Serlio, de Palladio[32], à part l’admirable recueil de Laurent et Mahelot, chefs machinistes de l’Hôtel de Bourgogne qui ont laissé un inventaire des décors de leur théâtre[33] – document qui est pour moi l’un des plus émouvants et des plus évocateurs – à part le « Paradoxe de Diderot[34] » (qu’on prend beaucoup trop pour une explication définitive et globaleXII du jeu, de l’exécution scénique, de la façon de jouer de l’acteur – et qu’il faut plutôt entendre comme une explication [f. 5] d’époque, dans cette évolution de l’acteur qui va des Grecs à nos jours – car Diderot n’a en somme décrit qu’un type d’acteur) – à part peut-être aussi le « Wilhelm Meister » de Goethe[35] où il y a des accents et des résonnances étonnantes pour un homme de théâtre, à part le livre de Garnier qui défend sa construction de l’Opéra[36], à part l’aimable et candide recueil de Moynet qui parle de la machinerie en l’intitulant « Trucs de Théâtre[37]« , il n’y a rien –
pas un livre, sauf celui de Sabattini.
Le livre de Sabattini, ce ne sont que des recettes, des procédés, des tours de main, une façon de faire. Il est écrit dans une langue merveilleuse, dont la suavité – et la perfection de pensée – me donne autant de plaisir que « l’Introduction à la vie dévote » de Saint-François de Sales. Sabattini a le même accent. C’est un écho de la morale religieuse dans la religion du théâtre.
– Indiquer comment j’ai fait sa découverte et le quiproquo qu’il y a entre le titre de d’Aubignac « Pratique du Théâtre[38]« ).
Lu, feuilleté par quelqu’un qui est étranger au théâtre, le livre de Sabattini est un recueil de science amusante qui appelle le sourire, et dont la distraction n’est pas plus haute que celle de « La Science amusante » de Tom Tit (voir note 12) ou la physique pour enfants.
C’est toujours la même imagination qu’on a du théâtre… Ainsi lorsque le public s’imagine la mer une grande toile verte disposée sur la scène, avec des figurants qui s’agitent sous cette toile à grand renfort de coups de pied – la pluie qui se fait avec un carton à chapeau et des petits pois – toute cette dérision que le public le premier porte en lui lorsqu’il franchit les portes du théâtre. [f. 6]
C’est là justement, dans ce mélange de dérision et de respect, que se trouve ce qu’il y a d’impénétrable et d’inexplicable dans le théâtre.
Comment le public qui a payé sa place, qui vient dans un désir d’évasion, et comment l’acteur prennent-ils si aisément prétexte du moindre manquement, de la moindre rupture dans cette illusion, pour se laisser aller à une moquerie, d’ailleurs toujours toute prête à éclaterXIII.
Tout ce qu’on dit sur le théâtre est non seulement insuffisant, mais paraît toujours dérisoire au lecteur ; sinon dérisoire au moins inexplicable ou même impudique.
Les histoires de théâtre qu’on raconte (en citer quelques-unes) sont humiliantes pour celui qui les raconte et pour celui à qui elles s’adressent. Parce que les choses n’y sont vues que dans le désaccord qu’il y a entre l’apparence voulue, la vraisemblance recherchée (et qui semblent dérisoires) par rapport au but à atteindre.
Mais il y a des histoires – et j’en sais – qui, lorsqu’elles sont dites par des hommes qui ont le sens dramatique, le sens de cette recherche du sentiment – ne sont pas dérisoires. Au contraire, elles laissent l’esprit dans une méditation chaude, féconde, et approchent de ce secret, du mystère du théâtre.
(Raconter l’Histoire de Tchélit. sur les anges – et celle où il dit : « On ne meurt pas en bleu »). Raconter l’histoire de Valéry Larbaud quand il m’a demandé en quelle saison se passe « Comme il vous plaira[39]« ). [f. 7]
De même qu’il y a histoires et histoires, il y a recettes et recettes. Les recettes de Sabattini, dans la naïveté où elles sont dites, [1 mot barré ill.] sont cependant le formulaire, l’alphabet, le catéchisme du théâtre.______
Parler du sentiment dramatique par le lieu dramatique.
C’est le lieu dramatique qui donne du théâtre la connaissance la plus certaineXIV, et le machiniste est l’homme qui, sans génie, est incapable de concevoir un décor, mais qui est capable (et qui sent en faisant les corrections nécessaires à ce décor), de concert avec le décorateur, ou avec le peintre et l’éclairagiste, d’exécuter ce décor, de l’aménager. Quelquefois il ne collabore pas bien parce qu’il n’aime la manière du peintre, ou du décorateurXV. Le machiniste est l’homme qui connaît le mieux le lieu dramatique.
Parler des évolutions, des époques théâtrales, et montrer comment cette évolution du théâtre est une évolution continuelle du même principe dramatique, de ce rapport instable qui est entre le faux-semblant et le faire croire du décor, l’imitation que fait l’acteur et le sentiment vrai qui en est le résultat. Ce produit authentiqueXVI est le sentiment dramatique.
Montrer que c’est une perpétuelle évolution, que le lieu dramatique change. Chez les Grecs et les Romains, au Moyen-Age, à l’époque de Shakespeare, à l’époque de Molière, à l’époque de la Commedia dell’Arte, à l’époque des Italiens, et même de nos jours, le lieu dramatique s’aménage différemment, mais le [f. 8] sentiment dramatique est toujours le mêmeXVII.
Le lieu dramatique a toujours procuré, soit à ceux qui l’ont aménagé, [1 mot barré ill.] qui y ont servi, soit à ceux qui viennent contempler ce qui s’y exécute, le public, soit les exécutantsXVIII eux-mêmes, dans la pitié ou dans la terreur, dans le rire ou dans la distraction spirituelle à un degré plus ou moins haut dans l’épanouissement de la rate, ou dans la mélancolie, le même effet humain, suivant les époques, suivant les publics et suivant les auteurs.______
Montrer en exemple :
Vitruve a fait un livre sur l’architecture et en particulier sur l’architecture théâtrale. Ce livre qu’il nous a laissé sans illustration, a été illustré 72 fois, par 72 illustrateurs, dans les 72 ou 75 éditions qui en ont été faites (dans d’autres notes où il est question de Sabbattini, Jouvet évoque « les éditions de Vitruve, avec les illustrations que chaque époque en a faites et qui diffèrent si complètement les unes des autres » (Louis Jouvet, « La scène, manifestation élémentaire du dramatique », art. cit., p. 69)). Le même dessin, interprété par des illustrateurs différents, n’a pas la même pensée, n’a pas le même sentimentXIX.
Citer les essais d’explication du théâtre qui ont été faits. Ce ne sont toujours que des explications fragmentaires, bonnes pour une époque ; que ce soient les théories de Craig, les théories d’Appia, celles de Stanislavski, ou celle de Diderot – (Quoique cette dernière soit plus ample ; elle signale d’une façon marquante, chez un homme d’une culture et d’une hauteur de vue étonnantes, un homme qui aimait le théâtre, mais était incapable d’en faire, une connaissance parfaite de l’exécution dramatique à son époque. Diderot, dans son « Paradoxe » a vu le premier au 18ème siècle, l’évolution et la transformation de l’acteur, et son dédoublement, tout ce qui annonce déjà à notre époque [f. 9] la prédominance chez l’acteur de l’intelligence, la tendance à un dédoublement conscient, dont le comédien n’avait pas conscience autrefois. On pourrait en donner pour preuve que le « Paradoxe » de Diderot n’a été découvert que fort tard, au 19ème siècle ; il a soulevé alors, chez les acteurs romantiques, une indignation générale. Aujourd’hui, les enquêtes qui sont faites auprès des comédiens à ce sujet les trouvent parfaitement d’accord sur ce dédoublement que leurs aînés n’admettaient pas.)
De tous les éléments fragmentaires qui nous restent, le livre de Sabattini est le plus important avec le Laurent et Mahelot. (dans Sabattini : indication du procédé technique). Nous ne saurions rien des Grecs et des Romains s’il n’y avait Vitruve, mais Sabattini, lui, nous donne des recettes. Et ces recettes viennent en droite ligne des Grecs et des Romains. Elles sont encore valables aujourd’hui.
Certes, on ne peut rien dire que de fragmentaire sur le Théâtre, mais les fragments de Sabattini ont une importance que n’ont pas les autres.
Sabattini nous parle de manière concrète.
En même temps, il y a dans Sabattini l’esprit du théâtre. C’est ce qu’il faut voir dans ses recettes, sinon elles ne seraient qu’une suite d’articles d’Encyclopédie, comme ceux de l’Encyclopédie Roret, qui fleurit au 19ème siècle en prétendant continuer la tradition l’œuvre des grands Encyclopédistes.
Si j’en avais le loisir, mon ambition serait de prendre Sabattini et de le proposer comme point de départ d’une somme théâtrale et d’un ensemble de connaissances théâtrales [f. 10]
Sabattini serait le commencement d’une science théâtraleXX qui n’a jamais été formulée et qui ne peut l’être, mais qui permettrait à ceux qui veulent s’intéresser auXXI théâtre, à l’heure actuelle, de trouver un manuel, un supplément à SabattiniXXII, qui les aiderait à s’orienter dans la connaissance du théâtre d’avant Sabattini, et du théâtre après luiXXIII.
Je m’aperçois qu’il me faut avoir pratiqué pendant trente ans mon métier pour pouvoir lire Sabattini. Et si j’en avais le loisir, je serais heureux, pour répondre à cette question qu’on me pose souvent : « Que faut-il lire pour apprendre le théâtre », de dire : « Lisez Sabattini » et de pouvoir ajouter à celui-ciXXIV une série de renseignements, une liste des procédés qui ont précédé Sabattini.
Par Sabattini je sais beaucoup plus que par tous les archéologues qui ont essayé d’expliquer le dispositif grec ou romain ou shakespearien, ce qu’était le théâtre de ces époques. Il est vain de faire sur ces dispositifs des débats et des disputes pour savoir les altérations qui ont été faites dans les édifices primitifs, grâceXXV à la découverte d’un mur de soutènement ou au déplacement d’une pierre. Ce sont des contestations oiseuses et inutiles, qu’il s’agisse de telle ou telle partie de l’édifice ou de la date de son utilisation. Dégager tout simplement le sens de cet usage, de cette pratique, comme Sabattini l’a fait puisqu’il n’a écrit qu’en partant de son sentiment, d’un sentiment professionnel, du besoin qu’il avait de s’exprimer, lui aussi, comme un poète, c’est-à-dire dramatiquement.______
Description : 1 tapuscrit
Collation : 10 feuillets dactylographiés (doc. 1-7 et doc 15-24)
Cotes : ; LJ-D-69 (14), f. 1-10, doc. 15-24 (tapuscrit sans annotations, sinon quelques exceptions dont des soulignements au crayon non signalés) ; LJ-D-69 (14), f. 3-5, 7-10, doc. 1-7 (autre exemplaire du tapuscrit, incomplet, avec corrections et ajouts manuscrits généralement signalés en notes)
Notes philologiques :
I « qui est » : barré (doc. 7).
II « et » : ajout manuscrit après « et » (doc. 7).
III « Simulacres de tous / auteur / acteur / spectateur » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 7).
IV « du » : ajout manuscrit en remplacement de « de ce » et ajout manuscrit de « du théâtre » après « secret » (doc. 7).
V « Ce secret » : ajout manuscrit en remplacement de « Ces secrets » (doc. 7).
VI « faire sentir dans » : ajout manuscrit en remplacement de « montre comme constituant » (doc. 7).
VII « l’art de représenter » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 7).
VIII « secrets d’un » : ajout manuscrit en remplacement de « de cet » (doc. 7).
IX « leur conjugaison » : ajout manuscrit en remplacement de « qui se conjuguent » (doc. 7).
X « avec » : ajout manuscrit en remplacement de « et » (doc. 7).
XI « C’est une philosophie… religion » : barré (doc. 6).
XII « universelle » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 6).
XIII « ? » : ajout manuscrit (doc. 20).
XIV « Vicence » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 4).
XV « Quelquefois… décorateur » : barré (doc. 4).
XVI « authentique » : placé entre parenthèses et accompagné de l’ajout manuscrit supralinéaire : « de ce rapport – son effet équilibre, pèse ; voulu après ‹sa› recherche », ainsi que de l’ajout manuscrit en marge gauche : « La convention » (doc. 4).
XVII « Rapport entre l’illusion et la [1 mot ill.] des participants » : ajout manuscrit en fin de phrase (doc. 1).
XVIII « au » et « aux exécutants » : ajouts manuscrits en remplacement de « le » et « les exécutants » (doc. 3).
XIX « dramatique, pas le même style, pas le même effet. » : ajout manuscrit après « sentiment » (doc. 3).
XX « non pas du théâtre mais d’une imitation par la partie la plus concrète et la plus pure ‹autour› du théâtre » : ajout manuscrit en remplacement de « théâtrale » (doc. 1).
XXI « s’instruire sur le » : ajout manuscrit en remplacement de « s’intéresser au » (doc. 1).
XXII « supplément » : placé entre guillemets ; « à Sabattini » : barré (doc. 1).
XXIII « – A partir de Sabattini » : ajout manuscrit après « lui. » (doc. 1).
XXIV « ‹celui-ci› » : ajout manuscrit en remplacement de « celui-ci » (doc. 1).
XXV « p. ex. » : ajout manuscrit supralinéaire après « grâce » (doc. 1).
3. Correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler (1941-1942)
La correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler conservée dans les fonds parisiens et neuchâtelois est directement liée à la maison d’édition Ides et Calendes et porte principalement sur l’édition de la traduction française du traité de Sabbattini. La sélection éditée ci-dessous[40] commence le 16 janvier 1941 avec une prise de contact par Uhler qui cherche à atteindre Jean Giraudoux et se termine le 23 mars 1942, au moment où Uhler annonce à Jouvet que l’ouvrage est paru et qu’il a remis à Giraudoux, de passage en Suisse, le premier exemplaire sur japon.
Frédéric Uhler (1908-1982), dit Fred Uhler, avocat à Neuchâtel, décide de fonder sa maison d’édition à la suite d’une conférence de Henry de Montherlant prononcée en décembre 1940 à Lyon[41]. Dès janvier 1941, Uhler sollicite des auteurs français reconnus parmi lesquels figurent André Gide, Jean Giono et Jean Giraudoux afin de leur demander une contribution[42]. Dans la copie de la lettre adressée à Giraudoux (lettre 2), Uhler aborde lucidement et ouvertement une partie des raisons identifiées par Simon Roth et François Vallotton qui sont à l’origine de l’essor des maisons d’édition romandes à cette époque : la volonté de « trouver un remède au désarroi » de la guerre, la possibilité de « déjou[er] la censure » et la perspective, pour les auteurs édités, d’un « apport […] financier » sans renoncer à ce que « les maisons d’éditions françaises […] repren[nent] en main leurs écrivains » lorsqu’elles pourront à nouveau travailler normalement[43]. Les lettres de Uhler à Jouvet ne portent pas sur le contenu du texte à éditer, mais sur des questions qui intéressent le bibliophile. Elles témoignent ainsi, de la part de Uhler et comme c’est le cas d’autres éditeurs suisses s’étant lancés à cette époque, d’un « attachement artisanal au bel ouvrage[44] ». C’est afin d’obtenir un appui auprès de Giraudoux que Uhler contacte Jouvet – le comédien n’était vraisemblablement pas considéré comme un auteur[45] –, qui vient d’arriver en Suisse.
Louis Jouvet (1887-1951) quitte Paris le 2 janvier 1941[46] et n’y reviendra qu’en 1945. Les circonstances qui ont conduit sa troupe à effectuer, en 1941, des prises pour le film inachevé L’École des femmes de Max Ophüls, deux tournées en Suisse, une tournée en France libre et une tournée en Amérique latine sont bien documentées et ont notamment été mises en lumière grâce aux travaux de Denis Rolland[47]. Les publications portant sur cette période ne fournissent toutefois que des informations ponctuelles sur la genèse de l’édition française du traité de Sabbattini[48]. La correspondance entre Jouvet et son éditeur laisse penser que l’initiative qui consiste à éditer une traduction du traité de Sabbattini vient du comédien. Elle témoigne également de l’attachement de Jouvet à ce projet, de ses difficultés à écrire une introduction à cette publication initialement prévue pour le 1er novembre 1941 et de son désir d’accompagner le traité d’un appareil critique ou d’un autre ouvrage qui serait plus complet.
L’idée d’éditer une traduction française du traité italien semble être antérieure à 1941. Des documents issus des archives de Jouvet permettent d’en savoir plus sur la période qui a précédé la rencontre entre le comédien et son éditeur. Dans une lettre de 1942 à Fred Uhler, Claude Guinot écrit que c’est Odette Lieutier, une libraire parisienne spécialisée dans les publications théâtrales, qui aurait communiqué à Jouvet l’édition allemande du traité de Sabbattini[49]. Il est possible que cette communication ait eu lieu quelques semaines avant le 2 juin 1939, date à laquelle Marthe Herlin[50] transmet un billet à Jouvet indiquant que Mademoiselle Canavaggia[51] peut fournir une traduction du traité de Sabbattini et qu’elle en demande 5000 francs en raison de la présence de termes techniques qui exigent des recherches spécifiques. Canavaggia demande également si Jouvet souhaitera publier la traduction[52]. Le 26 novembre 1939, Renée Canavaggia, sœur de Marie Canavaggia, envoie une traduction littérale et rapide des informations biographiques fournies par l’historien du théâtre Willi Flemming dans l’édition allemande[53]. Deux jours plus tard, Herlin la remercie et explique que Jouvet a l’occasion de faire faire des recherches sur Sabbattini en Italie[54]. Les modalités de ces recherches restent à déterminer et ont possiblement été contraintes par la déclaration de guerre de la France[55]. Elles pourraient s’inscrire au sein d’un projet plus vaste de bibliographie et d’étude sur les lieux dramatiques entamé au plus tard dès la fin de 1938 et auquel participent notamment Jean Flory, Elizabeth Bonville et Jacqueline Gamond[56]. Il se pourrait que Jouvet ait un tel projet en tête lorsque, dans sa lettre du 20 août 1941 (lettre 10), il propose à son éditeur de faire une suite au traité de Sabbattini. Dans cette même lettre, Jouvet explique que sa préface n’est pas prête et qu’il aurait espéré en envoyer une version qu’il corrigerait sur la « première épreuve ». Jouvet ne retournera pas à Paris avant 1945[57]. La rapide relecture des épreuves qu’il évoque dans sa préface (« J’avais relu rapidement avec Mlle Canavaggia les épreuves à Paris[58] ») semble ainsi dater de 1940, ce qui laisse penser, si l’on considère la rapidité avec laquelle Uhler reçoit la traduction, qu’au moment où il entre en contact avec Jouvet, celui-ci avait une traduction prête à être soumise à un éditeur.
Fred Uhler à Louis Jouvet (16.01.1941)
[En-tête : Fred Uhler, avocat à Neuchâtel]
[Neuchâtel, leI] 16 janvier 1941
Monsieur Louis Jouvet
Hôtel des Bergues
Genève
——
Monsieur,
Jean Kiehl[59] m’a transmis l’adresse de M. Jean Giraudoux, adresse que vous avez eu l’extrême amabilité de lui remettre à mon intention. Je tiens à vous en exprimer ici tous mes remerciements.
J’ignore si M. Kiehl ou M. Mario Bertschy[60] vous ont entretenu de mon projet d’éditer en Suisse quelques auteurs français. Quoi qu’il en soit, je prends la liberté, que je vous prie de me pardonner, de vous soumettre la copie de ma lettre à M. Jean Giraudoux. Si vous trouvez à mon idée quelque intérêt et si vous en avez le loisir au milieu de vos travaux, je vous serais reconnaissant d’appuyer par un mot ma demande auprès de l’auteur d’Ondine[61].
Mon intention n’est pas de m’arrêter à la publication d’une seule œuvre, mais de faire paraître successivement en édition originale les ouvrages d’autres écrivains français. Une indication, une remarque ou un conseil venant de vous pourrait me faciliter grandement la tâche. Pour rien au monde, je voudrais être importun et je me garderai, sans votre consentement, de vous priver d’un temps précieux. Toutefois, si vous l’estimez utile, je vous rencontrerais à Genève la semaine prochaine, y ayant affaire. Je puis m’arranger à faire coïncider la date de mon voyage avec celle que vous voudriez bien me fixer, le mercredi excepté. M. Mario Bertschy m’a laissé entendre qu’il n’y aurait pas impossibilité que vous me fassiez l’honneur d’accepter une invitation à déjeûner. [f. 2]
Vous voudrez bien, Monsieur, agréer, avec mes excuses, l’expression de ma reconnaissance et l’expression de mes sentiments respectueux.
Fred UhlerII
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 2 feuillets
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 13-14
Notes philologiques :
I « Neuchâtel, le » : inscription préimprimée.
II « Fred Uhler » : signature autographe.
Fred Uhler à Jean Giraudoux (16.01.1941)
16 janvier 1941
Monsieur Jean Giraudoux
Hôtel du Parc
Vichy
—–
Monsieur,
Si mon pays a échappé jusqu’à ce jour à la catastrophe de la guerre, il en subit cependant les inévitables contre-coups. Nous nous ressentons tout particulièrement de l’absence d’œuvres nouvelles d’écrivains français. Aucun livre n’entre chez nous de France occupée ; quant aux ouvrages envoyés de France libre, ils n’ont d’autre intérêt que politique. La Suisse Romande, avec les seuls Ramuz et Denis de Rougemont, ne peut donner à ses habitants affamés de littérature française les nourritures spirituelles dont ils ont besoin. Nous sommes nombreux qui souffrons de cette situation ; tout en espérant, dans notre amour pour la France, que cet état de choses soit passager, nous désirons dès maintenant y porter remède.
Fort de l’appui de quelques amis de la France, assuré de l’aide d’un imprimeur de goût et de bonne volonté, j’ai décidé de faire paraître en Suisse des œuvres inédites d’auteurs français. Mon intention est de suppléer – dans la mesure de mes forces – à la carence momentanée des éditeurs de votre pays, de donner à ses écrivains la possibilité de se faire imprimer en dehors d’une censure trop rigoureuse, de maintenir, enfin, chez le lecteur de langue française, le goût et le désir de l’œuvre nouvelle.
Pour réussir, je dois nécessairement tenir compte des circonstances actuelles. La Suisse romande ne peut absorber à elle seule un gros tirage ; je ne veux pas empêcher d’autre part un auteur français de publier ses œuvres en France, le jour où les éditeurs travailleront de nouveau normalement. Il faudra arrêter à cinq cents ou à mille, suivant les souscriptions, le nombre d’exemplaires de chaque œuvre. Ils constitueront son « édition originale ». Imprimés en beaux caractères, sur du papier choisi (vélin, hollande et quelques exemplaires sur chine ou japon), avec lettrines, titres, en-têtes en couleur, [f. 2] numérotés, ils formeront une édition de bibliothèque. Celle-ci épuisée – et je suis persuadé qu’elle le sera rapidement – l’auteur reprendra son entière liberté et pourra faire paraître son livre, en édition courante ou de luxe, chez tout autre éditeur de France.
Vous ayant exposé en quelques mots mes projets, je prends l’audace de vous demander s’ils auront eu l’honneur de trouver auprès de vous un écho de bienveillant encouragement. Pour les mettre à exécution, j’ai besoin de manuscrits et j’ai songé tout naturellement à l’auteur d’Ondine et de Choix des Elues[62]. Je me déclare prêt à assumer les risques de publication en Suisse, dans les conditions que je vous ai présentées, d’une pièce de théâtre ou d’un roman, écrits par vous. Je tiens bien à préciser qu’à titre personnel, je ne veux pas faire une affaire, au sens commercial du mot. Par contre, j’entends que vous retiriez l’impression de l’une de vos œuvres, un bénéfice qui pourra varier entre trois et cinq mille francs suisses, suivant le tirage et le nombre de livres vendus. Au change du jour, cette somme représente un montant de trente à soixante mille francs français, qui vous seront versés, soit en France, soit sur un compte bloqué dans une banque suisse, à votre guise, dès que le nombre d’exemplaires vendus aura atteint cette valeur.
J’ignore si vous êtes lié par contrat à une maison d’édition pour l’ensemble de vos œuvres. Si vous acceptez ma proposition, il faudra mettre au point nos rapports avec elle. Je ne crois pas néanmoins qu’elle puisse faire obstruction à un projet qui tout en sauvegardant ses droits en France et dans les autres pays, vous assurera la parution d’une œuvre dont la vente sera limitée dans le temps, par un tirage restreint, et dans l’espace, par les frontières de la Confédération suisse.
Si ma lettre peut entraîner chez vous une décision favorable, je serai trop heureux, dans une correspondance à venir, de préciser mon projet. Si vous l’estimez utile, je suis disposé à vous rencontrer en France non occupée ; je songe [f. 3] par exemple à la ville de Lyon.
En vous priant de pardonner l’audace que j’ai prise de vous écrire, et dans l’espoir qu’elle n’aura pas été vaine, j’ai l’honneur, Monsieur, de vous présenter l’assurance de mes sentiments d’admiration et de respect.
(signé) Fred Uhler.
P.S. Votre adresse m’a été communiquée par Monsieur Louis Jouvet grâce à l’intervention de ses collaborateurs suisses.
Description : 1 copie de lettre dactylographiée
Collation : 3 feuillets
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 15-17
Louis Jouvet à Fred Uhler (Genève, 27.01.1941)
AU GRAND THEATRE DE GENEVE
27 Janvier 1941
Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre du 16 Janvier et m’excuse de n’y avoir pas répondu plus tôt. Nous avons été un peu bousculés depuis notre arrivée en Suisse[63].
Je ne manquerai pas, à l’occasion de la prochaine lettre que j’enverrai à M. Giraudoux de lui parler de votre projet. J’espère que votre idée lui plaira, car c’est une tentative très intéressante, nécessaire aussi, dans l’état actuel des relations entre la France et la Suisse, et certainement que les lecteurs d’ici vous sauront gré de cette initiative. Les écrivains français, isolés pour le moment de leur clientèle suisse, y trouveront le plus grand intérêt. Laissez-moi vous dire combien je souhaite que votre entreprise rencontre le succès.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur Fred. Uhler,
6 rue du Concert,
NEUCHATEL (Suisse)
Description : 1 lettre dactylographiée
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 12
Fred Uhler à Louis Jouvet (27.02.1941)
[En-tête : Fred Uhler, avocat à Neuchâtel]
[Neuchâtel, leI] 27 février 1941
Monsieur Louis Jouvet
p.a. Administration du Théâtre des Célestins
Lyon
—–
Cher Monsieur,
Mario Bertschy m’a envoyé aux Armées[64] les traductions de l’adresse de « L’Imprimeur au Lecteur » et de la lettre de Pietro dei Paoli au Sig. Pen. Collendiss[65]. Je les ai jointes immédiatement au texte principal du « Sabatini[66]« .
Pendant les heures de loisir que me laisse ma batterie, je songe à la forme que je désire donner à votre traduction. Je suis entré en contact avec un imprimeur zurichois[67] que j’irai voir lors de ma prochaine permission. Quand vous reviendrez en Suisse en avril prochain, je pourrai vous soumettre un projet entièrement élaboré et j’espère qu’à cette époque, votre accord me permettra de mettre immédiatement l’œuvre en chantier.
Votre tournée en Suisse a laissé aux amis du théâtre le souvenir d’un plaisir particulièrement délicieux. Nous avons tous hâte d’entendre et de voir « Électre[68]« . Je veux espérer que vous trouverez en France quelques jours de repos.
En vous remerciant encore de la confiance que vous avez mise en moi, je vous prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments dévoués et reconnaissants.
J.
Fred UhlerII
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 11
Notes philologiques :
I « Neuchâtel, le » : inscription préimprimée.
II « Fred Uhler » : signature autographe.
Louis Jouvet à Fred Uhler (Zurich, 30.04.1941)
[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]
Zurich, le 30 Avril 1941
Cher Fred Uhler,
J’ai été bien content de vous retrouver l’autre jour à Neuchâtel[69], je veux vous le dire par ce petit mot. Très content aussi de cet EubageI auquel vous avez pensé[70]. Votre amitié me touche infiniment. Ce premier et amoureux travail typographique que vous avez fait me plait beaucoup[71].
Je vous envoie ci-jointe la traduction du titre telle que l’a faite Mademoiselle Canavaggia « Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre[72]« .
Nous vous attendons à Lausanne, et je vous dis encore toute mon amitié.
celle aussi de Raymone[73].
de tout cœur
Louis JouvetII
Monsieur Fred Uhler,
Neuchâtel.
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 1 feuillet
Cote : FUHL-102-1.6. Une copie non signée, sans les ajouts autographes, est conservée à la BnF sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 10.
Notes philologiques :
I « E » de « Eubage » : ajout manuscrit en remplacement de « eubage ».
II « celle aussi… Jouvet » : ajout autographe.
Contrat d’édition entre Louis Jouvet et Fred Uhler (Lausanne et Neuchâtel, 12.05.1941)
Contrat d’édition
Entre :
Louis JOUVET, traducteur,
d’une part et
Fred UHLER, éditeur à Neuchâtel,
de seconde part
il est convenu :
Article premier.
Louis Jouvet confie à M. Fred Uhler l’édition de sa traduction de la « Pratica di fabricar scene e machine ne’teatri » de Nicolas Sabbattini.
L’ouvrage sera précédé d’une introduction que le traducteur fera parvenir à l’éditeur avant le 30 septembre 1941 au plus tard.
Article deuxième.
Fred Uhler s’engage à éditer à 1000 exemplaires au minimum la traduction de M. Louis Jouvet sous le titre : « De la Pratique pour fabriquer les scènes ».
L’impression se fera avec les caractères d’imprimerie et sur le papier dont échantillons ont été remis à M. Jouvet lors de son passage à Neuchâtel en avril 1941. L’ouvrage reproduira les figures de l’original italien.
Il sera tiré en outre quelques exemplaires sur papier de Hollande (au minimum soixante) et sur papier du Japon (au minimum vingt).
Article troisième.
Fred Uhler s’engage à faire paraître la traduction de Sabbattini précédée de l’introduction de M. Jouvet le 1er novembre 1941.
Article quatrième.
Les droits du traducteur sont déterminés comme suit :
mille deux cents francs suisses (Fr.1.200.-) versés à la date du présent contrat.
L. Jouvet donne quittance « à valoir » pour cette somme qui lui est acquise quel que soit le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur.
2) L’éditeur s’engage à verser à M. L. Jouvet, au lieu qu’il voudra bien indiquer, le huit pour cent (8%) du prix de vente fort de chaque exemplaire vendu sur la base de bordereaux semestriels établis par l’éditeur à partir du 1er mai 1942. Les paiements se feront en argent suisse ou en monnaie française au taux officiel de la Banque Nationale Suisse. La somme précitée de Fr.s. 1.200.- est à porter au crédit de l’éditeur qui n’effectuera pas un nouveau paiement que le jour où le 8% du prix fort des exemplaires vendus aura dépassé mille deux cents francs suisses (Fr.s.1.200.-).
3) M. Fred Uhler s’engage à porter le taux des droits de traduction de huit à dix pour cent si mille exemplaires de l’oeuvre ont été vendus dans l’espace de deux ans dès le 1er novembre 1941.
Article cinquième.
Louis Jouvet concède à M. Fred Uhler un droit exclusif d’édition tant du texte français du « Sabbattini » que de l’introduction pendant une durée de trois années à partir du 12 mai 1941. Un même privilège est accordé à l’éditeur pour toute traduction en langue étrangère des textes précités.
Le droit exclusif de l’éditeur est valable pour le monde entier.
Article sixième.
A partir du 12 mai 1944, M. Fred Uhler conserve une option sur les textes qu’il aura publiés. Cette option tombera si dans un délai de six mois, l’éditeur ne donne pas suite à une sommation du traducteur de procéder à une nouvelle édition.
Article septième.
Si l’édition prévue par le présent contrat est épuisée dans un délai de deux ans à partir du 1er novembre 1941, les parties conviennent de publier une édition courante de la « Pratica » de Nicolas Sabbattini, dont les conditions seront établies d’un commun accord.
Article huitième.
L’éditeur s’engage à déposer le stock des exemplaires à vendre dans les locaux occupés par les papeteries H. Messeiller à Neuchâtel, Saint Nicolas 11, où M. Jouvet pourra en tout temps faire procéder au contrôle des ventes.
L’éditeur tient à disposition les bordereaux de commandes des libraires qui permettront d’établir le prix de vente fort de l’ouvrage.
Article neuvième.
Tout conflit pouvant naître de l’interprétation ou de l’application du présent contrat sera soumis pour décision arbitrale à M. le Président du Tribunal Civil I de Neuchâtel.______
Ainsi fait en deux exemplaires originaux, dont l’un pour chaque partie, à Neuchâtel et Lausanne, le 12 mai 1941.
Fred UhlerI
lu et approuvé
Louis JouvetII
Description : 1 contrat dactylographié signé par Fred Uhler et par Louis Jouvet
Collation : 3 feuillets
Cote : FUHL-102-1.6. Un contrat est également conservé à la BnF sous la cote LJ-D-5 (1).
Notes philologiques :
I « Fred Uhler » : signature autographe.
II « lu et approuvé / Louis Jouvet » : mention et signature autographes.
Louis Jouvet à Fred Uhler (Lyon, 22.05.1941)
[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]
Lyon, le 22 Mai 1941
Mon cher Fred,
Arrivé ici – ainsi que Mario a dû vous le dire – j’ai appris avec surprise et un peu de tristesse aussi, que Giraudoux avait été obligé de partir à Paris[74] et que sans doute je ne le verrai pas avant mon départ. Mais il ne doit y rester qu’un mois environ, pour préparer un essai sur la Littérature française qu’il va publier chez Grasset[75]. Ne désespérez pas de sa collaboration[76]. Je vous conseille de lui écrire, ou, au besoin, de venir le voir.
Je vous écris aussi pour vous demander de ne pas oublier, dans le titre du Sabattini, de spécifier que la traduction est de Mesdemoiselles Marie et Renée Canavaggia avec une introduction de Louis Jouvet. J’aimerais que mon nom ne figurât pas en plus gros caractères que celui des deux traductrices et que le tout soit assez modeste pour laisser au nom de Sabattini toute sa gloire et son efficacité[77]. Je suis d’ailleurs tranquille sur le sens que vous avez de ces choses, mais j’aurais scrupule à ne pas vous le dire.
Laissez-moi encore vous remercier, mon cher Fred, du dévouement que vous témoignez à notre Sabattini et de votre gentillesse à mon égard.
Nous partons mardi[78]. J’ai déjà commencé à travailler un peu mon Introduction. Je vous l’enverrai aussitôt que je le pourrai, car je crains beaucoup les délais postaux.
Croyez à mes sentiments de vive et fidèle amitié.
Louis JouvetI
Monsieur Fred Uhler,
6 rue du Concert,
Neuchâtel (Suisse)
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 1 feuillet
Cote : FUHL-102-1.6. Une copie est conservée à la BnF sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 9.
Note philologique : I « Louis Jouvet » : signature autographe.
Louis Jouvet à Fred Uhler (entre São Paulo et Buenos Aires, 02.08.1941)
[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]
A bord de l’Argentina
2 Août 1941
Cher Fred Uhler,
Cette lettre est un avertissement à l’éditeur que vous êtes : Ma préface, que vous attendez, ne sera jamais assez belle pour mon goût et l’Avertissement au lecteur que j’avais la prétention de vouloir écrire, je suis incapable de le faire et je vais m’en tenir à des confidences personnelles. Il faudra que le lecteur ait lui-même l’esprit de découvrir, derrière les figures et les paroles que vous re-imprimezI, les vérités qu’elles contiennent.
Je suis cependant en train de l’écrire pour votre satisfaction et aussi pour la mienne, car il faut craindre que ceux qui liront « La Pratique pour fabriquer les scènes », s’ils ne sont avertis, ne prennent pas garde à l’importance de ce qui leur paraîtra d’abord de petites recettes ou trucs de théâtres risibles et démodés, surtout s’ils n’ont jamais fréquenté de scènes et s’ils ont eu l’imprudence ou la malchance de lire quelques-uns de ces articles, comme en publient aujourd’hui fréquemment les revues et les journaux sur les inventions nouvelles et les merveilles dont la science moderne a doté le théâtre.
J’aurais voulu faire un éloge du théâtre et de la machinerie, dire la passion de notre métier, parler du secret et du mystère du théâtre. Il est difficile d’être clair et simple dans ces matières, mais personne ne l’a jamais été, sauf Sabbattini. Il suffit peut-être, pour aujourd’hui, que je témoigne avoir trouvé tout cela dans son livre, et [f. 2] que je lui rende l’hommage qu’il mérite.
Je vous écris sur le bateau qui nous mène de Santos à Buenos-Aires. Nous venons de Sao-Paulo et de Rio[79]. La troupe est contente.
Il faudra faire tirer un exemplaire spécial pour chacune des personnes ci-dessous :
Monsieur Camille Demangeat, chef-machiniste du théâtre Louis Jouvet
Monsieur Léon Deguilloux, – did. –
Mademoiselle Renée Marthe Herlin, régisseur de la scène du théâtre Louis Jouvet
Mademoiselle Maria Canavaggia, traductrice de Sabbattini
Mademoiselle Renée Canavaggia, – id. –
Monsieur Christian Bérard
Monsieur Pavel Tchélitcheff[80].[81]
Sabbattini leur en eût fait l’hommage. Vous aviserez vous-même pour les autres exemplaires.
J’aimerais que cette pseudo-préface fût assez aimable pour aider au succès de votre édition. Croyez en tout cas que je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu éditer le Sabbattini. C’est ma récompense.
Au revoir. Mille amitiés au Bassin 12. De tout cœur vôtre,
Louis JouvetII
Et maintenant, je me mets aux Confidences au Lecteur.
Monsieur Fred Uhler,
Concert 6, Neuchâtel.
Ajouts allographes (possiblement de Fred Uhler, faits en vue de l’intégration de la lettre en tête de la préface) : une ligne verticale à gauche de la liste de noms indique probablement un retrait à ajouter, les phrases « Au revoir. Mille… cœur vôtre » ainsi que « Monsieur Fred Uhler… Neuchâtel. » sont barrées et la mention « facsimilé » se trouve à côté de la signature.
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 2 feuillets
Cote : FUHL-102-1.6. Un possible brouillon avec des différences mineures est conservé sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 7-8 ; une troisième version avec d’autres différences mineures et occupant un seul feuillet est conservée en deux exemplaires avec un tapuscrit de la préface sous la cote LJ-D-69 (13).
Notes philologiques :
I « re-imprimez » : retour à la ligne entre « re- » et « imprimez ». La version conservée sous la cote LJ-D-69 (10) contient « ré-imprimez » et celle conservée sous la cote LJ-D-69 (13) contient « réimprimez ».
II « Louis Jouvet » : signature autographe.
Fred Uhler à Louis Jouvet (Neuchâtel, 07.08.1941) et Louis Jouvet à Fred Uhler (Buenos Aires, [08].1941)
7 Août 1941 NeuchâtelI
LOUIS JOUVET. BUENOS AIRES.
IMPRESSION SABATTINI EN VOIE ACHEVEMENT DESIRAIS INTRODUCTION DEBUT SEPTEMBRE AMITIES A TOUS A VOUS SURTOUT.
UHLER CONCERT 6.
UHLER. Réponse de Buenos AiresII
MERCI POUR CETTE BONNE NOUVELLE ACCORDEZ MOI FIN SEPTEMBRE. LETTRE SUIT. AMITIES BASSIN 12 – AFFECTUEUSEMENT A VOUS.
JOUVET.
Description : 1 billet contenant deux transcriptions dactylographiées de télégrammes
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 6
Notes philologiques :
I « Août 1941 Neuchâtel » : ajout manuscrit en remplacement de « AGOSTO. ».
II « Réponse de Buenos Aires » : ajout manuscrit.
Louis Jouvet à Fred Uhler (Buenos Aires, 20.08.1941)
[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]
Théâtre Odéon, Buenos-Aires,
le 20 Août 1941
Cher Fred Uhler,
Aujourd’hui 20 Août, je n’ai pas fini ma Préface. Je pensais pouvoir vous en donner l’essentiel pour que je fasse les corrections sur la première épreuve. Je suis encore bien loin de compte. Comme je vous l’ai dit, j’ai changé d’idée.
Ce livre est pour moi vraiment une occasion importante de fixer et résumer quelques idées essentielles sur mon métier et je souhaiterais pouvoir le faire particulièrement à propos de Sabbattini. D’autre part, il me semble – bien que j’aie une profonde répugnance pour ce genre d’annotations qui rappelle trop le commentateur (que je déteste) – qu’il serait nécessaire de faire, pour quelques chapitres de Sabattini, des notes explicatives qu’on pourrait ajouter à la fin du livre dans le principe de ce qu’a fait La Pléiade pour les éditions classiques[82], et peut-être même des croquis ou dessins supplémentaires.
Si votre tentative avait quelque chance, en dehors des bibliophiles, de trouver encore des lecteurs, je crois qu’on pourrait faire, en outre, à la suite, un autre ouvrage qui, partant de Sabattini, – de la disposition et de la forme des théâtres italiens au 17ème siècle, résumerait l’histoire de la Pratique des Scènes depuis les origines, en passant par Vitruve, Serlio, Palladio et l’époque élisabéthaine, [f. 2] pour montrer son évolution, ses altérations jusqu’à nos jours, les planches de l’Encyclopédie étant comprises dans cette publication. Mais ceci est un projet qui demande du temps.
J’ai également en train une petite étude sur le Conservatoire que j’espère pouvoir vous montrer en rentrant.
Je ne sais si cette lettre vous parviendra. J’ai écrit plusieurs fois à différentes personnes qui n’ont pas reçu mes lettres. Je souhaite que celle-ci vous arrive. En tout cas, nous serons en France probablement vers le début d’Octobre[83].
Je vous enverrai, ma préface dès qu’elle sera finie, mais je crois que le plus sûr sera que je vous l’apporte moi-même.
affectueusement à vous
Louis JouvetI
P.S.-
La petite lettre que je vous ai écrite à bord de l’Argentina, en date du 2 Août, j’aimerais la voir figurer en tête de la préface, avant les confidences au Lecteur[84].
– amitiés encore au Bassin 12 – qui j’espère sera [1 mot ill.] de la sœur de Suzanne[85].II
Monsieur Fred Uhler,
Concert 6, Neuchâtel.
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 2 feuillets
Cote : FUHL-102-1.6. Un possible brouillon avec des différences mineures est conservé sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 4-5.
Notes philologiques :
I « affectueusement… Jouvet » : ajout autographe.
II « – amitiés… Suzanne. » : ajout autographe.
Fred Uhler à Louis Jouvet (Lenk im Simmental, avant le 20.11.1941)
[En-tête: Companhia Radiotelegraphica Brasileira. S. A.]
[Reçu à Rio de Janeiro le [20].11.1942]
LQB4LM BR146 LENK SIMMENTHAL 26 19 1330
REEXPEDIE-DE-BAIRES NLT[86] LOUIS JOUVET AMBASSADE FRANCE RIO
RECU LETTRE ARGENTINA INTRODUCTION PROMISE NON PARVENUE LIVRE IMPRIME PARUTION ANNONCEE FIN DECEMBRE ATTENDS TEXTE PAR AVION AMITIE
UHLER
Description : 1 télégramme
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 3
Louis Jouvet à Fred Uhler (Rio de Janeiro, [24].11.1941)
[Cachet : Bureau des télégraphes de Neuchâtel, 24.11.1941]
[Provenance: 20084 RIO DE JANEIRO BS1 25 24/11 0130 RS = CTR]
NLT = UHLER CONCERT 6 NEUCHATEL =
TROIS FOIS REFAITE JE LA REECRIS ENVERRAI AUSSITOT ACCORDEZ MOI DELAI ENVOYEZ EPREUVES LIVRE SI POSSIBLE EXCUSES AMITIES = JOUVET GLORIAOTEL +
Ajout allographe au verso du télégramme (Fred Uhler) : « Merci
Jouvet Gloriaotel
Rio de Janeiro 3
Merci prompte réponse Livre achevé sauf préface 10
[1 mot ill.] pour ‹pouvoir› souscriptions ouvertes 15
Puis je compter surI texte fin décembre 21 »
Description : 1 télégramme
Collation : 1 feuillet
Cote : FUHL-102-1.6
Note philologique : I « sur » : ajout manuscrit supralinéaire.
Fred Uhler à Louis Jouvet (Lenk im Simmental, [27].11.1942)
[En-tête: Companhia Radiotelegraphica Brasileira. S. A.]
[Reçu à Rio de Janeiro le 27.11.1942]
BS105 HBF/PE
LENKSIMMENTAL 25 26 1755
NLT JOUVET GLORIAOTEL RIO
MERCI POUR TELEGRAMME INSISTE AVOIR TEXTE FIN DECEMBRE
SOUSCRIPTION OUVERTE PROSPECTUS ENVOYES IMPRESSION TERMINE ENVOYE EPREUVES AMITIES BON SEJOUR BRESIL
UHLER
Ajout allographe (Louis Jouvet) : « – à Suzanne Mélinand. – ‹Pré›venir Fred. Câbl‹e› le 17 – Préface envoyée ‹recevra un› [1 mot ill.] / Dimanche soir ‹10 Lati[87]› »
Description : 1 télégramme
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 2
Louis Jouvet à Fred Uhler (Rio de Janeiro, 14.12.1941)
[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]
Rio, le 14 Décembre 1941.
Cher Fred UHLER,
Voici enfin cette préface[88]. Je pense qu’elle arrivera à temps.
Je vous dois toutes sortes d’excuses. Mon retard, croyez-le, n’est pas cause de négligence mais de scrupules et de la difficulté que j’ai à écrire.
Je vous prie d’en user avec cette préface à votre guise, et pour le mieux de vos intérêts, c’est-à-dire que je ne verrai aucun inconvénient à ce que, non seulement vous en changiez le style maisI que vous retranchiez ce qui vous paraîtrait superflu. Je me hâte d’ajouter cependant que je tiens vraiment beaucoup à ce que j’ai écrit, car ce résumé ne représente que la cinquième partie de mon travail.
Il est peut-être trop condensé par endroits ; il était difficile de faire plus court, sans s’exposer à ce reproche.
Je laisse à votre compétence et aux soins de la composition le partage du texte, les alinéas, les agréments typographiques qu’il nécessite pour acquérir une disposition claire, car je le trouve moi-même un peu « épais ».
Je vous laisse aussi le soin de la ponctuation, à quoi, je n’entends rien[89] .
Je voudrais aussi, que si vous publiez la petite lettre que je vous ai envoyée en date du 2 AOUT 1941, à bord de « L’ARGENTINA », vous ajoutiez à la liste des personnes pour lesquelles je souhaite un exemplaire, le nom de Mr ANTONIO G. BRAGAGLIA, qui a fait également une étude sur SABBATTINI[90]. En tous cas, que vous le comptiez dans les » services « .
Pour la classification que je fais en tête de la préfaceII, des époques ou des ordres de l’architecture dramatique, je souhaiterais aussi, afin que les explications du texte soient plus lisibles, que vous puissiez reproduire Cinq figures.
1°) Le Plan du Théâtre Grec et du Théâtre Romain, qui sont dans l’Architecture de VITRUVE.
2°) Pour le Moyen-Age, la photo-gravure des « Mystères du Moyen-Age » qui a été publiée dans l’ouvrage de GUSTAVE COHEN[91], et qui représente un panorama des différents décors des Mystères du Moyen-Age. C’est une petite planche rectangulaire.
3°) Le plan du Théâtre de VICENCE, par PALLADIO, qu’on peut trouver dans une édition de son traité de l’architecture.
4°) Le croquis du Théâtre de SWAN- de SHAKESPEARE, qu’on peut trouver dans n’importe quel ouvrage sur l’histoire du Théâtre Elisabéthain.
5°) N’importe quel plan de théâtre du dix-huitième ou dix-neuvième qui donne d’une façon claire la forme « elliptique » de ces salles.
Vous pourrez d’ailleurs probablement trouver toutes ces gravures dans « l’Histoire du Théâtre » par Lucien DUBECH[92].
Je vous remercie encore de m’avoir donné l’occasion de faire ce travail.
Je vous dis tous mes vœux pour le succès de votre ouvrage et je m’emploierai avec plaisir à sa publicité. Dites-moi si je peux vous aider là-dessus. Je serai content, aussi vous le devinez, si je peux recevoir un exemplaire mais cela n’est sans doute pas facile et je ne vous en voudrai aucunement si je dois attendre pour le lire.
J’attends seulement de savoir par câble que vous aurez reçu cette lettre et mon travail.
Mille amitiés au Bassin 12 – d’ailleurs Monique[93] [1 mot ill.] demain – je câblerai dès son arrivée –
Croyez à mes sentiments de très ‹vive› sympathie – Tous mes vœux !
Louis JouvetIII
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 2 feuillets
Cote : FUHL-102-1.6
Notes philologiques :
I « mais » : ajout manuscrit en remplacement de « et ».
II « , » : ajout manuscrit.
III « Mille… Jouvet » : ajout autographe.
Fred Uhler à Louis Jouvet (Neuchâtel, [03].01.1942)
[En-tête: Companhia Radiotelegraphica Brasileira. S. A.]
[Reçu à Rio de Janeiro le 03.01.1942]
BS172 HBFCL
NEUCHATEL 25 2 1155
NLT JOUVET GLORIATEL RIO
RECU PREFACE ENVOIE REMERCIEMENTS ENTHOUSIASTES FERAI AUSSI TIRAGE SPECIAL RESTREINT VOTRE TEXTE[94] ENVERRAI SABBATINI BRESIL BON SOUVENIR MONIQUE MILLE AMITIE
UHLERDescription : 1 télégramme
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-D-69 (10), doc. 1
Fred Uhler et Jacqueline Morel à Louis Jouvet (Zurich, 28.02.1942)
Zurich, le 28 février 1942
Très cher ami,
Il y a un an, presque jour pour jour, nous avons déjeuné ici. Venir à Zurich avec Jacqueline Morel pour ‹mettre› le ‹point final au› Sabbattini. Nous pensons affectueusement à vous.
Votre dévoué
Fred Uhler
Ajout allographe (Jacqueline Morel) : « Le Sabattini est magnifique, c’est lui qui nous vaut une nouvelle escapade à Zurich. Ici nous rappelle à chaque instant celle de l’année dernière où vous étiez accompagné de Raymone[95] – / Amitiés Jacqueline Morel. »
Description : 1 carte autographe
Collation : 1 carte postale
Collation : LJ-Ms-161, doc. 89
Adresse autographe : « Louis Jouvet / Gloria-Hotel / Rio-de-Janeiro / Brésil ».
Correction allographe : « Gloria-Hotel » et « Rio-de-Janeiro » corrigés en « Emb. Franceza ».
Inscription préimprimée : « Hotel z. Storchen, Zurich / Sektion: C. F. Eicher / Ansicht der « Rôtisserie de la Cigogne » »
Fred Uhler à Louis Jouvet (Neuchâtel, 23.03.1942)
Neuchâtel, le 23 mars 1942
Par avion et bateau
Monsieur Louis JOUVET
226, Avenue Atlantica
Rio de Janeiro
Cher ami,
Giraudoux vous aura appris que Sabbattini est enfin sorti de presse. J’ai eu le plaisir de lui remettre, lors de son passage à Neuchâtel[96], le premier exemplaire sur japon qui m’ait été livré. Je ne veux pas être un faux modeste et je puis vous assurer qu’il s’agit d’un très beau livre. Si la chose est possible, je vous en ferai parvenir un exemplaire par avion. Il me faut renoncer à suivre les voies de communication ordinaires, car le volume a trop peu de chances de vous atteindre.
Suzanne Mélinand m’a donné de vos nouvelles et je suis heureux d’apprendre que vous pouvez continuer votre magnifique carrière en Amérique du Sud. Toutefois, nous sommes tous peinés de votre absence et nous languissons après vous.
Vous m’avez prié de garder un exemplaire de Sabbattini pour les personnes suivantes :
Mlle Marie Canavaggia
Mlle Renée Canavaggia
Christian Bérard
Pavel Tchélitcheff.
Je vous saurais gré de me communiquer leurs adresses en France[97]. Quant à M. Camille Demangeat, M. Léon Deguilloux, Melle Renée-Marthe Erlin, je pense qu’il vaut mieux attendre leur retour en Europe pour leur remettre les exemplaires qui leur sont destinés.
Je vous donne encore quelques caractéristiques de l’ouvrage : 232 pages, format 19 x 27 cm, 200 lettrines et figures, y compris les plans de théâtres que vous m’avez chargé de trouver par votre lettre du 14 décembre. – Votre préface comprend 42 pages et se trouve écrite en italiques Garamond. Le caractère même de l’ouvrage est imprimé en caractères italiens antiques type Polyphilius. Sabbattini remportera certainement un bon succès et les premières souscriptions sont au nombre de 200. Je me permets de vous rappeler que le tirage est limité à 1060 exemplaires, soit 1000 sur vergé chamois, 40 sur hollande, et 20 sur japon.
Dans votre lettre du 20 août 1941 écrite à Buenos Ayres, vous me dites que vous avez en train une petite étude sur le Conservatoire. J’aurais le plus grand plaisir à la publier et si vous pouvez me la faire parvenir, elle prendra sa place tout naturellement dans une collection que je pense lancer en automne prochain et qui aura pour titre : « Images du temps ». Il s’agirait d’une suite de plaquettes où je pense publier des œuvres originales d’auteurs de notre époque. Elle rappellerait, par son but, la collection « Une œuvre, un portrait » lancée il y a quelques années par la NRF[98]. Voyez, je vous prie, si vous pouvez me confier ce texte.
Tous mes vœux pour votre prochaine tournée en Amérique [f. 1v] du Sud accompagnent cette lettre. Je veux espérer que j’aurai bientôt le plaisir de vous revoir. Dites toute mon amitié au « Théâtre Louis Jouvet » et plus particulièrement à Monique Mélinand. Sa sœur[99] se joint à moi pour vous dire toute son affection.
Croyez-moi, cher ami,
Votre toujours dévoué,
Fred UhlerI
Description : 1 lettre dactylographiée signée
Collation : 1 feuillet
Cote : LJ-MS-161, doc. 68
Note philologique : I « Fred Uhler » : signature autographe.
4. « Histoire à propos de Sabbattini » (s. d.)
Dans sa préface, Jouvet s’interroge sur les motivations de l’écriture de Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre : « À qui s’adresse ce livre, et pourquoi a-t-il été écrit ? Il ne peut s’adresser qu’aux initiés ou à ceux qui veulent le devenir, et, comme tout ce qui se fait de beau et de grand en ce monde, il a été écrit par amour d’une profession[100] ». Au sein de la documentation de Jouvet se rapportant à Sabbattini se trouve une « Histoire à propos de Sabbattini » qui fait le récit de la genèse de l’écriture des deux livres constituant son traité et des circonstances de la mort de son auteur, « Nicolas », un être vieillissant qui a gardé toute son ardeur, mais qui sent sa profession lui échapper. En ce qu’il traite de la vie d’un architecte et machiniste, ce récit peut être rapproché de quelques-unes des biographies qui se trouvent dans Vies des fameux architectes[101], qui incluent non seulement les architectes Serlio et Palladio, mais également Jean-Nicolas Servandoni, qui s’était aussi occupé de machines de théâtre. Le récit édité ci-dessous ne commence néanmoins pas avec la naissance de « Nicolas », et relève d’une forme d’appropriation d’éléments biographiques qui paraît plus proche de ce que fait Marcel Schwob dans Vies imaginaires[102].
Comme l’indique Sandrine Dubouilh dans les pages qu’elle lui a consacrées[103], ce texte est anonyme et non daté. Il contient des idées qui rappellent parfois celles qui se trouvent dans la préface et que Jouvet n’aurait probablement pas reniées, telles qu’une opposition entre les calculs et les expériences ou entre le praticien et le métaphysicien. Sandrine Dubouilh invite ainsi à se demander si ce texte a été d’utilité à Jouvet[104]. L’évocation d’un vieux compagnon qui a enseigné l’usage du fil à plomb rappelle l’anecdote rapportée par Jouvet, qui raconte comment Alphonse, avec un seau et un fil à plomb lui a montré comment tracer une coupe à 45 degrés[105]. Il pourrait s’agir d’un clin d’œil qui suggérerait que le texte a été écrit, sinon par Jouvet, par l’un de ses collaborateurs. Il serait peut-être possible d’obtenir des indices quant à la provenance du texte en s’intéressant au type de machine à écrire employé pour produire ce tapuscrit qui ne contient pas d’accent grave, ni d’accent circonflexe, ni de cédille et sur un papier dont le format et le type ne correspondent pas aux autres documents conservés dans le lot d’archives[106]. À ce jour, l’auteur tout comme les raisons de la présence de ce texte dans le fonds Louis Jouvet restent ainsi indéterminés.
Au-delà du mystère qui entoure son origine, cette histoire constitue un exemple original d’appropriation du traité italien du xviie siècle et d’éléments biographiques de son auteur. « Nicolas » y est présenté comme un machiniste qui a appris son métier par la pratique plutôt que dans les livres et qui parvient néanmoins, non sans éprouver quelques difficultés, à mettre sur le papier les connaissances qu’il a acquises.
[f. 1]
HISTOIRE
À PROPOS DE SABBATTINI
______
Il y avait une fois, un brave homme nommé Nicolas, qui aimait tant son métier et le pratiquait si bien que, de toute part, on venait lui demander le secret de son savoir-faire. Cela ne laissait pas que de l’étonner, car il ne lui semblait pas faire différemment des autres et toutes ces questions qu’on lui posait finirent par lui donner de l’inquiétude.
Il faut dire que le métier de cet homme était de ceux qui, pour le commun des mortels, semblent toujours recéler un peu de sorcellerie[107] : à cause d’on ne sait quel atavisme ou de quelles circonstances, Nicolas était constructeur de décors et de machines de théâtre.
Quelque peu architecte, quelque peu charpentier, quelque peu peintre et mécanicien, il s’efforçait d’approfondir et de coordonner ses connaissances de manière à aider de mieux en mieux à l’émerveillement des spectateurs par la richesse et l’ingéniosité des décorations.
Tantôt, il modifiait la façon de disposer les décors sur la scène pour obtenir des effets de perspective plus justes et plus variés. Tantôt, il simplifiait ou améliorait les divers moyens de figurer la mer – agitée ou calme –, les nuages – envahissant ou libérant le ciel, le tonnerre ou les spectres.
Il prenait un tel plaisir à aider ainsi à la réussite des spectacles présentés, qu’il s’appliquait de tout son cœur à son travail et ne comprenait pas ceux de ses compagnons qui ne se contentaient de l’accomplir machinalement sans « mettre zèle et honneur à bien faire[108]« .
Souvent, il lui arrivait de rêver de son travail et de courir, dès l’aube, au théâtre, afin de vérifier si vraiment un morceau de planche clouée d’autre façon ou un cordon plus ou moins tendu suffiraient à permettre d’accélérer une manœuvre ou de modifier un effet.
Le reste du temps, il n’y pensait guère et vivait comme chacun, prenant plaisir à la vie, la bourse suffisamment pleine et la conscience en repos.
Cependant, sa renommée s’étendait. Partout où – suivant la mode – un gentilhomme, ami des Arts, désirant doter quelque pièce d’un éclat particulier, s’enquérait d’un homme capable de le servir en cela, on ne manquait pas de lui indiquer notre homme qui, à l’avis de tous, était inégalable.
Qu’il s’agît de représenter un palais magnifique, un antre, une grotte ou une ville ; qu’il fallut faire surgir des enfers des démons dansant entre les flammes ; descendre des dieux ou des esprits du ciel ; faire disparaître et reparaître aussitôt la lumière de toutes les chandelles illuminant le théâtre, on était, avec Nicolas, assuré de la réussite.
L’âge venant, il vivait dans l’aisance, connu et respecté de tous, et vénéré par ses compagnons à qui il avait bien des fois révélé un « tour de main » plus aisé ou plus efficace. [f. 2]
Aussi, que de jeunes ouvriers ou des apprentis vinssent souvent lui demander conseil et trouvassent profit à son enseignement, cela ne le surprenait pas : c’était dans l’ordre et Nicolas était fier et heureux de penser que des jeunes gens pourraient, sans doute, grâce à ses leçons, avancer plus vite dans ce métier de pratique ou l’expérience ne peut laisser de trace autre que la Tradition.
Mais ce qui déconcertait Nicolas, c’est que de vieux artisans ou des hommes plus instruits que lui vinssent également le consulter avec déférence. Qu’était-il donc de plus qu’eux ? Que pouvait-il montrer d’inconnu à ses vieux compagnons ? À celui-ci, qui depuis vingt ans faisait équipe avec lui ? À celui-ci qui, à ses débuts, lui avait enseigné l’usage du fil à plomb ?
Et ce jeune Seigneur qui, l’autre soir, lui a demandé pour se moquer, peut-être, si ce n’est pas dans les Livres Maudits qu’il a puisé ses secrets !
Jusqu’à Monseigneur l’Évêque qui l’a fait venir, plus d’une fois, pour lui répéter que s’il voulait servir Dieu, son devoir était de se résoudre à réunir en un volume toutes les précieuses connaissances, qu’il lui a permis d’acquérir. – « Souvenez-vous, mon fils, » a ajouté en souriant l’Évêque – « que vous n’en êtes que le dépositaire ! »
– « Hélas, Monseigneur ! Que votre Éminence veuille bien dispenser un pauvre homme ! Je ne saurais qu’écrire ! Ce n’est pas dans les livres que j’ai appris mon métier et je ne pense pas que qui que ce soit pourrait l’y apprendre. Ce n’est pas que la théorie en soit difficile, mais la pratique en est pourtant encore plus facile[109] et un métier est tout entier dans la pratique ! Est-ce pour avoir lu dans un livre la façon dont il convient qu’un lapin soit accommodé que ma femme m’en fait manger de si savoureux ? Non, Monseigneur, c’est pour avoir vu faire sa mère et sa grand’mère ; c’est pour s’y être essayée – d’abord maladroitement bien des fois – elle-même, pour avoir peu à peu compris, à l’usage, qu’une bête plus ou moins grasse demande un feu plus ou moins vif, une sauce plus ou moins longue, plus ou moins épicée. Mon métier est de même, Monseigneur ! Il n’est qu’observation quotidienne, patience et tour de main. Ce n’est donc pas en décrivant sa méthode que j’enseignerais l’art de le pratiquer.
Je pense que tous les métiers nobles en sont là. (La cuisine, dont je parlais tout à l’heure, en est un, bien qu’il n’y paraisse pas à première vue, parce que c’est un métier ou le résultat dépend de l’attitude morale qu’on a vis-à-vis de lui). C’est cela qui différencie certaines professions de celles qui ne sont que des gagne-pains.
Il n’y a pas non plus de magie, dans le mien, bien que certains m’en accusent. Lorsque, pour les nécessités de l’action imaginée par le poète, il faut que l’enfer apparaisse sur le théâtre, ou bien que le lieu change instantanément, mon métier est de donner au public l’illusion que ces faits se produisent devant lui. Voilà tout !
Je suis avec exactitude les instructions de l’ordonnateur quant au moment et à l’endroit où ces incidents doivent intervenir, sans gêner les mouvements des acteurs[110] et de manière à fournir au public le plus d’agrément ; je veille à ce que tout soit aussi précis, aussi harmonieux que possible et à ce que chacun des effets soit entièrement réussi. Il n’y a qu’à être bien attentif et avoir tout bien convenu et bien réglé d’avance : il n’est rien de plus simple ! » [f. 3]
– « Cela vous semble ainsi, mon fils, parce que vous connaissez les moyens à employer pour produire, au mieux, ces effets ou chacun se plaît à trouver soit de la magie, soit du miracle. »
« Peut-être, en effet, vos compagnons ne trouveraient-ils pas dans l’énumération de ces moyens autant d’aide que leur paresse d’esprit le souhaiterait ! Songez, cependant, que leurs fils ou leurs petits fils sont susceptibles de se trouver un jour sans autre guide que ce volume que je veux vous voir faire. Si, dans les générations qui doivent nous suivre, votre profession venait à subir un temps d’arrêt dans sa progression ; si, au contraire, cette progression l’entraînait à se perfectionner dans un autre domaine ; il se peut qu’un jour, sans lien avec la tradition actuelle, votre métier piétine ou rétrograde. Ne voulez-vous pas tenter de l’empêcher ? »
« D’autre part, ces accusations de sorcellerie, de procédés entachés de magie, dont vous me parliez il y a un instant, ne vaut-il pas mieux en détruire la légende ? »
« Voulez-vous, Nicolas, que vos petits-enfants en viennent à redouter un grand’père un peu sorcier ? »
Fut-ce le dernier argument de l’évêque qui parvint à convaincre le brave artisan ? Fut-ce le désir de sauver quelque chose de ses expériences ? Toujours est-il qu’il promit d’obéir aux désirs de Monseigneur et de lui dédier bientôt un recueil des secrets de sa profession.
La première partie lui en parut facile à écrire. Il avait tant de fois constaté ce qui fait la qualité d’un théâtre, qu’il expliqua tout naturellement la meilleure façon de construire ou d’accommoder une scène et une salle destinées au spectacle. La manière d’obtenir une décoration en perspective ; celle de peindre, de clouer, de disposer les décors – qui, dans ce temps-là, variait peu – ne lui offrit pas non plus à décrire de bien grandes difficultés.
Pour vérifier la justesse de ses explications, il se mit à aller de temps en temps, se mêler aux spectateurs et à écouter ce qui se disait autour de lui.
« C’est de la magie, » s’écriaient les uns.
« Voyez si les dernières maisons de cette rue ne paraissent pas se trouver à une énorme distance et cependant il n’y a pas là plus de dix pas ! »
« C’est miraculeux ! » proclamaient les autres. « Voyez donc ces balcons, ces balustres, ces boutiques ! C’est à gager qu’elles sont véritables ! Il est impossible que cela ne soit dû qu’à l’art du peintre. »
Nicolas ne voyait rien de fantastique à ces arrangements qui ne lui paraissaient que propres et bien agencés. Sans doute, son œil habitué, trop habitué à l’arrangement de la scène, n’avait-il plus la même vision ? Il revenait un peu troublé sur le derrière du théâtre, mais là où il n’avait le loisir de rêver, il reprenait pied bien vite et, le spectacle fini, courageusement, pour obéir à Monseigneur, il s’efforçait de fixer par l’écriture et le dessin, la construction de ces rues magiques et de ces balcons miraculeux. [f. 4]
Quand il en eut terminé avec les décors proprement dit, il lui fallut aborder le chapitre des « machines ».
On appelait ainsi – on appelle encore – ces installations grâce auxquelles il est permis aux éléments et au surnaturel de se manifester sur la scène.
Autrefois, quand le fabuleux était partie inhérente du drame, ces machines – aujourd’hui peu usitées, sauf dans les théâtres d’opéra – étaient tellement prisées que, dès l’invention des premières d’entre elles, on se mit à écrire quantité d’intermèdes spéciaux pour permettre de les utiliser et le public, plus crédule que de nos jours, s’extasiait à leurs manifestations qui le gorgeaient de merveilleux !
Nicolas, accoutumé à ne voir dans la descente de Jupiter sur la terre qu’une manœuvre plus ou moins laborieuse des poulies et de contre-poids, fut extrêmement surpris, un soir ou il était allé contrôler de la salle l’effet obtenu, de constater que vu sous cet angle, pour lui inhabituel, mêlée ainsi à l’action, la descente des nuages depuis le ciel jusqu’au plancher, le roulement du tonnerre, l’apparition de l’acteur chargé de représenter le roi des Dieux, lui causaient à lui-même un étonnement admiratif.
Il oubliait le déroulement progressif des cordons qui soutenaient et gouvernaient le nuage ; la pièce de bois inclinée, les étriers sur lesquels se tenait Jupiter ; les boulets de fonte roulés dans un canal qui imitaient le bruit du tonnerre : – il croyait lui aussi au miracle ! Ce ne fut qu’un instant, mais déjà, il écoutait les exclamations avec un sentiment différent et il fut obligé de se secouer pour revenir à lui et continuer à décrire, honnêtement, dans son livre la manière de produire un effet et non pas l’émerveillement qui en résulte.
Il se rendait heureusement compte de ce que loin de l’aider dans son travail, la vérification de celui-ci, sous l’angle du spectateur, faussait sa vision valable des artifices du théâtre et, malgré le désir qui le taraudait d’éprouver à nouveau l’effet magique des machines agencées par lui, il résolut de ne plus se mêler au public avant d’avoir terminé son livre.
Cependant, celui-ci lui paraissait de plus en plus difficile à écrire. Il se mettait, en les transcrivant, à douter de l’efficacité de manœuvres contrôlées, exécutées ou commandées des centaines de fois. Il lui semblait s’être trompé jusqu’alors et l’urgence d’essayer des méthodes différentes s’imposait à son esprit. Il cherchait alors, ne voulant point qu’on devina ses inquiétudes, à trouver par le calcul seul, de nouvelles solutions. Il demeurait suffisamment lucide pour ne pas tenir compte de ces tentatives dans le livre qu’il était en train d’achever, mais de plus en plus souvent, il terminait ses chapitres par cette phrase qui était comme un constant apaisement qu’il se donnait à lui-même : « On aura fait ainsi tout ce qu’il fallait[111].
Voulant finir, comme il l’avait commencé avec zèle et simplicité, ce récit complet de sa « pratique », il se hâtait, inquiet du tour nouveau qu’avait pris son esprit. Il parvint pourtant, en luttant contre lui-même, à ne mettre sur le papier que ce qu’il avait promis d’y tracer et « ayant fait ainsi tout le nécessaire[112]« , ce fut avec soulagement qu’il porta à Monseigneur l’ouvrage terminé.
Il pensa, délivré de ce souci intellectuel, en avoir fini avec [f. 5] tous les tracas qui l’avaient momentanément détourné de sa véritable existence.
Mais n’ayant aucune besogne urgente qui l’appela sur la scène, il se donna le loisir, maintenant que son livre ne pourrait plus en souffrir, d’aller à nouveau voir le plus souvent possible, fonctionner les machines qu’il s’était contenté, jusque-là, de construire.
Il n’éprouva d’abord que l’anxiété professionnelle de voir manquer une manœuvre difficile ou la fierté de la voir réussir et fut déçu de ne pas retrouver cet état second qui lui avait permis de jouir du spectacle en profane. Il n’alla plus dans la salle que pour le rechercher. N’obtenant pas de résultat, il s’en prit aux machines et en vint jusqu’à conclure arbitrairement que si tous les moyens de les actionner étaient semblables, elles arriveraient à produire des réactions plus vives. Il fit démonter et remonter d’autre façon par ses compagnons étonnés, les agencements les plus sûrs et les plus ingénieux. Il en vint à penser que toute apparition doit être obligatoirement accompagnée de tonnerre et chaque orage entraîner la descente d’un esprit. Il ne pensait plus à son métier que sur le plan du merveilleux et perdait toutes les caractéristiques de son ancienne maîtrise. Lui qui autrefois, à première vue, décidait sans se tromper, du bois le plus propre à telle ou telle construction, de l’épaisseur d’une toile du polissage nécessaire à une perche, à un engrenage, tâtonnait maintenant, interrogeant une mémoire qui n’était plus celle physique et comme organique de l’homme de métier, mais la mémoire abstraite et déductive du métaphysicien.
Devenu inquiet, il n’était plus infaillible. « Il vieillit », disait-on, « il ne voit plus, il ne touche plus ». La vue n’avait pourtant rien perdu de son acuité, ni ses mains de leur science. Mais ce n’était plus elles qu’il croyait, plus elles qu’il cherchait à satisfaire. Ayant perçu une seconde le miracle qu’il contribuait à créer, il n’osait plus, ne savait plus prendre part à sa création. L’exemple des dieux – de Dieu – n’a jamais rien appris aux hommes. Celui qui crée – même s’il est le Tout-Puissant – se tient éloigné du résultat de sa création. Malheur à celui qui, même sans orgueil, goûte ou cherche à gouter à son propre fruit !
Le malheureux artisan ne comprenait pas ce qui était venu soudain lui dérober ses connaissances. Il était profondément malheureux et se persuadait, lui aussi, que l’âge était cause de sa diminution.
Il fit remettre dans l’état où elles étaient précédemment toutes les machines de son théâtre et renonça à pratiquer plus longtemps un métier qu’il sentait lui échapper.
Cependant, il se voyait toujours plein de santé et d’ardeur et ce renoncement à une profession qui avait été toute sa vie, lui causait une grande douleur. Il se mit à souhaiter la compagnie des jeunes-gens qui débutaient dans le métier de machiniste. Il les savait plus instruits qu’il ne l’était à leur âge, orientés différemment, pleins d’idées nouvelles et d’initiatives hardies. Mais, à part de rares exceptions, leur instruction leur servait surtout de prétexte à dénigrer tout travail qui ne soit pas de l’esprit. Ils pensaient que l’architecte doit se borner à construire par plans et par devis et [f. 6] que sa dignité exige qu’il se tienne à l’écart de l’exécution.
– « Que chacun œuvre dans sa partie », disaient ces jeunes sots. – « Le travail de l’architecte est tout spirituel et ne doit pas se mêler à celui des charpentiers et des maçons. »
Nicolas essayait alors par mille exemples, de démontrer à ses jeunes amis l’inanité de leur présomption, mais ceux-ci ne le croyaient pas et allaient jusqu’à lui faire entendre qu’à leur avis, son livre ne valait rien, n’étant pas basé sur des calculs, mais sur des expériences.
Le vieil homme écoutait alors, sans plus répondre, ces étudiants – on ne disait plus « apprentis » – lui enseigner en le dénaturant un métier qu’il connaissait mieux que sa propre respiration. Il les écoutait avec tristesse. Une espèce de vide d’agonie se faisait en lui. Il savait que ces jeunes gens se trompaient ; que l’intérêt que des profanes avaient tout à coup pris aux choses du théâtre, menaçait d’entraîner ses successeurs dans une voie stérile et vaine. Ils morcelaient une profession à laquelle la cohésion est indispensable.
De plus en plus, Nicolas se voyait seul et il commençait à se sentir vieux. Depuis quinze ans déjà, son livre était paru et s’était passablement répandu dans le public.
Parfois, quelque lecteur, venu sur place voir les décors et les machines dont il avait lu la description, demandait à connaître le vieil artisan qui les avait conçus. Mais on dissuadait les curieux de cette visite, « car, » disait-on, « le vieillard est devenu fou de l’orgueil d’avoir écrit un pauvre livre et, l’âge aidant, il ne sait plus bien ce qu’il dit. »
Pourtant s’il n’était plus guère écouté, Nicolas se sentait toujours aimé et respecté de ses anciens compagnons de travail et, bien que ses forces ne puissent plus servir son bon vouloir, il avait fini par revenir parmi eux.
Là, du moins, il ne se sentait pas dépaysé. Et, comme autrefois, il passait avec délectation presque tout son temps au théâtre.
C’est ainsi, qu’un soir, après une représentation de la « Nativité » Nicolas, rentré chez lui et déjà couché, n’arriva pas à s’endormir, poursuivi par l’idée que quelque chose avait été oublié ou négligé au théâtre et que cet oubli pourrait avoir des conséquences graves. Il se releva, se réhabilla fiévreusement – comme aux beaux jours de sa jeunesse – et se hâta, en pleine nuit, vers le théâtre. La nuit était belle, mais froide. Un peu de neige était tombée sur la ville endormie, et le silence en était singulièrement amplifié.
Par contre, dès que Nicolas eut franchi le seuil du théâtre, il lui sembla pénétrer dans la zone de résonnance d’un gigantesque instrument dont on aurait tout juste fini de faire vibrer les cordes. C’était fait de chuchotements, de craquements, de murmures. Mille échos palpitants nourrissaient ce silence sonore et pourtant amical.
Guidé par lui, autant que par son habitude des lieux, Nicolas s’avança sans penser à allumer sa lanterne. [f. 7]
Il fut surpris de découvrir sur la scène, tout équipé et éclairé, un grand vaisseau gréé qu’il avait autrefois construit pour figurer l’Arche de Noé, mais dont on ne s’était plus servi depuis longtemps. Le navire se balançait doucement, à l’ancre, sur les cylindres d’une mer dont il avait, lui aussi, agencé les remous.
Que faisait là ce vieux décor ?
« Holà ! », cria Nicolas, pensant que quelque compagnon, encore au travail, allait lui répondre.
Il n’en fut rien, mais le bourdonnement musical du silence s’augmenta curieusement d’un chant.
Le vieillard s’avança entre les flots de toile bleue vers le navire. Voilà qu’il était, tout à coup, moins certain de le reconnaître… La rumeur autour de lui devenait si forte qu’elle avait maintenant déchiré le silence et il semblait à Nicolas entendre le ronflement d’un véritable ouragan.
La distance qui le séparait du navire lui parut soudain doubler. Il voulut marcher plus vite et sentit avec épouvante ses pieds s’enfoncer en se glaçant dans les eaux.
L’Océan, furieux, l’entourait de toute part ! Il en percevait les hurlements, l’odeur, la puissance. Il eut un étourdissement, crut qu’il perdait pied, appela désespérément et s’affaissa sur le plancher nu de la scène où l’on trouva son corps le lendemain.
C’était matin de Noël.
Toutes les cloches du ciel et de la terre renouvelaient promesse de paix aux hommes de bonne volonté.
Description : 1 tapuscrit
Collation : 7 feuillets dactylographiés
Cote : LJ-D-69 (11), f. 1-7, doc. 54-59 (le troisième feuillet n’est pas numéroté)
5. Bibliographies se rapportant à Nicola Sabbattini, Louis Jouvet et Fred Uhler
5.1 Éditions du traité de Nicola Sabbattini
Dans sa préface, Louis Jouvet signale les éditions de 1637 et de 1638 du traité de Sabbattini, une traduction française du XVIIe siècle ayant eu peu de retentissement, une réédition italienne de 1738 et le fac-similé de l’édition de 1638 paru en 1926 et édité par la Société des Bibliophiles de Weimar[113]. La proposition selon laquelle le traité aurait rapidement été traduit en français pourrait découler du livre de Sophie Wilma Holsboer, qui écrit que «si l’ouvrage de Sabattini a été traduitsi l’ouvrage de Sabattini a été traduit en français, cette traduction est introuvable[114] », et d’un si hypothétique devenu factuel et contrastif. La réimpression italienne est notamment mentionnée par Anton G. Bragaglia (1890-1960), qui a possiblement repris l’information à Castil-Blaze (1784-1857) – Bragaglia le cite –, qui écrit : « Ce livre [la Pratica] jouit si longtemps de l’estime des artistes, qu’une seconde édition en fut donnée en 1738[115] ». Cette indication pourrait découler d’une erreur du catalogue du Comte Leopoldo Cicognara (1767-1834), où le traité de Sabbattini est daté de 1738, alors que l’édition conservée dans cette collection date de 1638[116].
Mises à part quelques entrées dans des catalogues de livres[117] et quelques brèves mentions à partir de 1820[118], le traité de Sabbattini ne semble avoir fait l’objet de commentaires moins succinct qu’après le milieu du XIXe siècle, notamment grâce à un article de Ludovic Celler (1828-1909), qui, en 1869, consacre un long texte en français à « La manière de fabriquer les théâtres par Nic. Sabattini[119] ». Cet article contribue à faire connaître l’ouvrage : Hermann Fritsche, qui n’a pas réussi à se le procurer dans les grandes bibliothèques allemandes, fait ainsi reposer son analyse sur l’article de Celler ainsi que sur les notes d’un collaborateur qui a consulté un exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France[120]. On trouve ensuite d’autres publications dans lesquelles il est question du traité, telles que Trucs et Décors où Georges Moynet traite de « Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri » de « Niccola Sabbatini[121] » ou, en 1913, un livre de Henry Prunières qui témoigne de la difficulté à se procurer l’ouvrage : « Ce rare ouvrage [édition de 1638] se trouve à Paris à la Bibl. Mazarine (A. 11786) et depuis peu à la Bibl. des Beaux-Arts[122] ». Les premières traductions partielles ou complètes du traité, en allemand, en anglais et en français, datent apparemment du XXe siècle.
La graphie du prénom et du nom de Sabbattini varie selon les éditions. Le premier livre porte le nom de Nicolo Sabbattini, le second Nicola Sabbattini. Quelques critiques ont préféré les graphies Sabbatini ou Sabattini[123], possiblement en raison de la graphie de noms d’artistes italiens qui ont été retenus par les lexicographes, tels que les peintres italiens des XVe et XVIe siècles Andrea Sabatini ou Sabbatini, dit Andrea da Salerno, et Lorenzo Sabatini ou Sabbatini, dit Lorenzino da Bologna[124].
Sources
Éditions originales
Nicolo Sabbattini, Pratica di Fabricar Scene, e Machin ne’ Teatri, Pesaro, Flaminio Concordia, 1637 [éd. partielle (I, 1-41)].
Nicola Sabbattini, Pratica di Fabricar Scene, e Machine ne’ Teatri, Ravenna, Pietro de’ Paoli, Gio Battista Giovanelli Stampatori Camerali, 1638.
Autres éditions italiennes et fac-similés
Nicola Sabbattini, Anleitung Dekorationen und Theatermaschinen herzustellen, Willi Flemming (trad. et postface), Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen, 1926 [fac-similé et trad. allemande[125]].
Nicolò Sabbatini, Pratica di Fabricar Scene e Machine ne’ Teatri, Elena Povoledo (éd.), Rome, Carlo Bestetti, 1955.
Nicola Sabbattini, Scene e macchine teatrali della commedia dell’arte e della scenotecnica barocca con i diegni originali, Alberto Perrini (éd.), Rome, E & A editori associati, 1989 [fac-similé].
Nicola Sabbattini, La Pratica di Fabricare Scene e Machine ne’ Teatri di Nicola Sabbattini. Uno sguardo alla lingua tecnica, Grazia Biorci (éd.), 2015 [document numérique disponible sur le site macchineteatro.icres.cnr.it].
Traductions allemandes partielles et complètes
Nicolo Sabbattini, Praktische Anweisung, Scenerie und Maschinen im Theater herzustellen, env. 1920, env. 67 feuillets[126] [trad. allemande partielle (I, 1-41)]
Nicolo Sabbattini, Praktische Anweisung, Szenerie und Maschinen im Theater herzustellen, s. d. [env. 1925], env. 92 feuillets[127] [trad. allemande partielle (I, 1-41)]
Nicola Sabbattini, Anleitung Dekorationen und Theatermaschinen herzustellen, op. cit. [fac-similé et trad. allemande].
Nicola Sabbattini, Anleitung Dekorationen und Theatermaschinen herzustellen, TheaterHeft, no 1 et R.I.S.T. (Revue internationale de sociologie du théâtre), no 0, Rome, E&A (Editori & Associati), s. d. [env. 1989] [réédition de la trad. allemande de 1926]
Traductions anglaises partielles et complètes
Nicola Sabbattini, « Some extracts from The practice of making scenes and machines in theatres (Book two), by Nicola Sabbattini da Pesaro », The Mask, vol. 12, no 2, 04.1926, p. 78-81 (II, 37-40) ; vol. 14, no 4, 10-12.1928, p. 162-168 (II, 41-45) ; vol. 15, no 1, 01-03.1929, p. 13-17 (II, 46-50) [trad. anglaises partielles (II, 37-50)].
Nicola Sabbattini, « Sabbattini on Theatrical Machinery », dans Alois Maria Nagler, Sources of Theatrical History, New York, Theatre Annual, 1952, p. 86-102 [trad. anglaise partielle (I, 39, 41 ; II, 5-7, 34-35, 37-38, 42-43, 45)].
Nicola Sabbattini, « Manual for Constructing Theatrical Scenes and Machines, 1638 », John H. McDowell (trad.), dans Hewitt Barnard (éd.), The Renaissance Stage: Documents of Serlio, Sabbattini and Furtenbach, Coral Gables (Floride), University of Miami Press, 1958, p. 43-177.
Nicola Sabbattini, « Sabbattini on Theatrical Machinery », dans Alois Maria Nagler, A Source Book in Theatrical History, New York, Dover Publications, 1959, p. 86-102 [réédition de la trad. anglaise partielle de 1952].
Traductions françaises partielles et complètes
Nicolo Sabattini, « Appendice III / De l’art de construire les scènes / par Nicolo Sabattini / Livre I » et « Livre II / Où il s’agit d’intermèdes et de machines », Juliette Bertrand (trad.), dans Sophie Wilma Holsboer, Histoire de la mise en scène dans le théâtre français de 1600 à 1657, Paris, Droz, 1933, p. 288-319 [trad. française partielle (I, 1-7, 10-18, 27, 29-30, 32, 36-39, 41 ; II, 1, 5-12, 17, 22-25, 27, 31, 34-35, 56)].
Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriques scènes et machines de théâtre, Mari[e] Canavaggia, Renée Canavaggia et Louis Jouvet (trad.), Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942[128].
5.2 Pré-éditions et rééditions de la préface ou d’extraits de la préface de Louis Jouvet
Des extraits de la préface de Louis Jouvet au traité de Sabbattini ont été repris, parfois indépendamment de toute considération sur le traité italien. Ces reprises partielles sont facilitées par l’autonomie relative de certaines parties de la préface ainsi que du fait qu’elles fournissent des textes de Jouvet sur des sujets qu’il a rarement abordés ailleurs, tels qu’un éloge de la machinerie (DdS, p. XVII-XX), une description de ses débuts en tant que régisseur (DdS, p. XXXVII-XL) ou une caractérisation des ordres d’architecture dramatique (DdS, p. XX-XXX).
Louis Jouvet, « Les leçons du machiniste », Curieux, 7e année, no 6, 06.02.1942, p. 1 [DdS, p. XXXVI-XL].
Louis Jouvet, « La théorie et la pratique du théâtre », Curieux, 7e année, no 7, 13.02.1942, p. 5 [DdS, p. XLII-XLV].
Louis Jouvet, « Parlons d’abord du machiniste… », Le Jour, 11.02.1942, p. 2 [DdS, p. XXXVI-XL].
Louis Jouvet, « Comment une pièce naît à la vie du théâtre », Le Jour, 17.02.1942, p. 2 [DdS, p. XLII-XLV].
Louis Jouvet, « Le théâtre est un secret… », Paris : l’élégance française, été 1945, p. 6-8.*
Louis Jouvet, « Rhapsodie », France Monde, no 1, 07.1945, p. 14 [DdS, p. XLII-XLIV].**
Louis Jouvet, « L’architecture dramatique », Éducation et théâtre : Revue des techniques d’expression dramatique dans l’éducation populaire, nos 21-22, 01-03.1954, p. 291-297 [DdS, p. XX-XXX].
Louis Jouvet, « Théâtre élisabéthain et italien : Préface à Sabbattini (extrait) », Aujourd’hui : Art et architecture, no 17, 3e année, « 50 ans de recherches dans le spectacle : Textes et documents réunis par Jacques Polieri », 1958, p. 74 [p. XVI-XVII, XXXIII].
Louis Jouvet, « Découverte de Sabbattini », Louis Jouvet et la scénographie, Avignon, Maison Jean Vilar, 1987, p. VII-XXXVI [DdS, p. XV-LV (réédition de la préface complète)].
Louis Jouvet, « « A dix-huit ans, j’étais régisseur… » », « « Le théâtre est un secret » », « Sur la critique » (p. 38-40), dans Louis Jouvet, Morceaux choisis, Paris, Conservatoire national d’art dramatique, 1988, p. 5-6, 21-23 et 38-40 [DdS, p. XXXVII, LI-LIII, LV et XLIII-XLIV].
Louis Jouvet, « Ce premier et suprême métier de régisseur… », dans Paul-Louis Mignon, Louis Jouvet : Qui êtes-vous ? Lyon, La Manufacture, 1988, p. 177-182 [DdS, p. XXXVI-XL].
Louis Jouvet, « Qu’est-ce que la machinerie ? », dans Louis Jouvet, Louis Jouvet, Ève Mascarau (éd.), Arles, Actes Sud, 2013, p. 72-76 [DdS, p. XVII-XXIV].
Louis Jouvet, « Éloge du régisseur » et « Giraudoux est-il ou non un auteur dramatique ? », dans Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. 2, « Pratique du théâtre », Marc Véron et Jean-Louis Besson (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 65-68 et 427-430 [DdS, p. XXVII-XXX et XLV-XLVII].
* L’article n’est pas repris de la préface, mais de conférences données en Amérique latine entre 1941 et 1945 ; dans le fonds Louis Jouvet, l’article est décrit comme un extrait remanié de la préface, probablement en raison de la présence de passages proches de DdS, p. XLVII, L, LI, LIV.
** Texte remanié, et augmenté de quelques paragraphes qui le terminent et qui élucident le titre donné à l’article :
[La pièce] ne se perpétuera maintenant que par une série de fermentations semblables qui assureront sa vitalité et peut-être sa longévité.
Remarques, notes, réflexions, paraphrases, amplifications, discussions, palabres, explications et développements d’un texte. Tout au théâtre est commentaire.
Ainsi la vie dans les œuvres de l’esprit se perpétue, se nourrit dans cette circulation, par cette sève où s’échangent, se renouvellent, se transforment les sensations, les sentiments, les idées.
Mais de toutes ces rhapsodies, de tous ces commentaires, le premier, l’essentiel, le capital est le commentaire que l’auteur fait de lui-même lorsqu’il écrit sa pièce. Ce commentaire de soi que Molière fait de lui-même, lorsqu’il écrit, « L’École des Femmes », ou « Tartuffe » ou le « Misanthrope », ou « Don Juan ». C’est le modèle des commentaires.
C’est le commentaire parfait.
5.3 Livres édités par Fred Uhler entre 1941 et 1943
L’avocat neuchâtelois Fred Uhler (1908-1982) fonde sa maison d’édition à Neuchâtel au printemps 1941, après avoir assisté à une conférence de Henry de Montherlant sur la guerre donnée à Lyon en décembre 1940. Le premier livre édité par Uhler est Paysages pour douze fables de Jean de la Fontaine de Marcel North, un ami d’enfance de l’éditeur dont l’ouvrage « paraît à l’enseigne des Ides de Mars, une appellation qui fait allusion au pseudonyme de l’artiste. Le deuxième volume publié par Uhler paraîtra toutefois sous la raison sociale d’Ides et Calendes, à la demande de North lui-même. Les Ides de Mars deviendront le titre de la collection réservée aux publications de l’artiste neuchâtelois[129] ». La même année, Uhler édite trois autres livres, de Henry de Montherlant, de Jean Giono et de Pierre Jean Jouve, où il est directement question de la guerre, considérée selon « une orientation politique pas encore très fixée[130] ». Il n’est pas certain qu’avec le temps, l’orientation politique de la maison d’édition se précise, car, après la guerre, Uhler continue à publier Louis Aragon ainsi que l’auteur qui est à l’origine de sa vocation d’éditeur[131].
Le traité de Sabbattini, imprimé en février 1942, est le cinquième livre édité par Uhler, le deuxième à avoir été imprimé à Zurich, la première traduction et la première publication éditée par Uhler à être tirée à plus de 1000 exemplaires.
Dans le catalogue d’exposition consacré à la maison d’édition en 1991, il est indiqué qu’une collection de « Théâtre » est créée avec la traduction française du traité italien[132]. Dans le catalogue 1943-1944, où figurent tous les ouvrages à l’exception de celui paru aux Ides de Mars et de celui de Giraudoux, le traité de Sabbattini préfacé par Jouvet apparaît dans la catégorie « Textes d’artistes », en compagnie de l’ouvrage à paraître au printemps 1944 de Georges Rouault, Soliloques. Le 23 mars 1942, lorsque Uhler demande à Jouvet un nouveau texte, il envisage de l’inclure dans une collection sans lien direct avec le théâtre, intitulée « Images du temps » (voir ci-dessus, complément 3, lettre 17). Il faut attendre les années 1945 à 1953 pour que les éditions accueillent des collections spécifiquement consacrées au théâtre avec l’édition des œuvres théâtrales complètes d’André Gide, de Jean Giraudoux, ainsi que de quelques pièces de Henry de Montherlant[133].
Dans la bibliographie fournie ci-dessous, la date indiquée entre parenthèses est celle de l’achevé d’imprimer. Le tirage inclut en principe les exemplaires qui ne sont pas hors commerce, généralement numérotés au moyen de chiffres arabes. Les livres ont été imprimés sur les presses de Henri Messeiller à Neuchâtel, à l’exception de Paysages pour douze fables de Jean de La Fontaine (Presses Orell-Füssli S.A. à Zurich), du traité de Sabbattini (idem), possiblement de Aventures d’Arthur Gordon Pym (l’imprimeur n’est pas indiqué), de l’étude de Claude Roulet (Presses d’Albert Kundig à Genève) et de la pièce de Jean Giraudoux (idem).
1941 (s. d., env. mars[134]). Marcel North (ill.), Paysages pour douze fables de Jean de La Fontaine, 50 exemplaires.
1941 (17.05). Henry de Montherlant, La Paix dans la Guerre, 660 exemplaires.
1941 (31.10). Jean Giono, Triomphe de la vie, 840 exemplaires.
1941 (15.12). Pierre Jean Jouve, Porche à la Nuit des Saints, Marcel Raymond (préface), 660 exemplaires.
1942 (15.02). Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Louis Jouvet (préface), Mari[e] et Renée Canavaggia (trad.), 1060 exemplaires.
1942 (s. d., env. décembre[135]). Edgar A. Poe, Aventures d’Arthur Gordon Pym, Charles Baudelaire (trad.), Marcel North (ill.), 545 exemplaires.
1942 (05.12), Benjamin Constant, De l’esprit de conquête, 1500 exemplaires.
1942 (18.12). Henri Guillemin, Une Histoire de l’autre monde, André Rosselet (ill.), 1520 exemplaires.
1943 (24.03). Charles Ferdinand Ramuz, Noces et autres histoires d’après le texte russe de Igor Strawinsky, Théodore Starwinsky (ill.), 997 exemplaires.
1943 (15.09). Louis Aragon, En français dans le texte, coll. « Ides poétiques », 1500 exemplaires.
1943 (30.09). Pierre Seghers, Le Chien de pique, coll. « Ides poétiques », 1050 exemplaires.
1943 (15.10). Loys Masson, Chroniques de la grande nuit, coll. « Ides poétiques », 1050 exemplaires.
1943 (10.11). Pierre Jean Jouve, Défense et Illustration, 835 exemplaires.
1943 (19.11). Jean-Pierre Porret, Fragment d’une autre histoire, 1000 exemplaires.
1943 (30.11 et 08.12 pour le fac-similé). Claude Roulet, Élucidation du poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, joint le poème reproduit en fac-similé d’après l’édition de la N.R.F., 1650 exemplaires.
1943 (01.12). Agrippa d’Aubigné, Prose, Marcel Raymond (éd.), 1000 exemplaires.
1943 (01.12). Agrippa d’Aubigné, Poésie, Marcel Raymond (éd.), 1000 exemplaires.
1943 (s. d.[136]). Jean Giraudoux, Sodome et Gomorrhe, 3100 exemplaires.
Notes
[1] Les interventions concernent des inversions de caractères (« motuers » corrigé en « moteurs »), des caractères manquants (« ensigné » corrigé en « enseigné », « c’est à dire » corrigé en « c’est-à-dire »), des caractères parasites (« ounignoble » corrigé en « ou ignoble »), des erreurs de frappe ou d’orthographe (« vois » corrigé en « voix », « brace » corrigé en « brave », « panorame » corrigé en « panorama », « élizabéthain » corrigé en « élisabéthain », « Cerlio » corrigé en « Serlio », « PALIADIO » corrigé en « PALLADIO », « Stanilaski » – corrigé sur le feuillet en « Stanislaski » – corrigé en « Stanislavski ») qui pourraient parfois relever de la licence (« poête » corrigé en « poète »), une accentuation lacunaire (« desespérement » corrigé en « désespérément »), des problèmes d’accord (« je vous dire » corrigé en « je vous dis », « si j’en avoir le loisir » corrigé en « si j’en avais le loisir », « me dispenser un pauvre homme » corrigé en « dispenser un pauvre homme »), l’accentuation des capitales (« Ecole » transcrit en « École ») et les ligatures (« coeur » transcrit en « cœur »). Dans certains cas, la correction ou l’intervention jugée la plus appropriée a été faite (« le principe mécaniques » corrigé en « le principe mécanique », « les louanges que j’ai pu décerner aux machiniste » corrigé en « les louanges que j’ai pu décerner aux machinistes », « ses incidents » corrigé en « ces incidents »). La graphie du nom de Sabbattini, qui peut varier sur un même feuillet (complément 3, lettre 10), a été conservée. Ce qui n’a pas été identifié à des coquilles manifestes est retranscrit tel quel (« Erlin » pour « Herlin », « grand’père » pour « grand-père »).
[2] Ce protocole éditorial s’inspire de ceux qu’a proposés Stéphanie Cudré-Mauroux au fil de ses travaux d’édition de correspondances, par exemple dans Stéphanie Cudré-Mauroux, « Charles-Albert Cingria – Georges Borgeaud : « Une amitié turbulente » », dans Stéphanie Cudré-Mauroux (dir.), Georges Borgeaud, s. l., La Bibliothèque des Arts, 2008, p. 31-96.
[3] André Delhay, « Une conférence de M. Jouvet sur la machinerie théâtrale », L’Ère nouvelle, 21e année, no 7384, 24.04.1938, p. 1.
[4] Louis Jouvet, « Découverte de Sabbattini », dans Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942, p. XVII-XX, XX-XXIII et XXII-XXX, désormais abrégé « DdS ».
[5] LJ-D-14 (4), f. 1-10, doc. 31-40. L’extrait en question est cité dans l’article dont ce dossier est le complément.
[6] Juliette Bertrand, « Appendice III », dans Sophie Wilma Holsboer, L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français de 1600 à 1657, Paris, Droz, 1933, p. 288-319.
[7] DdS, p. XXXIV.
[8] Les conférences de Marianne, un journal hebdomadaire politique et littéraire publié de 1932 à 1940, consistent souvent en des visites accompagnées de conférences dans des lieux tels que l’Hôpital Boucicaut et le musée Letuelle (27.03.1938), le Musée Cluny (03.04.1938), le zoo de Vincennes (10.04.1938) ou le musée des Arts décoratifs (08.05.1938). Le contenu de la conférence du 23 avril, qui a lieu au Théâtre de l’Athénée, est annoncé comme suit : « Louis Jouvet / présente sa nouvelle pièce / « Les Corsaires » / Mise en scène, coulisses, montage, etc. » (Marianne, 6e année, no 287, 20.04.1938, p. 13).
[9] Décrivant son expérience parisienne à Claire, Saint-Preux écrit : « On m’a offert plusieurs fois de me les [les machines] montrer ; mais je n’ai jamais été curieux de voir comment on fait de petites choses avec de grands efforts » (Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, Paris, Flammarion, 2018, partie 2, lettre 23, p. 343). Dans la préface, Jouvet attribue également la proposition à Rousseau et cite approximativement le texte, notamment en inversant les termes sur lesquels s’appliquent les adjectifs : « Jean-Jacques Rousseau, à qui l’on proposait la visite d’une scène d’opéra, répondit « qu’il ne désirait pas connaître les petits moyens avec lesquels on fait de si grands effets ». » (DdS, p. XIX).
[10] Le Corsaire, pièce de Marcel Achard représentée pour la première fois en répétition générale le 24 mars 1938.
[11] La lettre de Saint-Preux citée plus haut a peut-être contribué à véhiculer un tel imaginaire : « La mer agitée est composée de longues lanternes angulaires de toile ou de carton bleu, qu’on enfile à des broches parallèles, et qu’on fait tourner par des polissons » (Jean-Jacques Rousseau, op. cit., partie 2, lettre 23, p. 342). Quant à Georges Courteline (1858-1929), il a notamment décrit l’agitation des dessous du théâtre dans « Le chevalier Hanneton » (L’Illustre Piégelé, Paris, Albin Michel, [1904], p. 34-38).
[12] Tom Tit, pseudonyme d’Arthur Good (1853-1928) et nom au moyen duquel on a désigné ses articles ou ouvrages La Science amusante, dans lesquels sont décrites des expériences ludiques ou scientifiques. Dans la préface, Jouvet ne donne pas de référence explicite à ces « recettes qui ont l’air écrites pour l’amusement des enfants » ou « manuels saugrenus, élaborés pour faire, en passe-temps, cent jeux divers avec un paquet de cartes ou le contenu d’une boîte d’allumettes » (DdS, p. XXXII).
[13] Le Théâtre Pigalle a été financé par Henri de Rothschild et est inauguré en 1929. La scène est « formée par quatre énormes ascenseurs dont chacun est lui-même une scène de 13 mètres sur 9 » (René Lara, « Le Théâtre Pigalle », dans Les entr’actes de Pigalle, no 1, 10.1929, s. p). Jouvet a assuré la direction de ce théâtre de 1930 à 1932. Voir Philippe Marcerou, « Le Théâtre Pigalle : Vie et mort d’un théâtre impossible (1929-1948) », Revue d’Histoire du Théâtre, no 262, 2014, p. 177-185.
[14] Jouvet reprend la tripartition qui se trouve dans le Littré et qui apparaît dans des notes préparatoires : « À la fin du XIXème siècle, la machinerie n’est plus employée qu’à l’Opéra et dans les théâtres de féerie. Sur les autres scènes (et actuellement sur la plupart des nôtres) le rôle du machiniste est réduit à celui de manœuvre. Même si l’on ignore comment se fait ou se plante un décor aujourd’hui. Il suffit de comparer les définitions que donnent du mot le Littré et le Larousse pour être édifié : / LITTRÉ : Celui qui invente, conduit ou construit des machines… Celui qui s’occupe de l’arrangement des décorations et de tout ce qui sert à l’illusion de la scène. / le LAROUSSE DU XXème SIÈCLE : Celui qui plante les décors. » (LJ-D-14 (4), doc. 42).
[15] Il existe une version plus détaillée de cette description dans LJ-D-14 (4), doc. 31-40. Sur les ordres d’architecture dramatique, voir Sandrine Dubouilh, « Scénographie et « mystère du théâtre » », dans Ève Mascarau et Jean-Louis Besson (dir.), Louis Jouvet : Artisan de la scène, penseur du théâtre, Montpellier, Deuxième époque, 2018, p. 75-78. Ces ordres seront ramenés à quatre dans la préface (l’ordre grec et romain est réduit à l’ordre grec ; l’ordre médiéval est ajouté). Dans ce qui ressemble à des brouillons où Jouvet fait le plan de sa présentation, cinq types de machinerie sont envisagés : « Machinerie dans le théâtre grec / Machinerie dans le théâtre romain / Machinerie au Moyen-Age / Machinerie à l’époque de Shakespeare, / enfin la création du théâtre italien » (LJ-D-14 (4), f. 2, doc. 30). On trouve ce type de division près de vingt ans auparavant, dans une lettre à Jacques Copeau du 26 avril 1919 où Jouvet écrit être « absolument hanté par la forme de la salle » et propose une classification comprenant l’« hémicycle antique », la « transition shakespearienne », la « forme en fer à cheval – italienne » et la « forme rectangulaire moderne » (Lettre de Jouvet à Copeau, 26.04.1919, dans Jacques Copeau, Louis Jouvet, Correspondance : 1911-1949, Olivier Rony (éd.), Paris, Gallimard, 2013, p. 347).
[16] La conférence est donnée au Théâtre de l’Athénée, un théâtre à l’italienne que Jouvet dirige à partir de 1934.
[17] Expression de Théodore Lachèz, notamment employée dans « Complément à la préface de 1848 », dans Acoustique et optique des salles de réunions, Paris, chez l’auteur, 1879, p. XVII. Jouvet reprend l’expression dans DdS, p. XXX.
[18] Jouvet en a traité plus longuement dans l’article « L’apport de l’électricité dans la mise en scène au théâtre et au music-hall », dans L’Homme, l’électricité, la vie, Paris, Éditions Arts et métiers graphiques, 1937, p. 37-44.
[19] Il s’agit des changements de décor de la pièce Le Corsaire, dont on peut voir des dessins et photographies dans « Documents biographiques », Revue de la Société d’Histoire du Théâtre, no 13, 1952, p. 66-67.
[20] DdS, p. LIV.
[21] DdS, p. XXXIV.
[22] Des occurrences de son nom apparaissent dans les reprises de la préface, ainsi que dans quatre autres textes : « Le théâtral et le dramatique » (Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. 2, « Pratique du théâtre », Marc Véron et Jean-Louis Besson (éd.), Paris, Garnier, 2022, p. 37), « La scène, manifestation élémentaire du dramatique » (ibid., p. 69, 70, 73), « Le machiniste » (ibid., p. 84-85) et « Décor » (ibid., p. 101-102). Je n’ai identifié qu’un seul autre article non issu de la préface où il est question de Sabbattini : Louis Jouvet, « L’apport de l’électricité dans la mise en scène au théâtre et au music-hall », dans L’Homme, l’électricité, la vie, Paris, Éditions Arts et métiers graphiques, 1937, p. 38.
[23] Il y a des différences de retours à la ligne, mises en italiques, coupes ainsi que des variantes.
[24] Sur les problèmes que présente l’œuvre éditée de Jouvet ainsi que sur l’écart entre les archives et les éditions, voir : Ève Mascarau, « Jouvet au Conservatoire », dans Ève Mascarau et Jean-Louis Besson (dir.), Louis Jouvet : Artisan de la scène, penseur du théâtre, Montpellier, Deuxième époque, 2018, p. 339-352 et Ève Mascarau, Les Cours de Louis Jouvet au Conservatoire et le Personnage de théâtre, Montpellier, Deuxième époque, 2019, p. 24-31 et 49, n. 104. Dans l’édition de 2022, les liens existant avec les éditions antérieures des textes édités ne sont pas systématiquement indiqués ; on peut ainsi se demander si les textes proposés reposent sur les mêmes manuscrits que les textes déjà édités ou s’ils correspondent à une autre version de ces textes.
[25] Il en est de même des textes de L’Art du théâtre intitulés « Le machiniste » (t. 2, p. 84-85) et « Décor » (t. 2, p. 100-102). L’Art du théâtre contient également deux occurrences du nom de Sabbattini dans un texte intitulé « Le théâtral et le dramatique » (t. 2, p. 37), un texte qui paraît moins directement lié à la rédaction de la préface.
[26] En 1933, Jouvet écrit : « Je rêve parfois que, à l’instar de Cuvier, je pourrai, quelque jour, étudier l’art théâtral à partir de son architecture, retrouver la fonction Eschylienne, grâce au squelette de Dionysos ou d’Epidaure, celle de Shakespeare dans les traces de cet animal disparu qu’était le théâtre du Globe, celle de Molière dans ce Versailles où il fut joué, bref, faire jaillir d’une pierre comme d’une vertèbre, le grand corps vivant d’un mystère passé. » (Louis Jouvet, « À l’instar de Cuvier… », Cahiers du Sud, 06-07.1933, p. 91-92). Dans des notes plus tardives, il est revenu à cette idée : « L’édifice est un squelette, comme ceux que Cuvier identifiait et recomposait » (Louis Jouvet, « Faire du théâtre, c’est confronter son humanité » [1941 ou 1942], dans L’Art du théâtre, t. 2, op. cit., p. 437). Le nom de Cuvier a été associé à Sabbattini dans cette note : « Par Sabbattini, on comprend l’esprit d’une représentation grecque, les mystères du Moyen-Âge, le théâtre de Shakespeare et le théâtre classique. / On peut les réimaginer, les réinventer comme faisait Cuvier » (Louis Jouvet, « Décor », dans L’Art du théâtre, t. 2, op. cit., p. 102).
[27] Jouvet n’en traite pas dans la préface. Il s’y est notamment essayé dans « Tradition et traditions », dans Témoignages sur le théâtre, op. cit., p. 163-165. Voir aussi : « Convention et tradition » (Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. 1, « Le métier de comédien », Marc Véron et Jean-Louis Besson (éd.), Paris, Garnier, 2022, p. 202) et « La tradition, c’est la culture de la convention » (ibid., p. 204).
[28] Jouvet précisera, dans sa conférence de septembre 1941 et dans la préface au traité de Sabbattini, qu’il s’agit de La Métaphysique là où l’on se serait attendu à La Poétique.
[29] Les personnes auxquelles Jouvet fait allusion restent à déterminer : dans le Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre d’Arthur Pougin (Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885), il n’est pas question d’anciens capitaines du génie en retraite, ni de colonels d’artillerie. On trouve néanmoins un auteur présenté comme un colonel, le colonel Grobert pour De l’exécution dramatique, considérée dans ses rapports avec le matériel de la salle et de la scène, Paris, F. Schoell, 1809.
[30] Les éditions fondées par Félix Alcan en 1883 deviennent les Presses universitaires de France lors d’une fusion en 1939. La maison d’édition avait alors occupé une place de choix parmi les éditeurs de philosophie, de sociologie et de psychologie. Je n’ai pas réussi à déterminer si Jouvet vise des auteurs particuliers. Il pourrait penser au psychologue Alfred Binet, qui a écrit des « Réflexions sur le paradoxe de Diderot » (L’Année psychologique, vol. 3, 1897, p. 279-295) et qui sera cité dans la première partie de la thèse d’André Bonnichon, La Psychologie du comédien, Paris, Mercure de France, 1942. Dans ce paragraphe et ailleurs, Jouvet tend à évaluer les discours sur le théâtre et sur son histoire au regard de la fonction des personnes qui les énoncent et regrette que les gens de métier n’y trouvent pas toujours leur compte. Il a envisagé un changement prochain de situation : « Jusqu’aujourd’hui, le savant et le professionnel en matière de théâtre ont poursuivi leur tâche séparément, chacun s’enfermant dans son domaine, l’acteur travaillant sur la scène […], les érudits et les savants s’attachant uniquement à une culture développée des textes […] Mais aujourd’hui, il nous semble, à nous gens de théâtre […] que les choses ont changé et que, d’un côté et de l’autre, on a pris conscience de l’isolement où chacun se trouvait. […] Bientôt sans doute nous verrons les premiers travaux de cette science expérimentale du théâtre qui sera le résultat de l’union des théoriciens et des praticiens » (Louis Jouvet, « De la convention théâtrale », Bulletin de la Société des Historiens du Théâtre, 7e année, no 1, 1939, p. 55).
[31] Voir plus loin, f. 8 et n. 41.
[32] Les noms de ces trois architectes apparaissent dans des lignes que Jouvet consacre à l’ordre italien dans des notes préparatoires à la causerie de 1938 (LJ-D-14 (4), f. 9-10, doc. 39-40) et citées dans l’article dont ce dossier est le complément.
[33] Laurent Mahelot et Michel Laurent, Mémoire pour la décoration des pièces qui se représentent par les Comédiens du Roi. Ce manuscrit du dix-septième siècle a été édité plusieurs fois au vingtième siècle.
. Jouvet pouvait connaître ces éditions : La mise en scène à Paris au XVIIe siècle : Mémoire de Laurent Mahelot et Michel Laurent, Émile Dacier (éd.), Paris, s. l., 1901 et Le Mémoire de Mahelot, Laurent et d’autres décorateurs de l’hôtel de Bourgogne et de la Comédie-Française au XVIIe siècle, Henry Carrington Lancaster (éd.), Paris, Champion, 1920. Le texte fait notamment partie de la documentation rassemblée par Jouvet pour sa mise en scène de l’Illusion comique en 1937. L’identification d’un décor à Mélite de Corneille dans la préface de Jouvet (DdS, p. XXVI) suggère que celui-ci n’avait pas accordé d’attention particulière aux recherches de Lancaster sur le sujet (Henry Carrington Lancaster, « Introduction », dans Le Mémoire de Mahelot, Laurent et d’autres décorateurs…, op. cit., p. 21-25).
[34] Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, publié à titre posthume dès 1830.
[35] Johann Wolfgang von Goethe, Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister, paru en 1795-1796 et traduit en français dès 1802.
[36] Charles Garnier, Le Théâtre, Paris, Hachette, 1871 ou Charles Garnier, Le Nouvel Opéra de Paris, vol. 1 et 2, Paris, Ducher et Cie, 1878 et 1881.
[37] Allusion probable à Georges Moynet, La Machinerie théâtrale : Trucs et décors, Paris, Librairie illustrée, 1893, à moins que Jouvet ne se réfère à la publication du père, J. Moynet, L’Envers du théâtre : Machines et décorations, Paris, Hachette, 1873.
[38] Dans son livre, l’Abbé d’Aubignac présente la pratique comme la mise en application de ce qui, dans d’autres traités, prend la forme de maximes générales constituant la théorie du théâtre (Abbé d’Aubignac, « De ce qu’il faut entendre par Pratique du Théâtre » (I, 3), dans La Pratique du théâtre, Hélène Baby (éd.), Paris, Champion, 2011, p. 59). Dans sa préface, Jouvet prône une pratique qui ne découlerait pas de théories et qui résulterait d’une expérience acquise sur le terrain.
[39] Ces deux histoires sont rapportées à la fin de la préface (DdS, p. LIII-LIV). Voir aussi : Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. 2, op. cit., p. 73 et 444.
[40] Une lettre de Jouvet à Uhler du 7 mars 1946 conservée à Neuchâtel (FUHL-102-1.6), sans lien direct (sinon monétaire) avec le traité de Sabbattini n’est pas reproduite ici. Jouvet écrit qu’il est heureux d’avoir revu Uhler, tout comme du fait que René Thomas-Coële, un collaborateur de Louis Jouvet, ait pu faire sa connaissance. Il est surtout question de Charlotte Delbo (1913-1985), qui a suivi la troupe en tournée en tant que secrétaire jusqu’à l’automne 1941, qui sera déportée en 1943, et qui, en mars 1946, séjourne en Suisse à la pension Hortensia. Jouvet demande à Uhler de la soutenir financièrement en cas de besoin. Sur ce sujet, voir Violaine Gelly et Paul Gradvohl, Charlotte Delbo, Paris, Fayard, 2013, p. 205, ainsi que Ghislaine Dunant, Charlotte Delbo : La vie retrouvée, Paris, Grasset & Fasquelle, 2016, p. 99-101. Il est possible que des lettres de Uhler à Jouvet postérieures à l’édition du traité de Sabbattini soient conservées dans le fonds parisien au sein de lots d’archives qui ont fait l’objet d’un catalogage où tous les expéditeurs ne sont pas systématiquement signalés.
[41] Michel Schlup, « Fred Uhler : Éditeur (1908-1982) », dans Michel Schlup (dir.), Bibliographies neuchâteloises, t. 5, Hauterive, Éditions Gilles Attinger, 2008, p. 309.
[42] André Gide regrette de n’avoir pas de texte inédit à confier à Uhler (Lettre de André Gide à Fred Uhler (17.02.1941), dans André Gide et son éditeur suisse : Correspondance avec Richard Heyd (1930-1950), Pierre Masson et Peter Schnyder (éd.), Paris, Gallimard, 2022, p. 56). Jean Giono fait partie des auteurs édités par Uhler en 1941 et a été contacté par l’éditeur en janvier 1941 (Pierre Citron, Giono : 1895-1970, Paris, Seuil, 1990, p. 339).
[43] Simon Roth et François Vallotton, « L’édition en Suisse romande de 1920 à 1970 », dans Roger Francillon (dir.), Histoire de la littérature en Suisse romande, t. 3, Lausanne, Payot, 1998, p. 30-36.
[44] Ibid., p. 30.
[45] Jouvet n’avait alors publié qu’un livre, Réflexions du comédien (1938). Sur les articles de Jouvet, voir la bibliographie de Paul-Louis Mignon, « Bibliographie », dans Louis Jouvet, coll. « Qui êtes-vous ? », Lyon, La Manufacture, 1988, p. 288-308. Jean-Louis Besson et Marc Véron expliquent la parution de 1938 en écrivant néanmoins que « sans conteste possible, le comédien est désormais [dès 1935] reconnaissable à son style d’écrivain » (Jean-Louis Besson et Marc Véron, « Préface des éditeurs », dans Louis Jouvet, L’Art du théâtre, op. cit., p. 15).
[46] Louis Jouvet, Prestiges et perspectives du théâtre français : Quatre ans de tournée en Amérique latine, Paris, Gallimard, 1945, p. 16.
[47] Denis Rolland, Louis Jouvet et le théâtre de l’Athénée : « Promeneurs de rêves » en guerre de la France au Brésil, Paris, L’Harmattan, 2000. Rolland arrête son enquête en juillet 1941 (ibid., p. 413). D’autres sources directes et indirectes relatives à la mémoire de la tournée sont fournies dans ibid., p. 419-420.
[48] Le plus souvent, ces informations paraissent être issues des archives se rapportant au voyage au Brésil, et en particulier du journal de la troupe Louis Jouvet (LJ-D-79 (5)). Rolland n’a pas porté d’attention particulière à la question de l’édition du traité italien (Denis Rolland, op. cit., p. 174, 214).
[49] Lettre de Claude Guinot à Fred Uhler (05.06.1942), 4-COL-352 (6). Claude Guinot a une adresse à Castelnau-le-Lez et assure la transmission du courrier de Jeanne Mathieu (1911-2003), alors secrétaire de Louis Jouvet. Odette Lieutier crée sa maison d’édition à Paris en février 1942 (Pascal Fouché, L’Édition française sous l’Occupation, t. 2, Paris, Bibliothèque de Littérature française contemporaine, 1987, p. 57) et publie notamment, en 1943, le Traité de scénographie de Pierre Sonrel, qui contient un commentaire reposant sur la traduction française de l’édition de 1942.
[50] Marthe Herlin-Besson (1907-1993), Renée Herlin à l’État civil, est collaboratrice et directrice de scène de Jouvet et sera responsable du fonds Louis Jouvet à la Bibliothèque nationale de France (Denis Rolland, op. cit., p. 270).
[51] Il s’agit probablement de Marie Canavaggia (1896-1976), traductrice d’auteurs anglais, américains et italiens et importante collaboratrice de Louis-Ferdinand Céline. Elle vit à Paris avec sa sœur Renée Canavaggia (1902-1996), astrophysicienne, qui a également contribué à la traduction du traité de Sabbattini. Jeanne Gautier, une nièce des sœurs Canavaggia, suggère que c’est en 1939, par l’intermédiaire de Giraudoux, lors de la création d’Ondine, qu’elles font la connaissance de Jouvet (Renée Canavaggia et Jeanne Gautier, « Marie Canavaggia 1896-1976 : Éléments biographiques », dans Marie Canavaggia, Tusson, Du Lérot, 2003, p. 20). Cette information est partiellement étayée par un billet du fonds Louis Jouvet sur lequel Mademoiselle Canavaggia est présentée comme « Traductrice de M. Giraudoux » (LJ-Mn-79(42)). Cette mention tient à ce que, en 1938, Giraudoux avait préfacé la traduction de Marie du roman d’Evelyn Waugh Diablerie (Louis-Ferdinand Céline, Lettres à Marie Canavaggia : Index analytique des noms de personnes, des toponymes et des titres, Jean Paul Louis (éd.), Tusson, Du Lérot, 1995, p. 122, entrée Giraudoux). Quelques années avant ces événements, une première prise de contact avait eu lieu : en 1930, Marie Canavaggia avait soumis à Jouvet une traduction de L’Histoire des Rois Mages de Guglielmo Zorzi, en lui suggérant de l’exploiter (LJ-Mn-79 (41)).
[52] Billet de Marthe Herlin à Louis Jouvet (02.06.1939), LJ-Mn-79 (42), doc. 2. Un autre billet de Herlin à Jouvet portant la date du 13 juin 1939 sur son verso fait part d’un appel téléphonique de Canavaggia, qui ne connaît personne pour enseigner l’italien à Jouvet, mais qui suggère de lui envoyer un jeune normalien avec qui il pourra traduire deux chapitres du traité de Sabbattini qu’elle a choisis, sur l’équipement de la mer et sur l’apparition de fantômes. Le billet est annoté d’un « oui » dans la marge (Billet de Marthe Herlin à Louis Jouvet, daté du 13.06.1939 au verso, LJ-Mn-79 (42), doc. 1).
[53] Lettre de Renée Canavaggia à Marthe Herlin (26.11.1939), LJ-Mn-79 (42). Cette traduction est peut-être celle qui est conservée sous la cote LJ-D-69 (11).
[54] Lettre de Marthe Herlin à Renée Canavaggia (28.11.1939), LJ-Mn-79 (42), doc. 5.
[55] Il est question des activités de Jouvet et de son théâtre de septembre 1939 à décembre 1940 dans Denis Rolland, op. cit., p. 68-91. Je n’ai pas trouvé d’informations sur les éventuelles personnes de contact de Jouvet en Italie.
[56] Lettre de Jean Flory à Louis Jouvet (06.01.1939), LJ-Mn-20 et une note non datée sur le dépouillement d’ouvrages et de documents pour « l’Etude & la Bibliographie des LIEUX DRAMATIQUES » (LJ-Mn-20). Jacqueline Gamond, dans une lettre de vœux à Jouvet du 14 janvier 1940, écrit souhaiter arriver au terme d’une interminable bibliographie et, dans une lettre du 15 février 1940, constate que la documentation sur l’architecture théâtrale et la machinerie continue à s’accumuler (LJ-Mn-87 (3)). Il se pourrait que ces recherches s’inscrivent au sein d’un projet plus large d’élaboration d’un livre entièrement dédié à l’architecture théâtrale et aux lieux dramatiques, notamment évoqué par Sandrine Dubouilh, art. cit., p. 75.
[57] En mars 1941, Jouvet cherche à faire prolonger son autorisation de séjour en zone non occupée et craint qu’un retour à Paris ne réduise les chances d’obtenir une nouvelle autorisation (Denis Rolland, op. cit., p. 298-300). Charlotte Delbo est envoyée à Paris, mais ses démarches restent sans succès. Elle quitte Paris pour retrouver la troupe à Lyon le 20 mars en traversant clandestinement la ligne de démarcation (Ghislaine Dunant, op. cit., p. 42-44, ainsi que Violaine Gelly et Paul Gradvohl, op. cit., p. 61).
[58] DdS, p. XXXV.
[59] Jean Kiehl (1902-1968), enseignant et pionnier du théâtre amateur en Suisse romande.
[60] Jean-Mario Bertschy (1911-2002), cinéaste, producteur et acteur. Il sert d’intermédiaire avec la société qui produit le film inachevé L’École des femmes de Max Ophüls, avec Louis Jouvet dans le rôle d’Arnolphe. Le tournage commence en janvier 1941 et est interrompu le même mois (Denis Rolland, op. cit., p. 195-205).
[61] Jouvet avait déjà joué dans plusieurs pièces de Giraudoux : Siegfried en 1928 et 1931, Amphitryon 38 en 1929, Intermezzo en 1933, La guerre de Troie n’aura pas lieu et Supplément au voyage de Cook en 1935, Electre et L’Impromptu de Paris en 1937 et Ondine en 1939. Il jouera dans L’Apollon de Marsac en 1942 et dans La Folle de Chaillot en 1945.
[62] Il s’agit d’une pièce de théâtre et d’un roman parus en 1939 qui figurent parmi les dernières publications de Giraudoux, également auteur de l’essai Pleins pouvoirs, paru la même année.
[63] La troupe de Jouvet entre en Suisse le 3 janvier au matin par Genève et arrive à Bâle le même jour pour commencer le tournage du film L’École des femmes (Denis Rolland, op. cit., p. 195-205). Le tournage sera finalement déplacé à Genève, où Jouvet et une partie de sa troupe se rendent le 14 et où le reste de sa troupe le rejoint le 16. Le 24 janvier, l’interruption du tournage du film est décidée à la suite d’une réunion des actionnaires (LJ-D-79 (3)). La troupe donne des représentations à Genève du 16 au 26 janvier et une première tournée suisse commence (Ibid., p. 211-212).
[64] Un an plus tôt, en janvier 1940, Frédéric Uhler a été promu au grade de capitaine pour l’artillerie de campagne (« Promotions militaires », Feuille d’avis de Neuchâtel, 17.01.1940, p. 7). Des dessins de Marcel North gardent le souvenir d’un cours de répétition de février 1940 ayant duré trois semaines et durant lequel Frédéric, dit Fred Uhler, capitaine dans l’artillerie, est chargé de commander la batterie 9 (Michel Schlup, « En février 1940… », dans Marcel North, La Neuf, dessinée pour le capitaine Fred Uhler par Macel North sur trois alba, février 1940, s. l., 2009). Je n’ai pas pu déterminer la durée ni la nature des activités de Uhler au sein de l’armée en 1941.
[65] Ces deux paratextes figurent avant la reproduction de la lettre de Jouvet à son éditeur et la préface de Jouvet dans l’édition de 1942. Les autres paratextes – l’ode de Anton Francesco Tempestini à Honorato Visconti et l’imprimatur (« Aprobationes »), présents dans l’édition de 1638 et le fac-similé de 1926, ainsi que la lettre de Sabbattini à son protecteur dans l’édition de 1637, traduite en allemand en 1926 – ne sont pas intégrés à la traduction française.
[66] René Thomas-Coële, le secrétaire de Louis Jouvet, est peut-être impliqué dans l’envoi de l’un ou l’autre des textes nécessaires à l’édition de 1942. Il s’est souvenu que, au début de 1941, « Giraudoux aurait chargé Jouvet de remettre un texte pour l’impression à Fred Uhler en même temps que sa propre préface à Sabbattini » (Étienne Brunet, Wayne Ready, « Note sur le texte », dans Jean Giraudoux, Théâtre complet, Jacques Body (dir.), Paris, Gallimard, 1982, p. 1677, n. 1). La préface date de décembre 1941 et a directement été envoyée par Jouvet à Uhler (lettre 14). Si René Thomas-Coële a servi d’intermédiaire pour l’édition du traité de Sabbattini, il semble ainsi que ce soit plutôt pour un autre texte tel que la traduction ou les paratextes.
[67] L’ouvrage de 1942 sera imprimé à Zurich, sur les presses d’Orell Füssli Arts Graphiques S. A. Vers mars 1941, Uhler fait imprimer sa première publication, parue aux Ides de Mars, sur ces mêmes presses.
[68] Denis Rolland écrit : « Dès février 1941, les théâtres suisses demandèrent une nouvelle tournée à la troupe de Louis Jouvet […] [I]l est d’abord question d’Electre de Giraudoux […]. Assez vite cependant, Electre est abandonnée » (Denis Rolland, op. cit., p. 241-242).
[69] La deuxième tournée suisse commence à Genève, où la troupe joue Knock du 16 au 22 avril. Elle se poursuit à Neuchâtel du 23 au 25 avril, à Bâle le 26 avril, à Zurich du 27 au 29 avril, à Fribourg du 30 avril au 1er mai, à Berne le 2 mai, à La Chaux-de-Fonds les 3 et 4 mai, à Yverdon le 5 mai, à Bienne les 6 et 7 mai et se termine à Lausanne, où la troupe joue du 8 au 13 mai.
[70] Blaise Cendrars, L’Eubage : Aux antipodes de l’unité, Paris, Au Sans Pareil, 1926. Les raisons de la mention de ce livre ne sont pas connues. Jouvet et Cendrars (1887-1961) s’étaient notamment retrouvés à Aix-en-Provence l’année précédente, dans le contexte de l’exode de 1940 (Michèle Touret, « Cendrars et Jouvet, Aix-en-Provence 1940 », Feuilles de routes, no 45/46, 2006-2007, p. 148-151). Le 2 mai 1941, de Berne, Jouvet écrit à Cendrars afin de lui demander un mot de présentation de sa troupe pour une brochure de propagande destinée à l’Amérique latine (Lettre de Jouvet à Cendrars, 02.05.1941, LJ-Ms-153). Le 10 mai, Cendrars répond négativement à la demande (Lettre de Cendrars à Jouvet, 10.05.1941, LJ-Ms-153). Jouvet fait une demande similaire à l’écrivain Guy de Pourtalès (1881-1941), à qui il écrit le 2 mai et de qui il reçoit une réponse positive le 12 mai (Guy de Pourtalès, Correspondances III : 1930-1941, Doris Jakubec et Renaud Bouvier (éd.), Genève, Slatkine, 2014, p. 696-700).
[71] Le contrat, reproduit ci-dessous, stipule que Uhler a remis à Jouvet des échantillons lui permettant de se faire une idée du type de papier et de caractères prévus pour l’impression.
[72] Le titre est traduit de manière plus littérale dans la dédicace, dont Uhler accuse réception le 27 février 1941 : « Pratique de la fabrication des scènes et machines de théâtre » (Pietro dei Paoli, « Très illustre… », dans Nicola Sabbattini, op. cit., p. IX).
[73] Raymone Duchâteau (1896-1986), dite Raymone, comédienne et compagne de Blaise Cendrars. En 1941, elle fait partie de la troupe de Jouvet.
[74] Le 7 mai, Jean Giraudoux écrit à son fils Jean-Pierre qu’il a fait plusieurs voyages à Lyon pour retravailler les pièces que Jouvet jouera en Amérique du Sud (Jean Giraudoux, Lettres, Jacques Body (éd.), Paris, Klincksieck, 1975, p. 278).
[75] Jean Giraudoux, Littérature, Paris, Grasset, 1941.
[76] Uhler fera imprimer Sodome et Gomorrhe de Giraudoux en 1943. Après la mort de l’auteur, Uhler publiera Le Théâtre complet de Jean Giraudoux en 16 volumes (Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1945-1953) ainsi que Armistice à Bordeaux (Neuchâtel, Ides et Calendes, 1945) et Visitations (Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1947).
[77] Le souhait de Jouvet a été respecté par Uhler. Ce n’est qu’à partir de la réimpression de 2015 que les noms des traductrices n’apparaissent plus sur la couverture.
[78] Le mardi 27 mai, la troupe quitte Lyon pour Lisbonne (Denis Rolland, op. cit., p. 310).
[79] La troupe joue à Rio de Janeiro du 7 au 25 juillet (Denis Rolland, op. cit., p. 360) et à São Paulo du 28 au 31 juillet (ibid., p. 369). Elle se trouve à Buenos Aires du 6 août au 15 septembre (« Documents biographiques », Revue de la Société d’Histoire du Théâtre, op. cit., p. 73).
[80] Camille Demangeat (chef-machiniste), Léon Deguilloux (chef-machiniste) et Marthe Herlin-Besson (directrice de la scène) font partie de la troupe en tournée en Amérique du Sud (Denis Rolland, op. cit., p. 270). Christian Bérard a dessiné de nouveaux costumes pour la première tournée sud-américaine, mais ne traverse pas l’Atlantique (Denis Rolland, op. cit., p. 284-285, 310). Pavel Tchélitcheff ne fait pas partie de la troupe en tournée en Amérique du Sud, mais est, comme Bérard, cité dans la préface de Jouvet (DdS, p. XLVII et LIII).
[81] Une version de cette lettre conservée dans le fonds Louis Jouvet contient l’ajout manuscrit : « Monsieur Anton G. Bragaglia » (LJ-D-69 (10)).
[82] Après un premier volume paru en 1931, la Bibliothèque de la Pléiade a notamment proposé une édition des œuvres complètes de Racine (1931) et de Molière (1932), ainsi que du théâtre complet de Corneille (1934) et de Shakespeare (1938). Les premiers volumes se caractérisaient généralement par un apparat critique limité et moins fidèle à l’idée de restituer les œuvres dans leur contexte historique qui pouvait caractériser la critique académique d’inspiration lansonienne d’alors qu’à la volonté de pratiquer ce qu’Albert Thibaudet a qualifié, dans Psychologie de la critique (1930), de « Critique des Maîtres » (Alice Kaplan et Philippe Roussin, « A Changing Idea of Literature: The Bibliothèque de la Pléiade », Yale French Studies, no 89, 1996, p. 244-249 et Joëlle Gleize et Philippe Roussin, « Métamorphose d’une bibliothèque », dans Joëlle Gleize et Philippe Roussin (dir.), La Bibliothèque de la Pléiade : Travail éditorial et valeur littéraire, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2009, p. 50-53).
[83] La troupe se rend le 7 octobre à Rio de Janeiro et devait initialement retourner en France. Finalement, elle ne rentrera pas, à l’exception de cinq membres : Alexandre Rignault, Raymone, Jacqueline Cheseaux, Charlotte Delbo et René Dalton (« Documents biographiques », Revue de la Société d’Histoire du Théâtre, no 13, 1952, p. 73-74 ; Jean-Marc Loubier, Louis Jouvet : Biographie, Paris, Ramsay, 1986, p. 268 ; Denis Rolland, op. cit., p. 303-305 ; LJ-D-79 (4)). Dans cette lettre de fin août, Jouvet, juste après avoir fait part de la possibilité qu’une lettre se perde, laisse penser à son destinataire suisse qu’il reviendra en Europe début octobre.
[84] La version non signée conservée dans le fonds Louis Jouvet contient : « avec les Confidences au Lecteur » (LJ-D-69 (10), doc. 5).
[85] Suzanne Mélinand (env. 1891-1985), infirmière et religieuse (« Avis mortuaires », Feuille d’avis de Neuchâtel, 01.04.1985, p. 6), fille du philosophe et psychologue français Camille Mélinand (1865-1951). Elle est la demi-sœur de Monique Mélinand (1916-2012), qui avait été engagée à l’Athénée en 1937, après une audition. Monique rejoint la troupe de Jouvet en Amérique du Sud en décembre 1941 et Jouvet aura ensuite une liaison avec elle jusqu’à ce qu’il meure en 1951 (Marc Véron et Jean-Louis Besson, dans L’Art du théâtre, t. 1, op. cit., p. 96, n. 19).
[86] « NLT » : Indication de service taxée employée pour les lettres-télégrammes de nuit entre les pays européen et les pays extra-européen.
[87] Le journal de la troupe de Jouvet contient l’entrée suivante pour le dimanche 14 décembre : « M. Jouvet porte les dernières corrections à la Préface, qui part à 18h sous pli recommandé, par avion (L.A.T.I.) à destination de M. Fred Uhler en Suisse » (LJ-D-79 (5)). LATI (Linee Aeree Transcontinentali Italiane) est le nom d’une compagnie aérienne transatlantique.
[88] Madeleine Ozeray se souviendra du moment où Jouvet termine la rédaction de sa préface : « Après chaque répétition, il travaillait à sa Préface de la « Pratique pour fabriquer les scènes du Théâtre de Sabbattini ». Il la termina devant la fenêtre ouverte sur les jardins de l’hôtel Gloria » (Madeleine Ozeray, À toujours, Monsieur Jouvet, Paris, Éditions Buchet / Chastel, 1966, p. 184). Le journal de la troupe témoigne également de la préparation de cette préface durant les mois de novembre et de décembre. On trouve ainsi cette entrée au 13 décembre : « Tous ces dix derniers jours, M. Jouvet se reposant sur A. Moreau du soin de faire répéter les acteurs, a travaillé quotidiennement à la préface qu’il écrit pour le livre de Sabbattini, il y a travaillé chaque journée, aidé par M. Herlin » (LJ-D-79 (5)).
[89] Un parcours d’une version du tapuscrit de la préface conservée dans le fonds Louis Jouvet suggère que les interventions de l’éditeur portent essentiellement sur la composition (retours à la ligne, caractères italiques…) ; les interventions les plus fortes semblent être les ajouts de renvois aux figures dans la partie intitulée « L’architecture dramatique » (DdS, p. XX-XXII).
[90] Anton Giulio Bragaglia, « Nicola Sabbattini », Urbino, Regio Istituto d’Arte per il Libro in Urbino, s. d., p. 3-69, tiré à part de Anton Giulio Bragaglia, « Nicola Sabbattini », dans Celebrazioni Marchigiane: Parte I. 16-31 Agosto 1934 – XII, Urbino, R. Istituto d’Arte per la Decorazione e la Illustrazione del Libro in Urbino, 1935, p. 421-487. Sous le titre de l’article, il est précisé qu’il s’agit d’un « discorso tenuto a Senigallia (Ancona), il 28 agosto 1934 – a. XII, in occasione delle Celebrazioni Marchigiane » (ibid., p. 421). Jacqueline Gamond, une collaboratrice de Jouvet qui fait des recherches pour lui, a pu accéder à un tiré-à-part de cette étude à laquelle elle consacre une fiche de lecture particulièrement détaillée et datée du 15 avril 1940 (LJ-D-69 (11), doc. 10). En raison de l’intérêt qu’elle présente, elle choisit d’en traduire de larges extraits qui s’étendent sur plus de quarante feuillets. Cette traduction (LJ-D-69 (11)), le résumé qui en a été fait (LJ-D-83 (8)), ainsi que le résumé du résumé constituent apparemment la source principale de Jouvet relativement aux informations biographiques qu’il fournit dans sa préface, et qui se trouvent dans la section « Qui était Sabbattini ? » (DdS, p. XVI-XVII). Jouvet reprend notamment les incertitudes concernant la naissance de l’auteur italien (ibid., p. 448), l’opposition entre les partisans des machines et les partisans de la comédie (ibid., p. 427), la possibilité que Sabbattini soit, plutôt que Andrea Sighizzi ou Sgizzi, à l’origine de la distribution des loges en rangées circulaires (ibid., p. 453-454), la mention d’une réimpression du traité en 1738 (ibid., p. 459-460) et la mort de Sabbattini le jour de Noël (ibid., p. 448). La différence quant à l’année de sa mort – Bragaglia la situe en 1654, Jouvet en 1653 – pourrait dépendre de leurs interprétations respectives d’une citation de Bragaglia et de la date à laquelle ils fixent le changement d’année. Il est possible que Jouvet emprunte également des propositions de Bragaglia à d’autres endroits de la préface, notamment lorsqu’il évoque une continuité entre Sabbattini et l’Encyclopédie (ibid., p. 462 et DdS, p. XXX).
[91] Gustave Cohen, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du Moyen Âge, Paris, Champion, 1926, planche I.
[92] Lucien Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, 5 volumes, Paris, Librairie de France, 1931-1934. Uhler ou ses collaborateurs insèrent six illustrations sans indiquer de source et sans reprendre les références les plus précises indiquées par Jouvet. Les illustrations de la préface semblent être issues de références en allemand telles que : Josef Durm, Handbuch der Architektur. Zweiter Teil. 1. Band: Die Baukunst der Griechen, 3e éd., Leipzig, Alfred Kröner Verlag, 1910, p. 460, fig. 414 pour le « Théâtre grec (Epidaure) » (DdS, p. xxi) ; Ernst Guhl et Wilhelm Koner, Das Leben der Griechen und Römer nach antiken Bildwerken dargestellt, 2e éd., Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1864, p. 507, fig. 437 pour le « Théâtre romain (Théâtre d’Hérode) » (DdS, p. XXII) ; Martin Hammitzsch, Der Moderne Theaterbau. I. Teil : Der höfische Theaterbau, Berlin, Ernst Wasmuth, 1906, p. 15, fig. 5 ; p. 57, fig. 32 et p. 69, fig. 38 pour le « Théâtre italien (Teatro Olimpico de Vicence) » (p. XIX), le « Théâtre élisabéthain (Le « Swan » à Londres) » (DdS, p. XXVIII) et le « Théâtre du XVIIIème siècle (Première Comédie Française) » (DdS, p. XXX). Le « Théâtre au moyen âge » (DdS, p. XXVI) est présenté dans une version relativement répandue qui se reconnaît à l’emploi de numéros généralement accompagnés d’une légende indiquant les lieux représentés.
[93] Le journal de la troupe contient les informations suivantes : « Mlle. Monique Mélinand comédienne, arrive aujourd’hui [mercredi 17 décembre] à Rio, par le « Bagé », venant de France. Elle est engagée dans la Troupe » (LJ-D-79 (5)). Voir aussi : Simone Dubreuilh, « Louis Jouvet est rentré à Paris avec une nouvelle partenaire », Feuille d’avis de Neuchâtel, 02.03.1945, p. 4.
[94] Un exemplaire de ce tiré à part est conservé à la BPUN : « « Découverte de Sabbattini » a paru en préface à l’édition de langue française de la « Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre ». Il en a été fait un tirage à part, limité à 15 exemplaires, soit 2 exemplaires sur Japon ancien numérotés de 1 à 2, 3 exemplaires sur Hollande van Gelder numérotés de 3 à 5 et 10 exemplaires sur vergé blanc numérotés de 6 à 15. »
[95] La troupe de Jouvet joue à Zurich les 11 et 12 février ainsi que du 27 au 29 avril 1941. Les archives gardent la trace d’une soirée avec Maurice Chevalier et Germaine Sablon dans cette ville le 11 févier 1941 (LJ-D-79 (3)). Voir aussi : Denis Rolland, op. cit., p. 204.
[96] Le 31 mars, Giraudoux écrit à son fils qu’il vient de faire une tournée de conférences en Suisse et qu’il a eu Jouvet au téléphone (Jean Giraudoux, Lettres, op. cit., p. 283 ; voir aussi : Jean Giraudoux et Louis Jouvet, Correspondance entre Jean Giraudoux et Louis Jouvet, Brett Dawson (éd.), Cahiers Jean Giraudoux, no 9, Paris, Grasset, p. 110, n. 1). En 1947, Uhler éditera le texte ou une partie du texte prononcé en Suisse par Giraudoux en février 1942 dans Visitations (Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes).
[97] Dans une lettre du 25 mars 1942, la secrétaire de Jouvet restée à Paris, Jeanne Mathieu, demande deux exemplaires du Sabbattini à Uhler (4-COL-352 (6)). Le 8 avril, Uhler lui écrit en lui demandant l’adresse des sœurs Canavaggia et de Pavel Tchelitcheff (4-COL-352 (6)). Le 4 mai, Claude Guinot écrit à Uhler à la demande de Mathieu pour lui indiquer l’adresse des sœurs Canavaggia, lui indiquer que Pavel Tchelitcheff se trouve à New York et lui demander si quelque chose est prévu concernant la diffusion du traité de Sabbattini en France occupée (4-COL-352 (6)). Le 13 mai, Uhler répond à Guinot tout en lui envoyant deux exemplaires hors commerce. Le 5 juin, Claude Guinot écrit avoir transmis les deux exemplaires aux sœurs Canavaggia et signale que Hachette n’a pas sorti le livre, malgré des placards l’annonçant. Il demande également s’il serait possible de fournir la librairie d’Odette Lieutier. Les échanges continuent jusqu’en septembre, notamment pour fournir Odette Lieutier et payer Uhler par l’intermédiaire de Pierre Seghers, à Avignon (4-COL-352 (6)). Le 21 juin, Marie Canavaggia remercie Jouvet pour les exemplaires et la mention (LJ-Ms-161, doc. 48)
[98] Collection à tirage limité lancée en 1921, interrompue en 1933 et reprise en 1945. La collection que pense lancer Uhler ne verra pas le jour, du moins pas sous ce nom.
[99] Suzanne Mélinand, voir lettre 10.
[100] DdS, p. XXXII.
[101] M. D., Vies des fameux architectes, Paris, Desure l’aîné, 1787.
[102] Marcel Schwob, Vies imaginaires, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1896.
[103] Sandrine Dubouilh, « Scénographie et « mystère du théâtre » », dans Ève Macarau et Jean-Louis Besson (dir.), Louis Jouvet : Artisan de la scène, penseur du théâtre, Montpellier, Deuxième époque, 2018, p. 73-75.
[104] Ibid., p. 74.
[105] DdS, p. XL.
[106] Cette « Histoire à propos de Sabbattini » se trouve dans le fonds Louis Jouvet au sein d’un lot de tapuscrits où se trouve de la documentation de tiers autour de Sabbattini contenant une traduction de l’étude de 1934 d’Anton G. Bragaglia « Nicola Sabbattini » par Jacqueline Gamond datée du 15 avril 1940 (doc. 10-53), plusieurs listes se rapportant à cette étude (bibliographie des ouvrages cités, liste des machinistes, décorateurs et architectes mentionnés, liste des pièces jouées au xviie siècle citées, liste d’acteurs) et d’une traduction partielle de la postface de 1926 de Willi Flemming (doc. 60-62) qui pourrait être celle que Renée Canavaggia transmet à Marthe Herlin le 26 novembre 1939 (LJ-Mn-79 (42)).
[107] La qualification de « grand sorcier » aurait, selon certaines sources, été attribuée au machiniste Giacomo Torelli (Francesco Milizia, Vie des architectes anciens et modernes, Jean Claude Pingeron (trad.), Paris, Claude-Antoine Jombert fils, 1771, p. 246). Jean de La Fontaine qualifie ce même Torelli de « magicien expert, & faiseur de miracles » (Lettre de La Fontaine à Maucroix, 22.08.1661, dans Jean de La Fontaine, Œuvres diverses, t. 3, Paris, Jean-Luc Nion, 1724, p. 299).
[108] « Au moment de faire apparaître l’enfer on ouvrira ladite ouverture […], on postera quatre hommes, lesquels devront être de bonnes gens, mettant zèle et honneur à bien faire » (Nicola Sabbattini, op. cit., II, 23, p. 105).
[109] « La théorie n’est point difficile mais plus facile encore est la pratique », (Nicola Sabbattini, op. cit., II, 57, p. 171).
[110] Réminiscence possible de Jacques-François-Louis Grobert : « Le défaut dominant du mécanisme théâtral actuel est le manque d’un espace latéral suffisant pour y préparer les décorations de toute espèce sans gêner sensiblement le mouvement des acteurs » (De l’exécution dramatique, considérée dans ses rapports avec le matériel de la salle et de la scène, Paris, F. Schoell, 1809, p. 203).
[111] On retrouve souvent la clausule « on aura fait tout ce qu’il fallait » (parfois complétée de « faire ») dans la traduction parue en 1942 : Nicola Sabbattini, op. cit. II, 15, p. 93 ; 20, p. 102 ; 38, p. 133 ; 42, p. 138 ; 44, p. 145, 51, p. 162 ; « ainsi aura-t-on fait tout ce qu’il fallait » (ibid., II, 10, p. 86 ; 13, p. 90 ; 25, p. 109 ; 31, p. 118 ; 39, p. 134 ; 41, p. 136 ; 53, p. 165).
[112] L’expression apparaît également dans la traduction de 1942 : « ainsi aura-t-on fait tout le nécessaire » (ibid., II, 29, p. 113), « faire tout le nécessaire », (ibid., II, 32, p. 121), « ainsi sera fait tout le nécessaire » (ibid., II, 50, p. 161).
[113] DdS, p. XVII – XVIII.
[114] Sophie Wilma Holsboer, L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français de 1600 à 1657, Paris, Droz, 1933, p. 160.
[115] Castil-Blaze, L’Opéra-italien de 1548 à 1856, Paris, Castil-Blaze, 1856, p. 77-78. D’autres sources mentionnent une telle édition : « Niccola Sabbatini, de Pesaro, imprima sa Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri en 1638, et une seconde édition parut en 1738 » (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, t. 6, Paris, Administration du Grand Dictionnaire, 1870, p. 255, entrée « Décoration »).
[116] « 780. Sabbatini, Nicola. Pratica di fabbricare scene, e macchine teatrali, ristampata da nuovo coll’ agiunta del secondo libro. Ravenna 1738 in 4. fig. » (Catalogo rationato dei libri d’arte et d’antichita posseduti dal conte Cicognara, Pise, Niccolò Capurro, 1821, p. 145). L’ouvrage numérisé est consultable via le site cicognara.org, où la notice du catalogue est reproduite telle quelle.
[117] Il se trouve, par exemple, dans Catalogus Libororum Bibliothecae Raphaelis Tricheti du Fresne, Paris, 1662.
[118] « Plusieurs habiles maîtres succédèrent à Peruzzi ; les plus célèbres sont les suivans : Sabattini, qui nous a laissé un petit traité fort curieux sur l’art de peindre et de construire les décorations théâtrales » (Giuseppe-Antonio Borgnis, Traité complet de mécanique appliquée aux arts, Paris, Bachelier, 1820, p. 274). L’information est reprise dans Jacques-Auguste Kaufman, Architectonographie des théâtres, Paris, L. Mathias, 1840, p. 14. On trouve également des mentions chez Joseph de Filippi au début des années 1860.
[119] Ludovic Celler [Louis Leclercq], Les Décors, les costumes et la mise en scène au XVIIe siècle, Paris, Liepmannssohn et Dufour, 1869, p. 47.
[120] Hermann Fritsche, « Vorwort », dans Molière, L’Avare, Hermann Fritsche (éd.), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886, p. IV.
[121] Georges Moynet, La Machinerie théâtrale : Trucs et décors, op. cit., p. 151.
[122] Henry Prunières, L’Opéra italien en France avant Lulli, Paris, Champion, 1913, p. 297, n. 2.
[123] Ulrike Hass, « Von der Schau-Bühne zur Architektur und über das Theater hinaus. Raumbildende Prozesse bei Sabbatini, Torelli, Pozzo und Appia », dans Norbert Otto Eke, Ulrike Hass et Irina Kaldrack (dir.), Bühne: Raumbildende Prozesse im Theater, Munich, Wilhelm Fink, 2014, p. 349, n. 7. Dans le livre de Prunières, on trouve tantôt « Sabattini » (op. cit., p. 6, 129), tantôt « Sabbattini » (ibid., p. 297, 410, 426).
[124] Willi Flemming, « Nachwort », dans Nicola Sabbattini, Anleitung Dekorationen und Theatermaschinen herzustellen, Willi Flemming (trad. et postface), Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen, 1926, p. 285. Flemming se réfère au Künstlerlexikon de Georg Kaspar Nagler (1801-1866).
[125] Le fac-similé est celui de l’édition de 1638, malgré l’année 1639 qui figure sur la couverture en allemand.
[126] Manuscrit issu de la collection d’Albert Köster (1862-1942) et conservé au Deutsches Theatermuseum de Munich sous la cote 001/4 00271/001.
[127] Manuscrit issu de la collection d’Albert Köster (1862-1942) et conservé au Deutsches Theatermuseum de Munich sous la cote 001/4 00271 :2/001
[128] Achevé d’imprimer sur les presses d’Orell Füssli Arts graphiques S.A. à Zurich le 15 février 1942. Réimpressions le 29 juillet 1977 sur les presses de Paul Attiger à Neuchâtel, en avril 1994 sur les presses de l’imprimerie Benteli à Wabern-Berne, puis en format de poche en janvier 2015 sur les presses de l’imprimerie « La Source d’Or » à Clermont-Ferrand.
[129] Michel Schlup, Marcel North (1909-1990), dessinateur, aquarelliste, graveur, illustrateur, scénographe, écrivain et chroniqueur, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2009, p. 42.
[130] André Clavien, Hervé Gullotti et Pierre Marti, « La province n’est plus la province » : Les relations culturelles franco-suisse à l’épreuve de la seconde guerre mondiale (1935-1950), Lausanne, Antipodes, 2003, p. 208.
[131] Sur le rejet par Louis Aragon de la posture adoptée par Henry de Montherlant et Jean Giono, voir l’article consacré à Louis Aragon et Albert Béguin par Corinne Grenouillet, « Celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas… », Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet, no 4, 1992, p. 221-281. En 1942, Aragon et Uhler doivent renoncer à un projet d’édition, car Gaston Gallimard refuse en principe les accords avec des maisons d’édition non françaises (Simon Roth et François Vallotton, « L’édition en Suisse romande de 1920 à 1970 », art. cit., p. 31). Aragon est édité par Uhler dès 1943. Après la guerre, Uhler continue à publier Montherlant avec des pièces de théâtre (1950-1951) et Aragon avec L’Enseigne de Gersaint (1946).
[132] Michel Schlup (textes) et Jean-Paul Reding (notices), Ides et Calendes : 50 ans d’édition. 1941-1991. Catalogue d’exposition, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 1991, p. 11.
[133] Ibid., p. 43.
[134] Ibid., p. 7.
[135] Une publicité de la Feuille d’avis de Neuchâtel du 3 décembre 1942 annonce la parution récente de l’ouvrage.
[136] La publication ne contient pas d’achevé d’imprimer. La première mention de cette publication que j’aie identifiée dans la presse suisse numérisée date du 1er février 1944, le lendemain de la mort de l’auteur (P.-H. J., « Jean Giraudoux n’est plus », La Revue, no 30, 01.02.1944, p. 6). À lire l’apparat critique de l’édition dans la Pléiade et en raison de l’absence de cette publication dans le catalogue Ides et Calendes 1943-1944, on peut se demander si la sortie a été différée en raison d’un accord avec la maison d’édition Grasset, qui a édité une version ultérieure du texte dont l’achevé d’imprimer date du 11 novembre 1943 (Étienne Brunet, Wayne Ready, « Note sur le texte », dans Jean Giraudoux, Théâtre complet, Jacques Body (dir.), Paris, Gallimard, 1982, p. 1678-1679).
Pour citer cet article
Simon Willemin, « Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 301 [en ligne], mis à jour le 01/03/2025, URL : https://sht.asso.fr/le-sabbattini-de-louis-jouvet-complements/