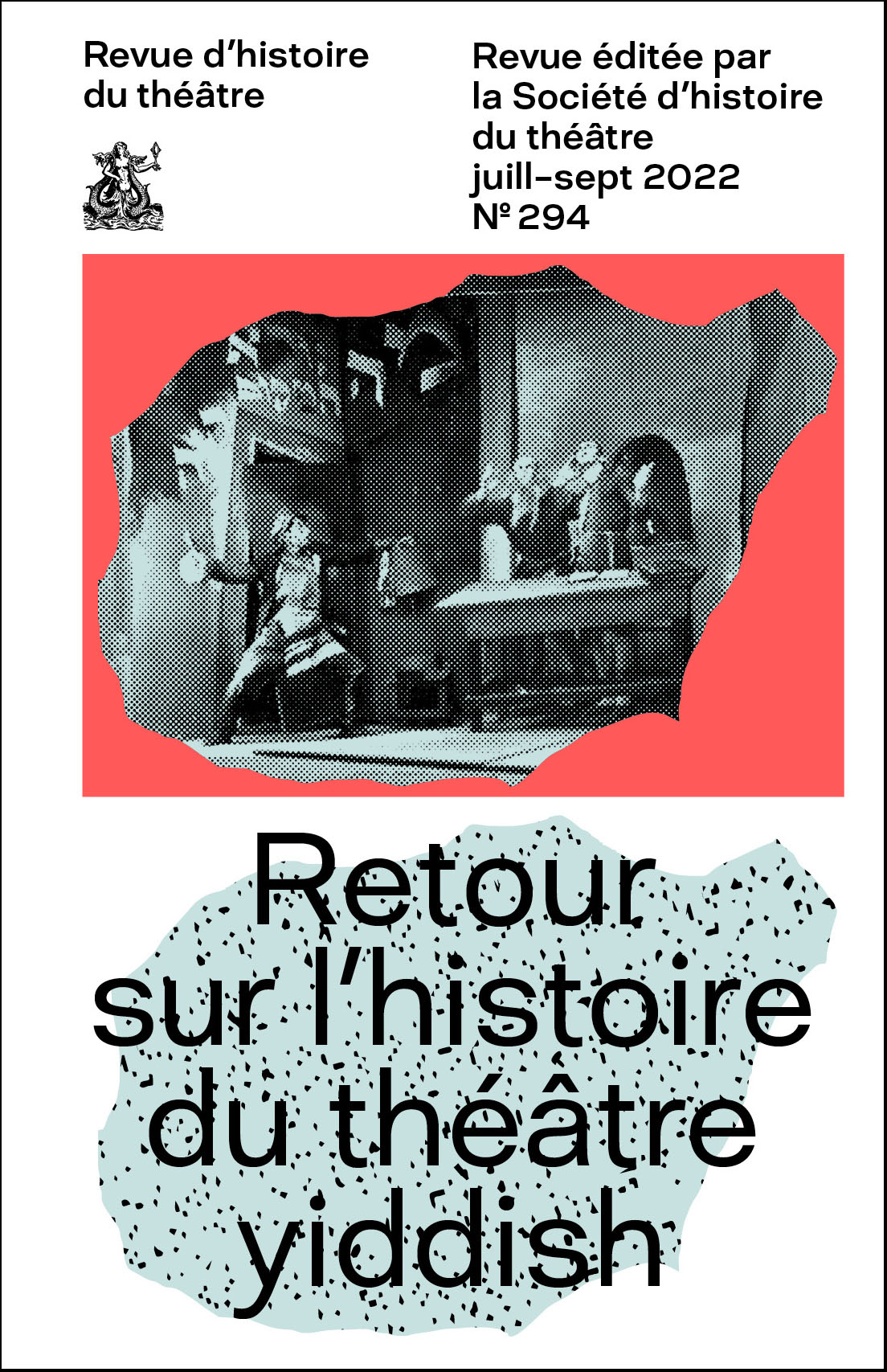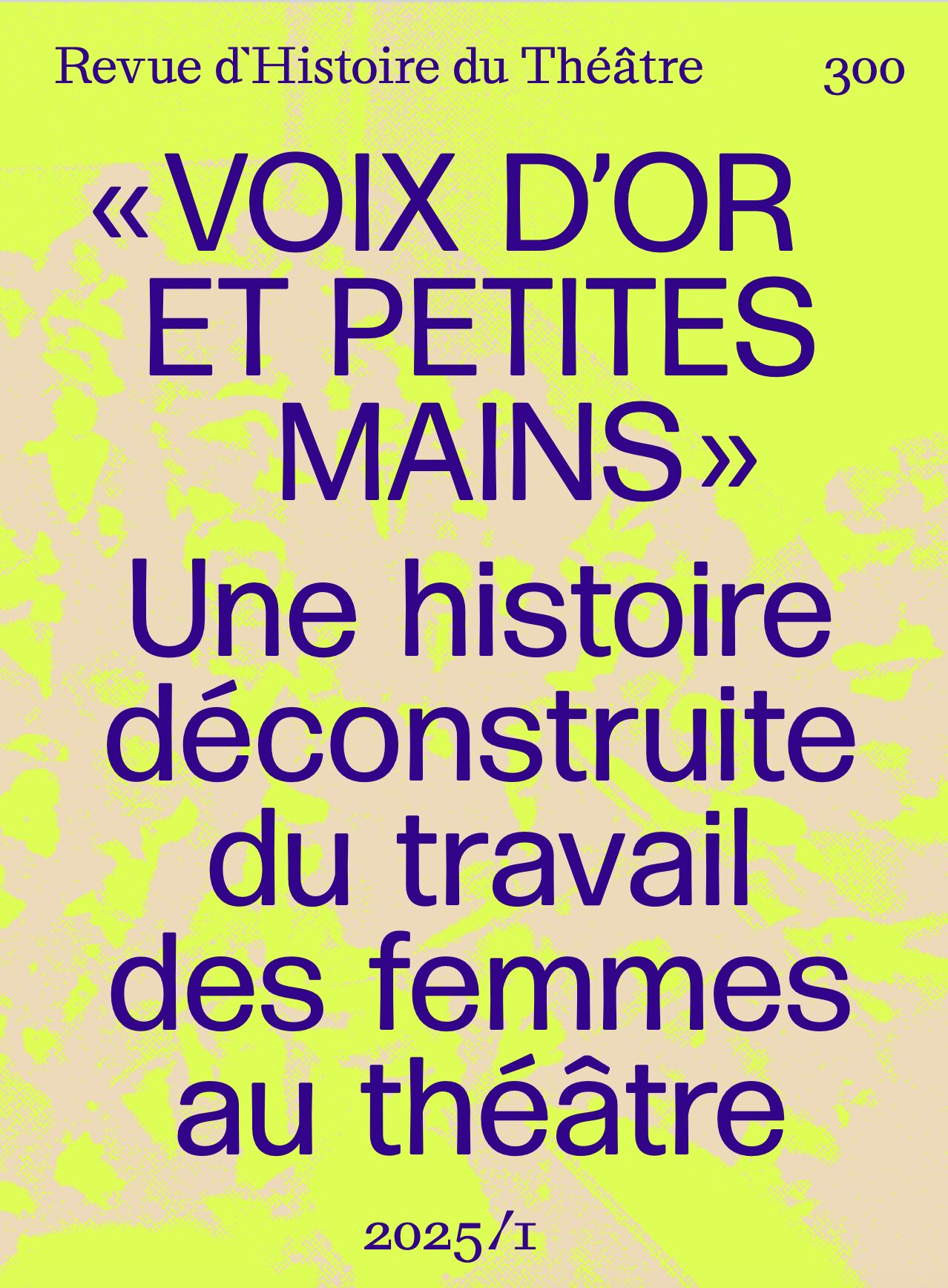Revue d’Histoire du Théâtre • N°294 T3 2022
Recensions d’une exposition et d’un ouvrage sur le théâtre yiddish
Par Pascale Melani, Joël Huthwohl
Résumé
Recension de l’exposition [Veršiny evrejskogo teatra v Rossii : « Gabima » i GOSET (1919-1949)], Moscou, Musée national central du théâtre Alexis Bakhrouchine, 2015, par Pascale Melani.
Recension de l’ouvrage Étoiles vagabondes de Sholem-Aleikhem, Paris, Le Tripode, 2020, par Joël Huthwohl.
Texte
Recension de l’exposition [Veršiny evrejskogo teatra v Rossii : « Gabima » i GOSET (1919-1949], Moscou, Musée national central du théâtre Alexis Bakhrouchine, 2015
Du 19 février au 19 mars 2015, le Musée national central du théâtre Alexis Bakhrouchine a présenté au public une exposition consacrée aux deux principaux théâtres juifs actifs pendant la période soviétique, le « Habima » de Naoum Tsemakh et le GOSET [Théâtre juif d’État] de Moscou. Cette exposition a constitué un événement particulièrement notable : d’une part, parce qu’elle était le fruit d’une collaboration entre deux institutions russe et israélienne, le Musée Bakhrouchine et le Musée Israël Gour de l’Université de Jérusalem ; d’autre part, parce qu’elle a proposé au public un nombre exceptionnel de pièces reflétant l’histoire du théâtre juif en Russie et Union soviétique. Par un curieux hasard (?), elle a été inaugurée lors du 125e anniversaire de la naissance de Solomon Mikhoels, acteur et metteur en scène mythique dont le sort tragique résume à lui tout seul la destinée du théâtre juif en URSS. Ce dernier, on le sait, a accédé à la reconnaissance après et grâce à la Révolution de 1917, avant de disparaître dans la tourmente de la campagne contre le cosmopolitisme, lorsque l’État soviétique a procédé à l’élimination de ses élites juives.
L’exposition a été conçue par Alexandre Echanov, metteur en scène du Théâtre Ermitage de Moscou. Le catalogue bénéficie également de la contribution scientifique de Vladislav Ivanov, historien du théâtre, spécialiste du théâtre juif et du metteur en scène Evgueni Vakhtangov, ainsi que de celle de l’historien de l’art Hillel Kazovsky, enseignant à l’université hébraïque de Jérusalem, auteur de plusieurs ouvrages sur les artistes juifs.
N’ayant pas eu la possibilité de visiter directement l’exposition, nous proposons ici, en guise de de substitut, un compte rendu du catalogue publié par le Musée Bakhrouchine.
Cet ouvrage de 100 pages, de format 27 × 21,5 cm, inclut une sélection des pièces exposées. Celles-ci sont issues des fonds de plusieurs musées et institutions : outre les deux déjà mentionnées, le Musée du Théâtre Vakhtangov, le Musée de l’histoire des juifs de Russie, les Archives nationales de littérature et d’art, la Galerie Tretiakov et des collections privées.
Dans son introduction, Dmitri Rodionov, directeur général du Musée Bakhrouchine, chef du projet, souligne la place du théâtre juif dans l’histoire générale du théâtre en Russie/urss au XXe siècle et retrace les principales phases de son développement, en rappelant des faits connus : le rôle « libérateur » de la Révolution de 1917 qui permit à la fois la légalisation du théâtre yiddish, qui avait été interdit par le pouvoir tsariste de 1883 à 1905, et la réalisation de l’utopie sioniste avec l’émergence d’un théâtre en langue hébraïque.
Dans une brève présentation, Alexandre Echanov, commissaire de l’exposition, insiste ensuite sur l’importance, pour la Russie, de réintégrer cette mémoire de la scène juive dans sa propre histoire du théâtre, d’où elle a été exclue à la fin de la période stalinienne.
Le catalogue s’organise ensuite en sept parties qui reflètent les différentes sections de l’exposition.
La première partie, intitulée « La Renaissance de la culture juive en Russie (fin XIXe-début XXe siècles) », évoque les débuts de ce mouvement. Elle expose les différentes conceptions de l’art qui opposaient les artistes juifs à la frontière des XIXe et XXe siècle, ainsi que les diverses voies empruntées par ces derniers pour créer la « nouvelle forme hébraïque » destinée à devenir le vecteur de l’identité juive : une voie passant par la synthèse des réalisations de l’avant-garde européenne et de la tradition artistique juive avec celles de l’art oriental ancien (tendance incarnée notamment par l’Autoportrait de Nathan Altman, 1916, où la stylisation de la sculpture de l’ancienne Égypte est combinée avec une approche cubiste de la forme), et une voie puisant dans le trésor de l’art hébraïque d’Europe orientale : fresques de synagogues, objets rituels, manuscrits illustrés, etc. Le catalogue reproduit des pièces de la collection d’objets de l’art populaire et religieux rassemblés lors de l’expédition ethnographique dirigée par Siméon An-ski en 1912–1914. Est ensuite mis en lumière le rôle pionnier d’Abraam Goldfaden, dramaturge, poète, homme de théâtre qui est le premier à composer des pièces en yiddish et dont la troupe ambulante s’est produite dans différentes provinces de l’Empire russe ainsi qu’en Roumanie. Une autre étape cardinale dont l’exposition rend compte est l’institution à Kiev début 1918 de la Kultur-Lige, qui essaime ensuite dans toute l’Ukraine sous la forme de sections locales. Est rappelé le rôle de la conférence de Czernowitz (30 août – 3 septembre 1908), après laquelle la culture en langue yiddish se développe avec l’appui des organisations antisionistes qui rassemblent alors la majorité des artistes juifs kiéviens (Marc Chagall, Alexandre Tychler, Isaac Rabinovitch), d’autres artistes juifs venus de différentes provinces de l’Empire (El Lissitski, Polina Khentova…), des écrivains, des musiciens… Bénéficiant dans un premier temps du soutien du pouvoir soviétique, elle perd progressivement son autonomie et passe sous le contrôle du Narkompros (Commissariat du peuple à l’éducation). Cette mise au pas marque la fin d’une expérience originale de réalisation de l’idée nationale juive sur la base de l’autonomie culturelle et de l’élaboration d’une culture juive contemporaine.
La seconde partie, intitulée « Introduction au théâtre juif » emprunte son titre au panneau de Chagall (Introduction au théâtre juif). Elle reproduit un extrait des souvenirs du peintre qui retrace son entretien avec le « Géorgien Vakhtangov » à propos de la mise en scène du Dibbouk de Shalom An-Ski : Chagall oppose au disciple de Stanislavski sa propre vision de ce que doit être un théâtre juif.
C’est ensuite sur les deux principales scènes du théâtre juif soviétique, le « Habimah » et le GOSET, que se concentre l’attention.
Vladislav Ivanov décrit les principales étapes de l’activité Russie du Habimah [הבימה], théâtre juif en langue hébraïque dont le nom hébreu signifie justement « Scène », fondé en 1913 par Naoum Tsemakh dans les marges de l’empire russe, dans la ville polonaise de Belostok/Bialystok. Ce théâtre, d’abord amateur, se professionnalise à Wilno, montre à Vienne en 1913 son adaptation de Crime et châtiment de Dostoïevski, puis se fixe à Moscou où il se constitue autour de la triade Menahem Gnessin – Khana Rovina – Naoum Tsemakh. Conscient du manque de professionnalisme de ses acteurs, Tsemakh implore l’aide Stanislavski en ces termes : « La seule chose que je vous demande, c’est de nous aider à apprendre, surtout en cette période douloureuse d’accouchement ». De cette rencontre va naître le studio-théâtre Habimah à la tête duquel Stanislavski nomme son élève Evgueni Vakhtangov, de formation multiculturelle.
La publication reproduit des pièces relatives à la mise en scène mythique du spectacle Entre deux mondes (Le Dibbouk), de Sémion An-ski en 1922, considérée aujourd’hui, selon Echanov, comme l’un des dix plus grands spectacles du XXe siècle : alternent ainsi extraits de correspondance, affiches, maquettes de décor et esquisses de costumes de Nathan Altman, notes de mise en scène de Vakhtangov, photos du spectacle provenant de la collection du Musée du Théâtre Vakhtangov et d’autres documents étonnants – comme cette lettre de Chaliapine et cette photo de l’artiste dédicacée à Naoum Tsemakh qui témoignent de l’admiration portée par le grand chanteur au spectacle du Habimah.
La quatrième partie, dédiée au GOSET, s’attarde sur la personnalité de Granovski, son premier directeur. Elle reproduit des documents relatifs aux trois mises en scènes emblématiques du théâtre, La Sorcière, Le Voyage de Benjamin iii et Le Roi Lear (maquettes de décors et esquisses de costumes signés par les plus grands noms du décor de scène, comme Rabinovitch, Altman, Falk, Tychler) et aussi un texte inédit, « Trois conversations avec Gordon Craig », conservé sous forme de manuscrit au rgali. La partie V est dédiée aux décorateurs du GOSET et présente différents travaux de Rabitchev, Altman, Rabinovitch, Tychler, Falk.
L’épilogue est consacré à la liquidation du GOSET. On y découvre des documents personnels ayant appartenu à Solomon Mikhoels et Benjamin Zouskine (Süsskin), tous deux assassinés sur ordre de Staline au plus fort de la « lutte contre le cosmopolitisme » : le meurtre de Mikhoels a été, comme on le sait désormais, maquillé en accident, tandis que Zouskine a été « plus classiquement » fusillé.
En résumé, cette exposition a permis de réintégrer officiellement la mémoire du théâtre juif dans le monument du théâtre russe multinational et de témoigner de ses deux facettes, hébraïque et yiddish. Pour autant qu’on puisse en juger, est plus particulièrement mise en vedette l’histoire du Habimah, qui n’avait pas encore été bien documentée. Les documents rassemblés sont pour une large part inédits, bien que certains aient été publiés dans l’ouvrage de référence de Béatrice Picon-Vallin, Le Théâtre juif soviétique pendant les années vingt (La Cité/L’âge d’homme, 1973), auquel le lecteur français pourra toujours se référer. Des comptes rendus parus dans la presse suggèrent que l’exposition a réussi à les mettre en valeur : le nom Habimah était dessiné en lettres géantes, la correspondance de Vakhtangov avec ses élèves était reproduite sur un gigantesque panneau, la photo de l’arrivée du train de Minsk rapatriant le cercueil de Mikhoels a été spectaculairement mise en scène… Le texte s’appuie sur les résultats des recherches de Vladislav Ivanov, qui a retrouvé deux cahiers de Naoum Tsemakh contenant ce qui apparaît aujourd’hui comme la rédaction définitive du Dibbouk, approuvée par la censure. Il inclut des renseignements biographiques sur les principaux artisans de la scène juive en Russie, les répertoires des deux théâtres et une actualisation de la bibliographie. À défaut de visiter l’exposition, le lecteur pourra donc consulter utilement ce catalogue, en vente à la boutique du Musée.
Recension du récit Étoiles vagabondes de Sholem-Aleikhem, Paris, Le Tripode, 2020
Dans l’œuvre de Sholem-Aleikhem (1859-1916), romancier et auteur de théâtre, figure importante du renouveau de la culture yiddish dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les amateurs de l’histoire du théâtre yiddish liront avec bonheur et intérêt le grand roman intitulé Étoiles vagabondes, (Blondzhende Shtern) récemment publié aux éditions du Tripode, dans une traduction de Jean Spector.
D’abord publié en feuilleton en 1909 et 1910 dans un journal yiddish de Varsovie, ce récit épique commence dans un shtetl de Bessarabie nommé Holenechti, où débarque une troupe itinérante de théâtre yiddish. Installée dans un hangar chez l’homme le plus riche du bourg, elle fascine aussitôt les habitants, qui s’y rendent tous les soirs en grand nombre. Parmi eux, deux adolescents, Leybl, le fils du propriétaire, à pied d’œuvre pour se glisser dans les coulisses et faire connaissance avec certains membres de la troupe, et Reyzl, la fille du chantre, d’un milieu plus modeste, qui réussit à entrer dans la salle grâce à Leybl. Les deux jeunes gens sont tombés amoureux l’un de l’autre et leurs destins seront au cœur du roman. « Si le théâtre yiddish allemand était pour les Juifs de Holenechti un véritable plaisir tombé du ciel, pour notre petit couple, le fils du riche et la fille du chantre, ce fut un vrai paradis, un paradis du bon Dieu, où il n’était pas donné à tout un chacun de pouvoir entrer si facilement. » (p. 42)
Pendant une nuit de shabbess mémorable, ils quittent en secret leur famille pour suivre les comédiens en voyage. Le périple, qui les mène ensuite à Budapest, Bucarest, Vienne, Londres jusqu’à New York, est le fil conducteur d’un récit foisonnant et plein d’humour, qui permet, entre bien d’autres qualités, de découvrir la vie des artistes yiddish de l’époque, qui partagent bien des caractéristiques avec les autres troupes de comédiens – rêve de gloire, combines de directeurs de théâtre, rivalités entre artistes, incertitude du lendemain – mais évoluant dans un monde qui leur est propre.
Au fil des pages se dessine un paysage subjectif et très vivant du répertoire, des rôles et des lieux de théâtre yiddish, fresque dressée par un auteur qui connaît parfaitement la littérature et la géographie des spectacles de son époque. Ainsi Hotzmakh, le premier protecteur de Leybl, raconte comment il est devenu un grand acteur comique. « D’abord Schmendrik, puis Tzingitang, ensuite Kuni-Lemel, et encore Noé l’ivrogne et aussi David le violoneux ; j’ai même joué Papus dans Bar Khba et j’ai même goûté à Zelikl le musicien dans la Blimelè de Lateiner. » (p. 71). De même Leybl, devenu célèbre sous le nom de Rafalesco, triomphera dans le rôle-titre de Uriel Acosta, dans une version traduite en yiddish, sans doute d’après l’œuvre de Karl Gutzkow. C’est aussi une plongée dans le public de ces théâtres, qu’il s’agisse de la province ou des grandes villes. À Londres par exemple, où l’un des personnages dirige le Pavilion Theatre, on prend la mesure des effets communautaires et de la non-porosité entre les publics. Le Pavilion Theatre, malgré son succès, n’attire pas tous les Juifs de Londres, notamment les classes les plus aristocratiques. « Un rabbin orthodoxe de Londres se convertirait, et un révérend moderne apprendrait à prier plus facilement qu’un Juif de l’Ouest londonien ne consentirait à débarquer dans Whitechapel, dans un théâtre yiddish de shnorrers, où les Juifs parlent yiddish, jouent en yiddish, chantent en yiddish et dansent en yiddish. » (p. 350). De même à New-York où un des protagonistes tente d’expliquer qu’une grande carrière artistique passe nécessairement par une émancipation de ce milieu culturel originel, sinon le succès resterait limité à un périmètre restreint de spectateurs. « Croyez-moi, j’aime les Juifs autant que ma vie. J’aime le théâtre yiddish, la cuisine yiddish. Je suis amoureux de votre jargon, dans ma maison on respecte les règles de la vie juive, mes enfants, grâce à Dieu, sont de bons Juifs, et pourtant, je dois bien avouer que s’il arrive un jour à mon Grisha de descendre Downtown, c’est-à-dire dans le quartier juif, et d’y jouer sur une scène juive devant un public juif, ou bien pardonnez-moi la comparaison, d’entrer dans une synagogue, c’en serait fini, plus de Grisha Stelmakh ! » (p. 474-475). Au-delà de ces passages qui, sans jamais tomber dans le reportage ou le documentaire, pourraient être qualifiées de sociologiques, certains chapitres nous font entrer dans la culture yiddish et ses nuances, dans les mentalités, par la description des rituels, au moment de la mort du chantre par exemple, ou encore quand est évoquée la plus grande liberté des pratiques religieuses aux États-Unis, où l’auteur a vécu en 1906 puis est retourné en 1914 et est mort en 1916.
Dans le domaine théâtral, on découvre la figure emblématique et très populaire de « Moyshé » (chapitre 27). Moyshé, c’est le spectateur lambda, le quidam, « le symbole du personnage naïf, vulgaire, mal dégrossi ». Il aurait été inventé par Abraham Goldfaden, « surnommé le père du théâtre yiddish ». Sholem-Aleikhem fait la démonstration spectaculaire du succès de Moyshé, qui donne son titre à une pièce « dramatico-musicale et patriotique » ainsi qu’à la chanson finale interprétée par la prima donna. La chanson devient alors une sorte d’hymne communautaire, reprise en chœur sur le plateau et dans la salle, et fredonné à tous les coins de rue.
Au travers de multiples fils secondaires, grâce à des personnages hauts en couleurs, à une verve qui s’attache aux expressions idiomatiques et aux tics de langage, en tenant en haleine son lecteur par le rythme effréné du feuilleton, Sholem-Aleikhem entraîne son lecteur dans un monde à la fois réel, car il s’inscrit explicitement dans la vie du théâtre yiddish de son époque, et imaginaire, avec des personnages de fiction, aventureux, attachants, insupportables et drôles.
L’auteur remercie Lenka Bokova qui lui a fait découvrir ce texte.
Pour citer cet article
Pascale Melani, Joël Huthwohl, « Recensions d’une exposition et d’un ouvrage sur le théâtre yiddish », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 294 [en ligne], mis à jour le 01/03/2022, URL : https://sht.asso.fr/recensions-dune-exposition-et-dun-ouvrage-sur-le-theatre-yiddish/